





Une étude en éducation permanente
réalisée par Les Grignoux et consacrée au thème :
Analyse de films et éducation aux médias
![]() L'étude en éducation permanente, proposée ici, s'inscrit dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel et au cinéma en particulier. Elle s'adresse notamment aux éducateurs qui travaillent avec un public adulte intéressé par le cinéma et qui souhaite approfondir sa réflexion à ce propos. Elle propose un cadre général pour aborder l'analyse filmique et ses différentes composantes. L'ensemble de cette étude est disponible ci-dessous ainsi qu'au format pdf facilement imprimable.
L'étude en éducation permanente, proposée ici, s'inscrit dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel et au cinéma en particulier. Elle s'adresse notamment aux éducateurs qui travaillent avec un public adulte intéressé par le cinéma et qui souhaite approfondir sa réflexion à ce propos. Elle propose un cadre général pour aborder l'analyse filmique et ses différentes composantes. L'ensemble de cette étude est disponible ci-dessous ainsi qu'au format pdf facilement imprimable.
Le Conseil Supérieur de l'Éducation aux Médias (de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique) a proposé en 2015 un modèle inédit des compétences médiatiques qui devraient être acquises par tous les citoyens vivant dans un monde où les médias – en particulier numériques – ont pris une place de plus en plus grande [1]. Ce modèle repose notamment sur la distinction entre quatre grands types d'activités médiatiques : lire, écrire, naviguer, organiser.
L'objet de la présente étude est d'abord de définir brièvement ces quatre termes et ensuite de montrer comment cette distinction peut être utile dans l'abord d'un objet médiatique particulier : le cinéma. On restreindra même un peu plus le propos en se limitant aux activités d'analyse cinématographique, le cinéma pouvant donner lieu par ailleurs, en situation éducative (que ce soit à l'école ou en formation continue au long de la vie), à des exercices de réalisation ou de création filmique (qui ne seront donc pas abordés ici).
Voir un film, que ce soit en salle ou sur un écran numérique, est une activité courante, pratiquée par un grand nombre de personnes, le plus souvent dans le cadre des loisirs. Mais l'on sait aussi depuis longtemps que cette activité spontanée peut être utilisée dans une perspective éducative, qu'il s'agisse d'aborder avec les spectateurs une réalité mise en scène par le cinéma, de traiter avec eux de certains thèmes du film vu ou encore d'analyser le travail cinématographique que le film en cause illustrerait de manière exemplaire. L'on remarque cependant que, dans un tel cadre à vocation éducative, le film choisi n'est souvent qu'un prétexte pour parler d'autre chose, par exemple des réalités évoquées par le film directement ou indirectement, comme c'est souvent le cas dans les débats d'après projection. La perspective adoptée ici privilégiera l'analyse du film en lui-même, sans cependant le réduire à sa seule dimension esthétique (comme le ferait une approche centrée sur le Septième Art) : le propos du film, le point de vue de l'auteur, la mise en scène signifiante du monde, la médiation de la fiction (qui nous montre la réalité à travers des êtres, personnages et décors plus ou moins fictifs), l'implication des spectateurs, tant d'un point de vue cognitif qu'émotionnel, et d'autres aspects constituent autant d'éléments qui méritent une réflexion plus ou moins approfondie.
La lecture est entendue ici au sens large comme une activité de réception d'un objet médiatique : on lit bien sûr un texte écrit (qu'il s'agisse d'un document imprimé ou d'une page sur Internet), mais on peut également « lire » une image, un film, une émission télévisuelle, une pièce de théâtre, une publicité... Même si la « lecture » est souvent silencieuse, il s'agit d'une activité qui mobilise des compétences techniques – par exemple pour décoder les graphèmes –, informationnelles – comprendre le sens du message implique un travail d'interprétation plus ou moins complexe – et sociales (ou relationnelles [2]) – même si l'auteur du texte est « absent », nous nous interrogeons sur ses intentions, sur le lieu et l'époque auxquels il appartient, sur l'effet qu'il cherche éventuellement à produire sur nous –.
Le Sacrifice d'Isaac du Caravage
Les personnages mis en scène, leur gestuelle, la situation d'ensemble sont incompréhensibles sans culture biblique.
Si, par leur formation, enseignants et éducateurs savent bien évidemment ce qu'est la lecture, il faut insister sur la complexité des objets médiatiques qui comprennent de multiples « couches » techniques et symboliques : ainsi, lire un texte écrit ne signifie pas seulement déchiffrer des caractères imprimés, mais implique un important travail de construction du sens pour comprendre par exemple toutes les raisons dispersées tout au long du roman de Gustave Flaubert qui conduiront Madame Bovary au suicide ; mais lire une « image » comme une simple photographie implique pareillement qu'on ne se limite pas à y voir une représentation d'un univers en trois dimensions, mais qu'on comprenne qui sont les personnes ou les objets éventuellement représentés, où, quand, par qui et pourquoi cette photo a été prise, quelles sont les caractéristiques par exemple esthétiques qui sont importantes à observer et à interpréter. On remarquera que, comme un texte écrit, une image peut être interprétée de façon incorrecte ou insuffisante : face à un tableau comme le Sacrifice d'Isaac du Caravage, il est évidemment impossible de comprendre la pose des personnages, leurs gestes, leurs sentiments, la dramaturgie générale de la scène si l'on ne connaît pas cet épisode biblique [3].
L'écriture est également entendue ici de façon élargie comme toute activité de production (ou de réalisation) médiatique : j'écris un texte sur une feuille de papier ou sur un écran d'ordinateur, je fais une photo, je réalise une vidéo, j'enregistre une conversation ou un morceau de musique, je participe à une émission radiophonique qui sera éventuellement « podcastée »...
Comme pour la lecture, il faut insister sur les multiples compétences qu'implique « l'écriture » si, du moins, l'émetteur veut qu'elle soit réussie : il faut maîtriser des aspects techniques – par exemple savoir utiliser une caméra reliée à un ordinateur –, mais également des exigences informationnelles – un film doit avoir un « contenu », une histoire à raconter ou un propos à illustrer – et sociales – un réalisateur de cinéma ne s'adresse pas de la même manière à un public d'enfants ou d'adultes –.

Le Mystère de la chambre jaune
un film de Bruno Podalydès (2003)
Observant un indice – un cheveu ! – relevé par Rouletabille, les personnages se signalent par une gestuelle expressive, légèrement caricaturale. Mais le «langage» non-verbal est souvent beaucoup plus difficile à interpréter.
Si l'écriture au sens courant repose sur un code socialement partagé (en français par exemple, le code alphabétique, l'orthographe, la grammaire, mais aussi la ponctuation), « l'écriture » audiovisuelle est évidemment moins codifiée même si certaines techniques élaborées de façon empirique notamment par les premiers cinéastes assurent une communication efficace [4]. En outre se pose la question de la construction de la signification qui ne se situe pas au niveau audiovisuel même si elle repose nécessairement sur des indices visibles ou audibles : comment traduire à l'écran par exemple la peur d'un personnage ? Le personnage peut s'exprimer verbalement ou manifester ses sentiments par des gestes ou des expressions faciales, mais le cinéaste peut également utiliser une musique d'ambiance angoissante... Cette remarque vaut pour tous les types d'écriture (littéraire, filmique, picturale, photographique...) : écrire un « texte » cohérent ne se limite pas à jeter des mots sur une page ou à planter sa caméra n'importe où pour filmer un événement jugé intéressant, mais consiste à construire un ensemble cohérent et significatif pour que la communication vers le spectateur soit réussie.
Lire et écrire, même entendus au sens large, sont des activités bien connues et dont la distinction – réception vs production – est facile à comprendre. La navigation en revanche peut apparaître comme un phénomène récent lié en particulier à Internet et à un de ses outils essentiels, l'hyperlien : ces liens hypertextes permettent en effet de passer d'une page à une autre, d'un endroit d'une page à un autre, d'un document ou d'un type de document à un autre (par exemple d'une page html à un fichier pdf ou à une vidéo). Tous les utilisateurs du web savent désormais – même si c'est de manière essentiellement intuitive – ce que signifie « surfer » sur Internet, et ils manient, parfois de façon sommaire, parfois de façon experte, des outils comme les moteurs de recherche dont Google est actuellement le leader en Occident.
Cet exemple permet d'ailleurs de comprendre que la navigation qui peut paraître une activité simplissime – « Cliquez sur le lien » – nécessite également des compétences multiples pour trouver l'information pertinente : dans ce cas aussi, il y a une composante technique – maîtriser les différents instruments de recherche, recherche simple/avancée, recherche d'images par type / par taille, etc. –, mais également informationnelle – tous les résultats proposés n'ont pas la même pertinence en termes de contenu – et sociale – on ne peut pas considérer de la même manière un blog individuel exprimant l'opinion d'une seule personne et un site universitaire reproduisant des travaux de nature scientifique –.
Par ailleurs, on remarquera de façon plus large que la navigation, qui consiste à « lire » en tout ou en partie une collection d'objets médiatiques, diversement reliés entre eux, est une activité qui dépasse le « surf » sur Internet et peut prendre d'autres formes, plus anciennes ou plus inattendues : ainsi, lorsque nous visitons une librairie, une bibliothèque ou un musée, nous pratiquons en fait une navigation entre des journaux, des revues, des livres ou des objets d'art, qui, loin d'être distribués au hasard, sont organisés selon différents principes plus ou moins explicites – magazines réputés « féminins », magazines autos souvent connotés masculins, magazines de psychologie, d'histoire, d'art, d'actualité, etc. –.
Plus surprenant peut-être, faire nos achats dans un supermarché comporte une part importante de navigation, soit pour trouver le produit que nous recherchons, soit de façon plus insidieuse lorsque notre regard est attiré par certains produits habilement disposés à des endroits stratégiques qui favorisent des achats impulsifs. Cette activité peut d'ailleurs devenir véritablement experte si nous souhaitons nous intéresser à la composition exacte des produits proposés, généralement écrite en tout petits caractères : il y a bien là une navigation entre plusieurs étiquettes, souvent présentées de différentes manières, pour déterminer la quantité de calories ou la part respective de glucides, de protéines ou de lipides... Naviguer entre différentes chaînes de télévision est également une activité aujourd'hui tout à fait courante grâce à cet instrument aussi utile que pernicieux [5] qu'est la télécommande ; mais choisir un film, que ce soit en se basant sur les affiches présentes dans le hall d'un cinéma, les photos en vitrines, ou en se fiant au nom du réalisateur ou à des critiques lues récemment dans la presse, relève également de la navigation puisqu'il s'agit de sélectionner un objet privilégié – le film à voir – dans une collection d'objets médiatiques – les films actuellement à l'affiche –.
On remarquera pour terminer à ce propos que, si la lecture est plutôt de nature intensive, la navigation est quant à elle avant tout extensive : je dois lire un roman en entier pour en comprendre le sens et en saisir les nuances, mais je parcours seulement les quatrièmes de couverture lorsque je visite une bibliothèque. La navigation « libre » (sans but) implique nécessairement une perte d'information beaucoup plus importante que la lecture, et la navigation orientée par un objectif de recherche doit négliger, pour être efficace, tout ce qui paraît secondaire et non pertinent par rapport à son objet. Choisir une recette de cuisine dans un livre de recettes ou sur Internet ne consistera pas bien sûr à lire la totalité des recettes, et l'on s'appuiera sur quelques éléments comme l'aspect des plats proposés, les ingrédients principaux ou la durée de préparation. On soulignera cependant que cette navigation est orientée par l'organisation sous-jacente de l'information et que les photos, qui étaient absentes des livres de recettes de nos aïeux, jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans nos choix culinaires… Ça a l'air appétissant, disons-nous, ou pas !
On peut dire que l'organisation est à l'écriture ce que la navigation est à la lecture : organiser consiste à mettre en ordre ou en forme une collection d'objets médiatiques. Ici aussi, l'informatique fournit des exemples simples de ce type d'activité : ranger ses photos sur son ordinateur, que ce soit par date, par lieu ou par événement, consiste évidemment à les organiser, que ce soit de façon statique – si je me contente de les laisser dans l'ordre chronologique – ou dynamique – si je varie l'ordre de classement en fonction de mes besoins du moment. Les tags, étiquettes, mots-clefs ou labels, que j'utilise pour cataloguer mes photos, mes morceaux de musique ou mes fichiers, sont également des instruments d'organisation. Ces instruments sont parfois fournis par les concepteurs d'outils informatiques – ainsi les bibliothèques musicales catégorisent les morceaux comme jazz, musique classique, rap, rock, etc. – et sont donc utiles à la navigation, mais, dès que j'organise une bibliothèque ou une médiathèque personnelle avec l'aide de ces labels ou en utilisant mes propres labels – ne serait-ce que les étoiles d'évaluation –, je réalise un travail d'organisation [6].
L'organisation peut prendre cependant des formes beaucoup plus élaborées. C'est le cas par exemple du rédacteur en chef d'un journal : il a la responsabilité de rassembler des articles écrits par différents journalistes, de leur adjoindre des photos ou des illustrations, d'insérer éventuellement un chapeau (ou chapô, c'est-à-dire quelques lignes d'introduction en gras), de décider de leur disposition en première page ou en pages intérieures, etc. On retrouve le même travail d'organisation chez l'administrateur d'un site web qui va décider de la disposition des différentes pages, de leur articulation notamment via les liens hypertextes, du choix des illustrations, de la répartition des textes et images en fonction de multiples critères, etc.
Ci-dessus la barre de navigation d'un site Web (AlloCiné) consacré au cinéma, qui distingue les films en avant-première, les films à l'affiche, les films pour enfants, les actualités du cinéma et les supposés meilleurs film. Cette barre constitue un principe d'organisation qui facilite la navigation du visiteur à travers un site qui doit compter des milliers sinon des millions de pages. Navigation et organisation apparaissent ainsi comme deux pratiques symétriques et complémentaires, mais elles sont néanmoins très différentes: rien ne permet au visiteur de savoir quel est le principe de l'organisation selon les «meilleurs films», principe qui appartient seulement au concepteur du site.
Cet exemple permet de souligner que le travail d'organisation est très rarement individuel et qu'il suppose la mise en œuvre de multiples compétences spécifiques : un site web suppose ainsi la collaboration d'un intégrateur qui rassemble les différentes interventions techniques d'un développeur, d'un administrateur système, d'un webdesigner et d'autres métiers spécialisés, mais aussi d'un responsable éditorial qui prend en charge notamment le contenu informationnel apporté par différents rédacteurs ou créatifs, et qui contrôle également l'aspect social du site avec l'aide notamment d'un gestionnaire de communauté qui interagit avec les lecteurs ou visiteurs (à travers par exemple la modération du courrier).
On remarquera de façon plus générale que toute publication suppose une activité d'organisation qui dépasse le simple travail d'écriture : ainsi, même si le romancier a sans doute une certaine idée du type de lecteurs auxquels il va s'adresser, l'édition de son œuvre suppose des compétences tout à fait spécifiques, comme le choix de la couverture (illustrée ou non), de la typographie, du format, de l'extrait retenu pour le quatrième de couverture, mais également des canaux de diffusion en fonction du public visé. Le travail d'organisation apparaît d'ailleurs très clairement dans l'inscription du texte retenu dans une collection particulière qui, d'après l'éditeur, possède des caractéristiques communes même si les auteurs sont évidemment différents et parfois ne se connaissent même pas. Et encore une fois, l'organisation suppose de son responsable non pas qu'il maîtrise différents métiers techniques, mais qu'il soit capable d'assurer la collaboration de différents spécialistes comme des illustrateurs, des graphistes, des publicitaires, des diffuseurs et même... des écrivains.
À ce propos, on remarque que si le travail d'édition et donc d'organisation est souvent perçu comme secondaire par le public, il est en réalité souvent premier à la fois d'un point de vue temporel, mais également structurel : quand un rédacteur en chef commande un article à un journaliste, non seulement il choisit généralement le sujet, mais il oriente très largement la manière de l'aborder ainsi que le style à adopter (objectif, sensationnaliste, orienté...). Dans le domaine audiovisuel, l'on voit également facilement l'importance des producteurs qui ne se contentent pas d'apporter le financement, mais qui prennent des décisions essentielles sur les films à réaliser, sur les thèmes ou les genres à aborder, sur les cinéastes, mais aussi les acteurs et actrices à engager, sur la manière de traiter les sujets et de raconter les histoires... [7]
Dans la même perspective, on soulignera encore qu'un réalisateur de cinéma n'est pas, contrairement à ce que l'on croit souvent, un cameraman (même si beaucoup de cinéastes sont photographiés avec l'œil au viseur d'une caméra), ni nécessairement l'auteur du scénario, ni un acteur, et qu'il ne doit posséder aucune de ces compétences spécialisées, ni celles par ailleurs d'éclairagiste, de monteur, de costumier ou d'ingénieur du son : on doit plutôt parler d'un travail d'organisateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de faire collaborer des métiers différents (que lui-même souvent ne maîtrise pas) pour réaliser une œuvre commune même s'il en est le responsable final et principal en assumant en particulier les différents choix opérés par ses collaborateurs [8].
Le tableau complet des balises en éducation aux médias proposé par le CSEM distingue quatre grands types d'activité – lire, écrire, naviguer, organiser –, mais il y ajoute trois dimensions communes à tous les médias : informationnelle, technique et sociale ; et le même objet peut être considéré tour à tour sous l'un ou l'autre de ces aspects. Ainsi, le monstre extra-terrestre mis en scène dans Alien de Ridley Scott (1979) résulte évidemment d'une série de trucages techniques, mais il a visuellement une apparence inhumaine, à la fois répugnante et fascinante, qui est transmise comme une information visuelle (et sonore !) au spectateur [9] ; enfin, cette créature a un impact émotionnel (marquant !) sur les spectateurs, ce qui est sans doute l'effet recherché par l'auteur de ce film spectaculaire, que nous considérons néanmoins comme une fiction grâce à des normes sociales largement partagées : nous avons appris tout au long de notre socialisation que ce genre de film fantastique et d'extra-terrestre vise essentiellement à nous distraire tout en jouant sur nos émotions les plus profondes.
Le tableau complet des balises en éducation aux médias comprend ainsi 12 « cases » recouvrant un champ de compétences diversifiées :
| Axe informationnel | Axe technique | Axe social | |
|---|---|---|---|
| Lire | Compétences informationnelles en lecture | Compétences techniques en lecture | Compétences sociales en lecture |
| Naviguer | Compétences informationnelles en navigation | Compétences techniques en navigation | Compétences sociales en navigation |
| Écrire | Compétences informationnelles en écriture | Compétences techniques en écriture | Compétences sociales en écriture |
| Organiser | Compétences informationnelles en organisation | Compétences techniques en organisation | Compétences sociales en organisation |
Dans le cas de l'analyse filmique, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à distinguer formellement les trois axes (informationnel, technique et social) qui seront néanmoins envisagés tour à tour sans les nommer précisément.
Sleepy Hollow
un film de Tim Burton (1999)
Cette image du film peut être considérée de différents points de vue :
technique : quels ont été les moyens utilisés pour créer cet arbre fantastique ?
informationnel : quel est le rôle dévolu à cet arbre dans l'histoire mise en scène ?
social : quel est l'effet produit par cette scène sur le spectateur qui sait notamment qu'il s'agit d'un film de fiction et plus précisément d'un film fantastique ?
On entend ici l'analyse filmique au sens le plus large comme toute réflexion sur un film. Il peut s'agir d'analyses savantes, généralement centrées sur la « forme » ou le « langage » cinématographique (avec le recours à des notions classiques comme le cadrage, l'échelle des plans, les mouvements de caméra, le montage visuel et sonore, etc.), mais aussi de réflexions nées spontanément à la vision d'un film et s'intéressant aussi bien à la dimension esthétique du film qu'à son contenu (qu'il s'agisse des personnages, de l'histoire mise en scène, des thèmes traités ou même des réalités évoquées).
Bien entendu, toutes ces analyses n'ont pas la même valeur, certaines étant très élaborées et d'autres faiblement argumentées, et elles adoptent des points de vue différents sur les films. Ainsi, l'approche esthétique de type universitaire va privilégier la « forme » du film, la manière dont il traduit son propos à l'écran par des moyens cinématographiques, mais l'analyste ne discutera pas en principe de ce propos qui relève de la liberté de l'auteur : qu'Octobre d'Eisenstein soit une glorification de la révolution bolchevique ou que les Amérindiens soient représentés comme des pillards et des assassins dans les grands westerns de John Ford La Chevauchée fantastique, La Poursuite infernale et Rio Grande lui importent peu, alors que de tels propos susciteront la réaction plus ou moins critique de nombreux spectateurs. L'on ne fera pas ici de distinction entre ces approches, ni entre la « forme » et le « contenu » des films que l'on considérera comme formant un ensemble dont on ne peut pas décider a priori que certaines dimensions sont plus importantes que d'autres : l'objectif ici n'est pas de former des spécialistes du cinéma, qui privilégient légitimement le travail de mise en scène cinématographique (la « forme » [10]), mais de favoriser chez tous les types de spectateurs, jeunes ou moins jeunes, une démarche d'analyse réflexive par rapport au cinéma. Et il s'agira notamment de déterminer quelles compétences médiatiques l'analyse filmique entend exercer et développer.
De prime abord, l'analyse filmique se présente comme une activité de « lecture » (au sens entendu précédemment). Il s'agit de voir un film, mais aussi de le comprendre, d'en repérer les différentes composantes, thématiques, esthétiques, idéologiques, d'appréhender comment ces éléments interagissent et produisent notamment un effet sur les spectateurs.
Mais en quoi cette « lecture » filmique se distingue-t-elle de la lecture au sens ordinaire comme de la « lecture » d'autres objets médiatiques ?
On invoque souvent à ce propos le « langage de l'image » qui serait fondamentalement différent du langage verbal (oral ou écrit). Il n'y a cependant pas de « grammaire » de l'image ni de « dictionnaire » qu'il faudrait apprendre ou maîtriser pour décoder les images. Pour voir des images, nous utilisons les mêmes schèmes de perception (visuelle, mais aussi sonore [11]) que nous utilisons dans la vie quotidienne : ce sont nos schèmes sensoriels (profondément enfouis dans le système perceptif) qui nous permettent par exemple de reconnaître un visage sur une photo comme dans la rue, et ce sont nos connaissances générales du monde social qui nous font penser que tel personnage avec un képi et un uniforme, vu à l'écran en deux dimensions, doit être (ou plus exactement doit représenter) un policier en trois dimensions.
Bien entendu, l'image a certaines caractéristiques propres qui méritent d'être relevées : ainsi, tout plan filmique suppose un cadre, un « bord » de l'image qui implique un hors-champ non visible, alors qu'une telle situation est accidentelle dans la vie courante où mon champ visuel semble indéfini, sauf si, bien sûr, j'observe l'animation de la rue à travers une fenêtre... Longtemps, le cinéma a également été en noir et blanc alors que nous voyons (sauf les daltoniens) la vie en couleur. Et les personnages de dessins animés nous apparaissent comme évidemment caricaturaux, très éloignés parfois des personnes rencontrées dans le monde quotidien. Mais ces différences et ces spécificités de l'image sont perçues grâce aux mêmes schèmes de perception sensorielle que nous utilisons dans la vie courante : j'observe la dominante colorée bleue d'une image comme je vois que le ciel est bleu...
Annonciation de Piero della Francesca (1452-66, San Francesco, Arezzo)
Si le simple croyant s'intéresse à l'événement représenté, l'amateur de peinture est quant à lui sensible à la manière de représenter cet événement connu dans toute la chrétienté et à ce qui distingue dès lors cette fresque d'une autre représentation du même sujet chez Fra Angelico, Luca Signorelli, Lorenzo Lotto ou Ambrogio Lorenzetti (cf. notamment l'ouvrage de Daniel Arasse, L'Annonciation italienne: une histoire de perspective, Paris, Hazan, 2010).
Il n'y aurait donc pas de compétences spécifiques à acquérir pour voir des images, comme le confirme l'expérience quotidienne : aucun apprentissage n'est nécessaire pour regarder la télévision, voir un film, apprécier une photo ou parcourir un album illustré. C'est à un autre niveau que la simple vision de l'image (qu'elle soit ou non de nature représentationnelle) que se situent d'éventuels problèmes de compréhension.
Dans une démarche réflexive, il faut néanmoins souligner les caractéristiques propres de l'image, fixe ou animée, qui, dans le cas de la peinture classique, de la photographie ou encore du cinéma, représente un « monde » (objets, personnes, événements) évidemment différent de l'image elle-même, que ce monde soit réel ou imaginaire. De façon spontanée, nous portons en effet notre attention sur ce qui est représenté plutôt que sur la représentation elle-même : je vois par exemple un acteur à l'écran et je m'intéresse à ses faits et gestes, mais je néglige la manière dont il est filmé. Or il y a un art, une technique, une manière de faire propre à la représentation : c'est évident dans le cas de la peinture classique où un sujet religieux comme l'annonciation à la Vierge, évidemment reconnaissable par tous, importe moins, pour les amateurs d'art, que la « manière » qu'ont les différents artistes de représenter cette scène.
La « manière » de filmer – cadrage, point de vue, montage, choix des éclairages et de la lumière... – mérite également au cinéma une attention particulière, notamment parce qu'elle induit chez les spectateurs des effets qui sont perçus généralement de façon confuse et intuitive : ainsi, dans un dialogue entre deux personnages, les moments de tension ou d'émotion sont généralement filmés en plan rapproché, alors que la caméra était auparavant plus éloignée, ce qui renforce le plus souvent l'intensité de la scène telle qu'elle est ressentie par la plupart des spectateurs. Ainsi encore, la musique d'ambiance, qu'on entend, mais qu'on n'écoute généralement pas en tant que telle, contribue grandement à la tonalité (mélancolique, dramatique, angoissante, euphorique...) des événements représentés, sans que nous en soyons le plus souvent conscients. Seule une observation attentive peut dès lors démêler la part des différentes composantes de l'image (sonore et visuelle) qui contribuent aux impressions ressenties.
Une telle observation suppose en outre certaines connaissances techniques : de la même manière qu'en peinture, l'on apprend, le plus souvent par la pratique, la différence entre l'aquarelle, le fusain, le pastel ou l'huile sur toile, il faut certainement savoir ce que sont au cinéma le contraste de l'image, la saturation plus ou moins grande des couleurs, la différence entre un zoom et un travelling, le son multipiste, etc., autant d'éléments qui sont habituellement repris sous l'étiquette de « langage cinématographique » [12]. Cette dernière expression est cependant trompeuse, dans la mesure où le sens de ces multiples traits propres à l'image cinématographique [13] est peu stabilisé et faiblement codifié, et que nombre d'entre eux ne sont pas signifiants, mais seulement donnés à l'appréciation des spectateurs : par exemple, un mouvement de caméra spectaculaire pourra être admiré esthétiquement ou simplement produire une forte impression, mais ne sera pas nécessairement l'objet d'une interprétation comme l'est un élément du langage parlé doté d'une face signifiante et d'une face signifiée.

Othello
un film d'Orson Welles (1952)
On remarque immédiatement l'originalité du cadrage qui consiste à saisir un personnage pratiquement de face, Iago, en même temps que le visage de son interlocuteur, Othello, dans le reflet du miroir. Le miroir légèrement sphérique déforme en outre le visage d'Othello, déformation physique qui symbolise sans doute son malaise psychologique.
Voir une image, observer même attentivement les caractéristiques propres d'une image – ce qui la distingue du monde du monde représenté – peut donc difficilement être considéré comme une compétence spécifique qui devrait être acquise et exercée par un apprentissage explicite : nous voyons immédiatement la différence entre une photo en noir et blanc et une photo en couleur, entre un plan large et un gros plan, même si nous ne connaissons pas les termes exacts pour dénommer ces différences. En revanche, l'interprétation d'une image et de ses multiples composantes implique des compétences qui sont nécessairement acquises progressivement par les différents spectateurs : comprendre, et non pas simplement percevoir, l'utilisation d'un élément cinématographique comme un travelling suppose en effet que l'on s'interroge sur l'intention du cinéaste (défini comme l'auteur du film), sur les effets qu'il a voulu éventuellement produire sur les spectateurs, sur les raisons esthétiques ou autres qui l'ont poussé à faire un tel choix plutôt qu'un autre (par exemple qu'un plan fixe). Une telle réflexion sur le sens [14] de l'image suppose des compétences qui dépassent l'image elle-même (et son supposé « langage ») et portent dans ce cas sur l'intentionnalité de leur auteur qui peut être motivé par des raisons d'ordres extrêmement différents (esthétiques, philosophiques, idéologiques, psychologiques...).
L'interprétation des images ne repose donc pas sur un « langage » qui serait commun à toutes les images – peinture, photographie, cinéma... –, mais se fonde sur les différents contextes où elles apparaissent et qui eux-mêmes ne sont pas le plus souvent des images. Ainsi, pour voir et comprendre une photo de famille, il me suffit de reconnaître les personnes représentées et de distinguer éventuellement à l'arrière-plan le paysage où la photo a été prise et que le photographe m'aura généralement désigné verbalement : « c'est le Ponte Vecchio à Florence... » L'interprétation de ce genre d'images s'appuie sur des éléments contextuels – des visages familiers, des lieux évoqués... – qui relèvent de notre connaissance générale du monde, mais qui ne sont pas des images au sens propre du terme [15]. Bien entendu, chaque spectateur peut, en fonction de ses connaissances et de ses compétences propres, convoquer des contextes d'interprétation très différents : l'historien qui regarde aujourd'hui des photographies anciennes de famille y voit d'autres choses – des costumes, des attitudes, des manières d'être, des décors... – qui passaient inaperçues aux yeux des contemporains ou qu'ils jugeaient sans intérêt.
Cyrano de Bergerac
un film de Jean-Paul Rappeneau (1990)
Ces deux images – l'une du début du film, l'autre de la fin – doivent être reliées entre elles par le spectateur: il doit comprendre notamment qu'il s'agit des mêmes personnages même s'ils ont vieilli, mais aussi en quoi leur relation ancienne s'est transformée. Ce travail d'interprétation n'est pas fondamentalement différent de celui que nous devons mettre en œuvre pour comprendre la pièce originale d'Edmond Rostand.
Si l'on considère à présent le cinéma, on comprend facilement que les images – celles d'un plan ou même d'une séquence – s'inscrivent dans un « objet » médiatique beaucoup plus large, le film dont nous devons reconstituer progressivement la signification d'ensemble. Chaque image interagit avec les autres – qu'elles soient d'ailleurs de nature visuelle ou sonore –, et c'est cette interaction qui nous permet d'interpréter les événements représentés de façon cohérente. En cela, le film peut être rapproché de textes hautement élaborés comme les romans ou les pièces de théâtre. Comprendre un roman, ce n'est pas seulement lire des mots ou des phrases isolés, mais c'est les relier avec les informations qui suivent et qui précèdent, c'est les intégrer dans l'architecture d'ensemble du texte, dans une hiérarchie complexe qui subordonne certains éléments à d'autres et qui constitue ce qu'on peut appeler une structure sémantique de haut niveau. Et voir un film implique également que l'on fasse de multiples inférences pour relier les différents plans entre eux, pour les organiser en séquences, pour les ordonner, dans une architecture invisible (de nature fondamentalement sémantique) qui permet d'interpréter ce qui se présente à première vue comme un kaléidoscope d'images et de sons.
Comprendre un film, c'est d'abord comprendre un « texte » [16], c'est-à-dire construire au cours du processus de réception un ensemble sémantiquement organisé et hiérarchisé qui permet de relier de façon cohérente les différents éléments qui le composent. Il s'agit là bien sûr d'une compétence qui mérite d'être développée, certains films, certains romans, certains textes étant plus élaborés que d'autres : si de nombreuses réalisations cinématographiques reposent sur des conceptions manichéennes ou simplistes de l'existence, d'autres en revanche nous montrent des personnages complexes, ambivalents, dont les motivations doivent être reconstituées de façon plus ou moins hypothétique par les spectateurs.
Plus significativement, un film a un auteur, cinéaste ou réalisateur, qui n'apparaît pas à l'écran et dont les intentions doivent également être interprétées par les spectateurs, aussi bien d'un point de vue idéologique qu'esthétique : voir un film aussi célèbre que Citizen Kane d'Orson Welles doit amener le spectateur à s'interroger sur le propos du film – pourquoi le cinéaste s'est-il intéressé à ce personnage ? est-ce une critique de sa mégalomanie ? ou la description de la face cachée d'un magnat de la presse et de son échec ? est-ce une évocation d'une enfance perdue ? ou rien de tout ça ? – mais également à réfléchir sur un certain nombre de choix esthétiques du cinéaste comme la structure en flash-back, l'utilisation de la profondeur de champ grâce à des objectifs grand-angle, la prédilection pour les plans-séquences, le recours à une photographie contrastée et expressionniste, autant de traits longuement analysés par André Bazin, mais qui font encore aujourd'hui l'objet d'interprétations différentes [17]. Apprécier de tels choix suppose que l'on ait conscience du rôle de l'auteur du film et que l'on s'interroge sur les raisons qui ont pu motiver ces choix plutôt que d'autres. Bien entendu, nous postulons pour une telle appréciation que ces choix ne s'expliquent pas de façon isolée et s'inscrivent dans un projet esthétique cohérent. En cela, les compétences que l'on doit mettre en œuvre pour comprendre un film comme un objet esthétique ne sont pas foncièrement différentes de celles que l'on met en œuvre pour la lecture – avertie – d'un roman.
Ce qu'on appelle de manière imprécise le « langage cinématographique » distingue bien le texte filmique du roman ou même du théâtre, mais ce langage, loin de se réduire aux seules images, se caractérise par la combinaison de multiples « langages » ou plus exactement par l'hétérogénéité fondamentale de ses composantes : il y a bien sûr les images, mais également la bande-son qui rassemble, souvent de façon complexe, des paroles, des bruits, des musiques. Même s'il y a quelques exemples de films sans paroles (Koyaanisqatsi ou Powaqqatsi de Godfrey Reggio, réalisés en 1982 et 1988), il suffit de couper le son d'un film pour prendre conscience de l'importance des dialogues pour la compréhension globale du récit, mais également des motivations des personnages ou des liens entre les différentes séquences. On remarquera par ailleurs que l'image est elle-même hétérogène, représentation de choses, mais également de textes écrits même s'ils apparaissent souvent de façon ponctuelle : on se souviendra par exemple que le cinéma muet n'a pas pu – à quelques rares exceptions près [18] – se passer du support des intertitres pour raconter des histoires.
En outre, l'image étant très généralement représentative – représentation de choses et d'événements –, elle reproduit indirectement les significations de ce qu'elle représente : lorsqu'au début des Affranchis de Martin Scorsese (1990), une séquence pratiquement muette nous montre trois personnages circulant en auto qui entendent bientôt des bruits anormaux et qui s'arrêtent pour ouvrir le coffre et abattre la personne qui y était enfermée, notre connaissance générale du monde nous permet de comprendre rapidement qu'il s'agit d'un acte illégal, que les trois personnages doivent être des bandits ou des mafieux et qu'ils viennent d'assassiner la victime gravement blessée d'un règlement de comptes. Le sens de cette courte séquence ne résulte pas, on le comprend facilement, des images elles-mêmes, mais des « choses » représentées, porteuses quant à elles de multiples significations sociales qui nous permettent de savoir notamment ce qu'est un acte illégal et comment se comporte de manière générale un criminel : sans la maîtrise de ces significations sociales, le spectateur, un très jeune enfant par exemple (à qui l'on déconseillerait cependant la vision de ce film de Scorsese...), ne pourrait pratiquement rien comprendre à cette séquence.
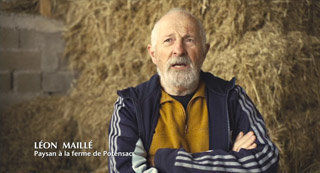
Tous au Larzac
un documentaire de Christian Rouaud (2011)
Le cinéma est un média hétérogène: il y a l'image bien sûr, mais il y a aussi ce que dit la personne filmée et qui est ici certainement aussi important que l'image, et enfin il y a du texte qui s'inscrit en bas à gauche de l'écran pour préciser qui est la personne interviewée.
Cette hétérogénéité distingue notamment le cinéma de la littérature qui recourt à des énoncés explicites [19] alors que le film montre ou fait entendre plusieurs choses en même temps en laissant d'ailleurs au spectateur le soin de distinguer entre les « informations » pertinentes et celles qui sont secondaires ou inessentielles : un personnage à l'écran a nécessairement un costume, une expression faciale, une gestuelle, il apparaît dans un décor plus ou moins visible, sous un certain angle, dans une lumière caractéristique, autant d'éléments qui peuvent se révéler significatifs. Et, si l'on comprend les paroles des personnages, l'on entend également leur timbre de voix qui peut révéler des sentiments ou des émotions qui ne sont pas nécessairement énoncés en tant que tels.
On peut dès lors estimer que l'analyse filmique devrait porter de façon prioritaire sur cette hétérogénéité constitutive du film, d'abord parce que celui-ci est perçu, comme on l'a déjà dit, par la plupart des spectateurs de façon intuitive, implicite et souvent confuse [20], et ensuite parce que l'interprétation de ces différents éléments filmiques peut être plus ou moins approfondie et nécessiter la mise en œuvre de compétences multiples. Quand Stanley Kubrick utilise par exemple la célèbre valse de Johann Strauss, « Le Beau Danube bleu », sur l'image d'un vaisseau spatial dans son célèbre film 2001, l'Odyssée de l'espace (1968), il faut connaître l'origine de cette musique – la cour viennoise à l'époque de sa splendeur – pour percevoir pleinement l'ironie de cette référence musicale. Dans le domaine technique, l'analyse d'un plan-séquence comme celui qui ouvre la Soif du mal d'Orson Welles (1958) ou celui qui clôt Profession : reporter de Michelangelo Antonioni (1975) suppose que l'on maîtrise au moins sommairement les conditions de tournage en 35 mm avec des caméras lourdes et volumineuses portées sur rail ou sur grue, ce qui explique la complexité de la réalisation de tels plans [21] que l'on peut en conséquence qualifier de virtuoses : bien entendu, la prouesse technique doit être appréciée plus largement d'un point de vue esthétique, de tels plans s'inscrivant dans l'architecture générale du film dont ils contribuent à éclairer le sens [22].

Million Dollar Baby
un film de Clint Eastwood (2004)
La jeune boxeuse s'entraîne sur un speed bag qu'elle frappe à plusieurs reprises, tout en discutant avec l'entraîneur qui vient de la rejoindre. Par trois fois, celui-ci immobilise le speed bag d'un geste qui semble tout à fait naturel mais qui a certainement une portée symbolique.
Beaucoup d'autres éléments, pourtant visibles à l'écran, sont également souvent négligés ou interprétés de manière sommaire : les costumes, les décors, les accessoires, les gestuelles sont ainsi compris de façon étroitement réaliste – le personnage porte « simplement » le costume de sa fonction sociale – alors que nombre de ces éléments sont choisis par le réalisateur pour exprimer des différentes valeurs ou significations symboliques. On citera à ce propos une séquence de Million Dollar Baby de Clint Eastwood (2004) où l'on voit Maggie, une jeune boxeuse, discuter au cours d'un entraînement avec Frankie qu'elle veut convaincre de devenir son coach : la scène semble tout à fait « réaliste » puisque l'on voit Maggie frapper à plusieurs reprises le « speed bag » qui se trouve entre les deux personnages, mais ce geste, la position des personnages et celle de l'objet entre eux traduisent de façon rythmique l'état de tension psychologique entre eux. Elle frappe à plusieurs reprises, et lui arrête par trois fois le balancement du speed bag comme s'il voulait « calmer le jeu ». Le « réalisme » ne doit pas masquer toute la mise en scène qui utilise des objets, des gestes, des positions pour traduire les émotions qui animent (ou sont censées animer) les personnages [23].
L'on pourrait penser que de telles analyses supposent nécessairement de procéder au visionnement séquence par séquence ou même plan par plan du film. Mais d'autres méthodes permettent d'améliorer les compétences en ce domaine, notamment lorsqu'on s'adresse à un public de non-spécialistes qui ne se destinent pas aux métiers du cinéma : on peut par exemple donner aux spectateurs différentes consignes d'observation avant la projection, chacun ne recevant qu'une seule consigne (différente donc de celles remises aux autres). Après la vision, chacun peut alors faire part de ses observations et les croiser avec celles des autres participants [24]. De telles consignes d'observation – si elles ont été bien construites – permettent d'attirer l'attention des spectateurs sur des éléments qu'ils auraient certainement tendance à négliger, de leur faire percevoir l'hétérogénéité constitutive du texte filmique et enfin d'exercer leurs compétences interprétatives : il s'agit à chaque fois de comprendre la signification d'un trait, qui peut paraître secondaire ou banal, en l'intégrant dans l'ensemble du film.
Les réflexions précédentes ont déjà souligné la différence importante entre la description du film ou de certains éléments filmiques et leur interprétation. Cette distinction est essentiellement méthodologique, car toute observation implique une interprétation immédiate, comme en témoigne le simple fait que nous « voyons » l'image en deux dimensions comme représentant un monde en trois dimensions (avec d'ailleurs des erreurs possibles par exemple dans l'appréciation de la taille des objets représentés). De façon pragmatique, l'on peut néanmoins considérer que le niveau d'observation doit faire l'objet d'un consensus entre les spectateurs et porter principalement sur des traits objectifs, visibles ou audibles, perçus par tous : ainsi, tout le monde s'accordera sur le fait que le film vu est filmé soit en noir et blanc, soit en couleur, ou que tel personnage apparaît dans telle séquence et à tel moment, ou encore que tel plan est filmé en travelling, en panoramique ou de manière fixe.
L'Éléphant et l'Escargot
un court métrage de Christa Moesker (Pays-Bas, 2002)
(repris dans le programme Fables d'été, fables d'hiver)
Un adulte n'aura pas de difficultés à interpréter correctement la taille des animaux apparaissant sur ces deux images, grâce à sa connaissance générale du monde qui lui a appris que les escargots sont beaucoup plus petits que les gros éléphants! Au vu des mêmes images, un très jeune enfant en revanche risquera de se méprendre sur la taille respective de ces deux animaux. Nous interprétons immédiatement l'image en deux dimensions comme représentant un monde en trois dimensions, mais cette interprétation qui nous semble facile et spontanée repose sur un long apprentissage.
L'interprétation en revanche, se veut objective – elle entend rendre compte d'un élément ou d'une structure filmique –, mais elle est hypothétique, car elle vise une signification qui n'est pas observable en tant que telle : les motivations d'un personnage dont seul le comportement nous est montré relèvent de l'interprétation comme c'est également le cas pour les intentions – idéologiques, artistiques, politiques, culturelles... – de l'auteur du film qui n'apparaît pas à l'écran et dont le propos n'est pas explicite. Pareillement, des événements non montrés à l'écran peuvent être inférés par les spectateurs sur base de différents éléments filmiques : tous les enfants se souviennent de la mort de la mère de Bambi (Disney, 1942), tuée par les chasseurs, même si cette mort n'est pas montrée en tant que telle ni même évoquée comme telle (le grand cerf lui dit simplement que sa mère ne sera plus jamais auprès de lui). Intentions, motivations, événements suggérés font donc l'objet nécessairement d'une reconstruction ou d'un processus d'inférence [25] de la part des spectateurs, reconstruction qui est plus ou moins vraisemblable et peut s'appuyer sur des éléments filmiques plus ou moins nombreux, mais qui reste nécessairement hypothétique. Un grand nombre de ces interprétations sont spontanées et ne font pas l'objet d'une réflexion consciente, mais il suffit qu'elles soient contredites par un élément ultérieur pour que nous nous rendions compte que nous avons interprété trop rapidement ce que nous avons vu ou entendu : c'est ainsi que Hitchcock nous fait croire pendant la plus grande partie de Psychose que la mère de Norman Bates est bien vivante – interprétation immédiate de notre part en fonction des indices qui nous sont délivrés par le film –, jusqu'à ce qu'un coup de théâtre nous révèle notre erreur (on nous excusera de révéler la fin de ce film bien connu...).
Enfin, les jugements de valeur que nous pouvons porter sur un film ou sur certains éléments filmiques – son style, son propos, certaines séquences, le jeu des acteurs... – ont un fondement essentiellement subjectif, qu'ils soient de nature esthétique, morale, éthique, religieuse ou politique. J'aime ou je n'aime pas le cinéma fantastique, je juge détestable le propos idéologique de tel cinéaste, j'admire la manière de raconter ou de filmer de tel réalisateur... Le jugement porte très généralement sur des éléments objectifs (ou plus ou moins objectivables [26]), mais l'appréciation reste pour une part irréductiblement subjective : je peux reconnaître que tel plan-séquence constitue une prouesse technique, mais je peux aussi bien le juger admirable qu'artificiel ou maniéré. Ainsi encore, une échelle d'évaluation comme l'originalité permet d'estimer qu'un film de Jean-Luc Godard est plus original d'un point de vue cinématographique que tel autre film de Claude Autant-Lara réalisé à la même époque [27], mais je peux considérer que ce trait n'est pas décisif et que d'autres critères (fluidité du récit, émotions suscitées, lisibilité...) m'importent plus que la recherche de l'originalité artistique (que d'aucuns considèrent comme une forme de snobisme).
Observer |
Interpréter |
Évaluer |
L'observation porte sur des traits objectifs qui perçus par tous les spectateurs. Toute observation implique néanmoins une interpétation spontanée qui pourra être éventuellement remise en question : un décor en perspective peut se révéler n'être qu'un trompe-l'œil, le chant d'un oiseau n'être que le bruit d'un appeau… De façon pragmatique, on estimera qu'un élément est bien observé si tous les spectateurs sont d'accord sur sa présence (ou son absence). |
L'interprétation d'un film ou d'un élément filmique est la construction d'une signification qui n'est pas explicitée dans ou par le film, mais qui, pour le spectateur, rend compte de cet élément filmique. En cela, l'interprétation se veut objective mais elle ne sera pas nécessairement partagée par tous : elle est nécessairement hypothétique puisqu'elle n'est pas observable en tant que telle. On considère généralement qu'une interprétation qui rend compte d'un grand nombre d'éléments filmiques est meilleure que celle qui n'explique que quelques éléments. Dans la même perspective, la cohérence de l'interprétation est en principe un critère de sa validité. |
L'évaluation peut être de nature morale – je juge tel comportement bon ou au contraire mauvais – ou de nature esthétique – je trouve tel objet beau ou contraire laid –. De façon principielle, on doit considérer qu'une évaluation a un fondement irréductiblement subjectif, même si cette évaluation est partagée par un grand nombre d'individus. Certaines sociétés considèrent que le cannibalisme est une « bonne » chose, sinon une chose sacrée. Certaines personnes aiment la musique classique tandis que d'autres préfèrent le rap. Aucune argumentation ne parviendra à donner raison à l'une contre l'autre. |
En termes de compétences, l'on peut penser que cette triple distinction – description, interprétation, évaluation – est essentielle à maîtriser dans l'abord des films, mais également des œuvres d'art et des productions médiatiques en général : comme spectateur, l'on doit apprendre à se méfier de ses interprétations immédiates qui, si elles ne sont pas nécessairement fausses, sont pour une part hypothétiques et ne sont pas nécessairement partagées par tous ; par ailleurs, nos évaluations, que nous croyons le plus souvent objectivement fondées (puisqu'elles portent sur des traits objectifs), ont un fondement irréductiblement subjectif et méritent d'être discutées en explicitant notamment les critères sur lesquels elles reposent.
On considérera également que l'interprétation du film comme un ensemble textuel de haut niveau, dont la signification implique un travail de reconstruction et d'inférence important, constitue une compétence essentielle pour l'analyse filmique. Enfin, il faut certainement mettre l'accent, comme on l'a vu, sur l'hétérogénéité du cinéma qui recourt à de multiples langages d'une manière qui reste le plus souvent inaperçue par la plupart des spectateurs : une observation attentive de cette hétérogénéité est un exercice d'analyse parfois difficile à mener, mais certainement pertinent, permettant à chacun de prendre une distance critique par rapport aux films vus.
L'analyse filmique portant sur un objet singulier – un film – semble relever principalement de la « lecture » (au sens entendu ici), mais l'on va voir que la « navigation » entre objets médiatiques (films ou autres) représente un outil particulièrement intéressant en la matière. On remarquera immédiatement que la navigation est une démarche spontanée lorsqu'on choisit de regarder un film : tout choix en effet implique qu'on sélectionne un titre, un film, un genre, parmi d'autres films ou médias jugés en l'occurrence moins intéressants. La télécommande qui nous permet de passer d'une chaîne de télévision à l'autre est sans doute l'instrument exemplaire de la navigation, mais les revues de cinéma, les affiches à l'entrée des salles, les bandes-annonces sur écran ou sur ordinateur permettent de la même manière de sélectionner un film parmi une offre plus ou moins large. Ce choix peut être le fruit du hasard comme lorsqu'on tombe en arrêt sur un film en zappant de chaîne en chaîne, mais il repose le plus souvent sur une connaissance générale du paysage cinématographique et plus largement médiatique : si l'on excepte les tout jeunes enfants qui découvrent le monde et dont les parents orientent le plus souvent les choix, nous reconnaissons, souvent après quelques images à peine, le « genre »» (au sens le plus large) du film, et nous pouvons rapidement dire s'il s'agit d'un documentaire ou d'une fiction, d'un film récent ou d'un classique, d'un dessin animé, d'un film d'animation (avec des figurines en plastiline par exemple) ou d'un film en prises de vue « réelle », d'un film fantastique, policier, de science-fiction, d'un western, d'un film de guerre, d'un film réaliste, social ou psychologique ou d'une autre sorte encore...

Le Couperet
un film de Constantin Costa-Gavras (2004)
Différents indices – les gestes, la présence d'acteurs plus ou moins connus, l'éclairage, le revolver bien sûr – nous permettent de repérer qu'il s'agit là d'un film de fiction et plus précisément d'un film policier. Classer un film comme « fiction » ou comme « polar » ne peut se faire qu'en le situant dans un paysage cinématographique et culturel beaucoup plus large, par une opération qui relève de la « navigation médiatique » (dans le sens où on l'entend ici).
Dans le flux continu de la télévision, nous sommes en outre capables de distinguer un film « de cinéma » des autres réalisations télévisuelles comme le journal d'information, les émissions de divertissement, les retransmissions sportives, les publicités ou même les séries télévisées. Nous situons ainsi le film que nous découvrons dans un paysage médiatique et cinématographique déjà élaboré, même si cette découverte nous amène parfois à remodeler certaines « cases » de ce paysage. Nous maîtrisons en effet une série d'indices génériques ou stylistiques qui nous permettent de caractériser et de catégoriser rapidement la plupart des films que nous voyons plus ou moins par hasard : c'est le cas en particulier de la fiction qui se signale par des traits comme l'absence de regard adressé à la caméra et l'indifférence générale des acteurs à la présence de cette caméra, la qualité de la photographie et des éclairages, l'ubiquité de la caméra, le caractère audible des voix ou encore la présence d'une musique d'ambiance à la sonorité amplifiée de façon idéale, même si tous ces traits ne sont pas nécessairement présents et si certains films jouent précisément sur les limites entre genres (comme le film C'est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde, Rémy Belvaux et André Bonzel imitant de façon parodique les caractéristiques d'un certain type de reportages télévisuels).
Mais d'autres comportements habituels des spectateurs relèvent également de la « navigation » : ainsi, beaucoup d'entre eux reconnaissent les noms des acteurs (ou des actrices) qui leur plaisent, et ils s'y réfèrent pour le choix de nouveaux films à voir. Semblablement, les enfants retrouvent avec plaisir les mêmes personnages de dessins animés, et les adultes sont souvent sensibles aux suites des réalisations à succès (Rambo, Alien, Star Wars, Halloween, Indiana Jones...). Les cinéphiles quant à eux préfèrent retenir les noms des cinéastes qu'ils élèvent au rang d'auteurs ou d'artistes, car ils les considèrent comme les véritables créateurs des films (au détriment des acteurs, des scénaristes et des autres techniciens qui ont participé à ce travail collectif). D'autres recourent à des genres de prédilection, parfois définis de manière très fine – thriller, film gore, burlesque, film d'auteur, cinéma expérimental, « steampunk », film biographique ou biopic, péplum, films de superhéros... –, pour parler d'un film, pour l'évaluer en comparaison avec d'autres, pour le situer éventuellement dans un ensemble plus large.
Catégoriser un film ou une œuvre d'art peut sembler réducteur, et les cinéastes comme d'autres artistes prétendent souvent se jouer des limites établies et réaliser des œuvres « inclassables ». Mais de telles affirmations méritent d'être nuancées sinon critiquées : il n'y a pas en effet de connaissance possible sans catégorisation, mais cela ne signifie évidemment pas que l'on mette les choses – et notamment les films – dans des « cases » étroites ou restrictives. On peut même dire qu'apprécier un film implique au contraire la maîtrise de catégories multiples et extrêmement affinées. Une comparaison, peut-être un peu caricaturale, permet d'éclairer ce point : alors que, pour une personne novice en matière d'œnologie, il n'y a guère que deux ou trois grandes catégories (vin blanc, vin rouge... et rosé), un amateur éclairé est quant à lui capable de distinguer différents vins selon leurs cépages, mais également selon leurs terroirs et même leurs millésimes. Bien entendu, un tel savoir s'acquiert progressivement, par une pratique de dégustation répétée (même si elle s'accompagne très généralement de la maîtrise d'un vocabulaire technique) et reste très variable selon les connaisseurs. Semblablement, un cinéphile est capable d'identifier un grand nombre de films différents, de distinguer des genres et des auteurs, de faire des nuances entre les œuvres d'un même cinéaste en fonction du moment de sa carrière où elles ont été réalisées. Un « amateur » est précisément celui qui est capable d'établir des distinctions dans un ensemble de productions perçues par d'autres de façon confuse comme un genre indistinct [28].
Rosetta
un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne (1999)
Moi, Daniel Blake
un film de Ken Loach (2016)
Ces deux films qui mettent en scène des personnages socialement défavorisés seront facilement qualifiés de «réalistes», mais l'analyse filmique va précisément s'appuyer sur une comparaison entre ces deux films (et bien d'autres) pour déterminer leurs différences et définir ainsi leur spécificité propre.
Pour apprécier l'originalité d'un film, pour percevoir sa singularité, il faut précisément le comparer à l'ensemble des réalisations dont il se distingue de façon plus ou moins nette. L'analyse filmique ne peut donc pas se passer d'une « navigation » dans le paysage cinématographique pour souligner les traits distinctifs de l'œuvre envisagée. Cette navigation peut se faire à travers la filmographie d'un auteur comme Alfred Hitchcock dont on distingue classiquement la période britannique et la carrière à Hollywood, ou John Ford dont les westerns « classiques » (La Chevauchée fantastique, 1939, Sur la piste des Mohawks, 1939, La Poursuite infernale, 1946...) semblent s'éloigner des westerns plus tardifs, souvent perçus comme « crépusculaires », comme La Prisonnière du désert (1956), L'Homme qui tua Liberty Valance (1962) ou encore Les Cheyennes (1964) [29]. Mais l'histoire des genres cinématographiques doit également être prise en considération si l'on veut mesurer correctement l'originalité d'un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qui, par la qualité de ses effets spéciaux, tranchait de manière décisive avec l'aspect médiocre des « séries B » caractéristiques de la science-fiction de l'époque. Bien entendu, un film n'appartient pas nécessairement à un seul genre, à une seule « catégorie », et 2001 prend place dans l'histoire de la science-fiction, mais constitue également un jalon important dans la carrière de Stanley Kubrick tout en récupérant une partie de l'héritage du cinéma expérimental de l'époque (qui se remarque notamment à travers le rythme très ralenti de certaines séquences ou le caractère volontairement énigmatique de l'ensemble).
L'analyse filmique suppose donc une certaine compétence en « navigation », en particulier la capacité à situer le film dans différents genres, dans différentes « séries » (par exemple l'œuvre d'un cinéaste), dans différentes « catégories », même si celles-ci doivent être considérées comme des constructions historiques et culturelles éminemment variables, souvent floues et aux frontières poreuses. On doit par ailleurs considérer qu'il s'agit là d'une véritable compétence – « se repérer dans le paysage cinématographique » – et non pas seulement d'une connaissance générale de l'histoire du cinéma (même si cette connaissance est indispensable) dans la mesure où il s'agit d'opérer des rapprochements pertinents entre le film analysé et d'autres réalisations qui peuvent paraître dans certains cas fort éloignées. Ainsi, à l'intérieur de l'œuvre d'un même cinéaste, il faut une réflexion complexe pour percevoir à la fois les innovations, mais aussi les continuités moins apparentes. On se souvient par exemple que les critiques des Cahiers du cinéma [30] ont érigé dans les années 1950 un cinéaste comme Howard Hawks au rang d'auteur alors que son œuvre était apparemment fort hétéroclite (western, comédie, film de guerre, film policier, drame, comédie musicale...) : ils devaient souligner par exemple la permanence du même type de personnages – des hommes porteurs d'une rigueur morale inaperçue mais obstinés à « faire le travail » ou à accomplir leur mission, quelles qu'en soient les conséquences –, l'importance d'un groupe d'individus qui se constitue dans l'épreuve, ou encore la présence de personnages de femmes libres, indépendantes, déterminées et prêtes à la confrontation avec leurs homologues masculins. Ces analyses aujourd'hui classiques peuvent être discutées, mais elles reposent sur un principe de « navigation » et permettent de souligner des traits ou des caractéristiques qui n'apparaissent qu'à travers un travail de comparaison filmique.

Stupeur et Tremblements
un film d'Alain Corneau (2003) avec Sylvie Testud

La Jeune Fille à la perle
un film de Peter Webber avec Scarlet Johansson (2003)
La beauté physique des actrices joue incontestablement un rôle dans leur carrière, mais seule une «navigation» à travers un grand nombre de films peut mettre ce phénomène en évidence de façon objective. Cette «prime» à la beauté joue également pour les acteurs masculins, même si c'est sans doute de façon moins nette, et on laissera aux lecteurs et lectrices le soin d'apprécier la présence de Colin Firth dans ce film.
Si le cinéaste comme auteur est une figure privilégiée par la critique cinématographique, on ne négligera par les carrières d'acteurs qui éclairent (au moins en partie) les choix de casting qu'opèrent précisément les réalisateurs (souvent avec l'aide de leurs assistants) : une figure aussi simple que celle du contre-emploi – l'acteur comique, Bourvil, incarnant un rôle dramatique dans le Cercle rouge de Melville, le modèle de la probité, Henry Fonda, jouant un vrai salaud, assassin d'enfant, dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone... – suppose que le spectateur connaisse un tant soit peu la carrière de l'acteur en cause.
De façon plus large, l'on remarque que le cinéma privilégie certains types d'acteurs – jeunes et élégants – et d'actrices – jeunes et jolies –, réduisant de fait le nombre de rôles dévolus aux personnes âgées ou au physique moins avantageux : un film comme The Lady In The Van de Nicholas Hytner avec Maggie Smith apparaît comme une exception dans le paysage cinématographique, et le choix d'une actrice comme Sylvie Testud dans Stupeur et tremblements d'Alain Corneau révèle a contrario combien les personnes au physique « ordinaire » ou « quelconque » sont sous-représentées à l'écran. Ces phénomènes semblent évidents, mais ils ne peuvent être réellement démontrés dans le cadre d'une analyse filmique isolée [31] : seule une « navigation » opérée dans l'ensemble du paysage cinématographique, telle que l'opèrent notamment les gender studies [32], permet de dépasser ces affirmations sommaires et de repérer comment se construisent ces représentations sociales et culturelles souvent complexes – toutes les actrices ne sont pas réduites au rang de ravissantes idiotes, ce qui n'empêche pas de multiples distorsions entre rôles masculins et féminins – qu'on peut alors qualifier de stéréotypes ou de clichés.
Le cinéma d'auteur se veut généralement en rupture avec les « clichés », les « ficelles » ou les « formules toutes faites » du cinéma « commercial ». Mais cela n'empêche pas qu'il reproduise certains stéréotypes sociaux, souvent de façon inconsciente ou souterraine. Ainsi, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont mis en avant des actrices – Jean Seberg, Anna Karina, Bernadette Lafont ou même Brigitte Bardot... – dont le « naturel » tranchait avec l'apparence extrêmement travaillée des actrices de la génération précédente – Martine Carol, Danielle Darrieux, Simone Signoret... –, mais dont la beauté et le charme étaient également évidents. De façon plus anecdotique, on remarquera également que c'est un cinéma où les personnages masculins, mais aussi féminins fument beaucoup, se promenant très souvent la cigarette au coin des lèvres, une manie qui a perduré bien au-delà des années 1960 : si des raisons cinématographiques pouvaient expliquer cet état de fait – donner une apparence à la fois décontractée, adulte, concentrée et légèrement distanciée au personnage –, ce choix reproduisait également – sans doute de façon involontaire – l'image positive que les campagnes publicitaires des cigarettiers entendaient donner de leur produit. C'est en 1950 en effet qu'apparaissent les premières études scientifiques établissant la dangerosité du tabac et en particulier son influence sur l'apparition du cancer du poumon. L'image du tabac change à ce moment-là, passant de produit « sain » à celle d'un produit dangereux : mais prendre des risques est aussi une manière de s'affirmer – je n'ai peur de rien –, et c'est sans doute cette image-là que le cinéma va longtemps privilégier, en mettant en scène des jeunes gens insouciants, « rebelles », refusant de « calculer » ou de « s'économiser » comme leurs parents, prêts à affronter la mort à travers le geste léger et anodin de fumer une cigarette. On ne prétendra donc pas que les cinéastes de la Nouvelle Vague ou autres ont fait directement de la publicité pour le tabac, mais qu'ils ont plutôt joué sur certaines valeurs – ici la prise de risque – associées au tabac, même si au final ils ont contribué, de façon difficilement mesurable, à sa popularité.
La navigation dans le paysage cinématographique est, on vient de le montrer, nécessaire pour apprécier l'originalité esthétique plus ou moins marquée d'un film. Mais elle permet également d'analyser des phénomènes transversaux comme des thématiques plus ou moins largement représentées au cinéma. Un exemple classique est celui de la violence à l'écran. La perception de la violence d'un film dépendra pour une part de la sensibilité individuelle, mais elle est étroitement liée au contexte où elle apparaît, au genre du film, à l'époque où elle est mise en scène, à la « concurrence » qui peut également exister entre les films sur cette question. Les spectateurs ne seront certainement pas marqués de la même manière par des films d'horreur dits de série B ou par des films de guerre ayant une forte prétention réaliste comme Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg (1998) dont les vingt premières minutes de la reconstitution du débarquement allié en Normandie sont encore dans bien des mémoires.
L'évolution d'un genre comme le film de guerre hollywoodien est intéressante à analyser de ce point de vue : alors que la violence des combats est largement édulcorée dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, elle apparaîtra de manière inattendue au cours des années 1960 dans les foyers américains avec les reportages télévisuels sur la guerre du Viêt-nam. Ceux-ci imposeront par contrecoup au cinéma une représentation beaucoup plus sanglante de ce type d'événements dans des genres pourtant éloignés comme le policier (Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 1967) ou le western (La Horde sauvage de Sam Peckinpah en 1969 ou Soldier Blue de Ralph Nelson en 1970, critique à peine voilée du militarisme américain), puis dans les films de fiction retraçant l'un ou l'autre épisode de la guerre du Viêt-nam (Platoon d'Oliver Stone en 1987 ou Full Metal Jacket de Stanley Kubrick en 1987). C'est dans un tel contexte profondément modifié que Steven Spielberg mettra en scène un épisode déjà glorifié de la Seconde Guerre mondiale dans Le jour le plus long du producteur Darryl F. Zanuck, mais cette fois en ne masquant aucun trait de la violence et de la brutalité des combats, qu'il s'agisse des corps mutilés ou démembrés, du sang répandu, des blessures profondes et non soignables, des individus brûlés vifs ou encore des prisonniers brutalement abattus. Cette évolution historique, résumée ici de façon sommaire, permet de comprendre pourquoi on a estimé dans les années 1950 qu'un cinéaste comme Samuel Fuller avait donné dans ses films (J'ai vécu l'enfer de Corée et Baïonnette au canon, 1951) une représentation très réaliste et bien informée de la guerre de Corée, alors que ses films nous paraissent aujourd'hui très édulcorés par rapport aux films que l'on vient de citer : Fuller, qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, était allé aussi loin dans la représentation de la violence militaire que le permettait le système hollywoodien de l'époque, en privilégiant de multiples détails quotidiens [33] sans doute inspirés de sa propre expérience et absents des films plus « héroïques ». Il ne faudrait cependant pas conclure de manière simpliste à une représentation de plus en plus « réaliste » ou de plus en plus « sanglante » de la violence au cinéma, d'abord parce que certains films anciens ont pu dans des genres précis – le documentaire avec Nuit et Brouillard d'Alain Resnais en 1956 ou le film d'horreur avec les Yeux sans visage de Georges Franju [34] en 1960 – montrer des images proprement insoutenables, et parce qu'ensuite le genre du film – film d'horreur, film gore, film de guerre, film policier, film de fiction ou film à prétention réaliste, comédie parfois... – modifie grandement notre perception du caractère plus ou moins insupportable de la mise en scène de la violence.
L'analyse filmique étudiera bien sûr la manière spécifique dont chaque film représente la violence, mais on voit bien qu'elle ne peut faire abstraction de toutes les autres images et représentations de la violence – filmiques, mais aussi télévisuelles, vidéographiques, photographiques, littéraires, artistiques... – avec lesquelles les spectateurs ne manqueront pas d'établir des comparaisons. Ainsi, en situation d'animation, il est intéressant de demander aux participants non seulement de juger du degré de violence du film abordé (et d'analyser les procédés utilisés), mais également de citer les « images » qui ont le plus marqué leur mémoire et qui leur servent d'une certaine manière d'étalon de mesure : l'expérience (même limitée [35]) montre que beaucoup de spectateurs citent des films d'horreur qu'ils ont vus enfants ou jeunes adolescents sous la pression de compagnons plus âgés ; mais beaucoup citent également les images des camps de concentration nazis dont l'impact est aujourd'hui encore particulièrement fort. La navigation, surtout quand elle se fait de manière explicite, permet ainsi d'opérer des comparaisons plus ou moins pertinentes entre différents films ou objets médiatiques extrêmement divers et de mettre en évidence des principes de structuration et de hiérarchisation : il est clair par exemple que des images authentiques (ou supposées telles) auront un plus grand poids que des films de fiction, aussi spectaculaires soient-ils.

La Haine
un film de Mathieu Kassovitz (1995)
et ci-dessous la couverture d'un magazine belge paru à la même époque

La navigation, telle qu'illustrée dans l'exemple précédent, prenait déjà en compte des médias de différents types, cinéma mais aussi télévision et photographie. Le cinéma n'est pas un monde clos, même s'il s'agit d'un champ de production relativement autonome, et chaque film apparaît dans un paysage médiatique par rapport auquel il prend position, même si c'est de façon peu explicite. Quand Mathieu Kassovitz réalise en 1995 la Haine où il raconte la journée de trois jeunes de banlieue dont l'errance se terminera tragiquement par la mort violente d'un des trois protagonistes abattu par un policier, le film s'inscrit dans un contexte médiatique dominé par la question des « banlieues » (françaises) secouées par des émeutes, mais également marquées par la répétition des « bavures » policières. Le film de Kassovitz [36] prend cependant le contrepied des reportages télévisuels de l'époque à la recherche d'images frappantes ou spectaculaires (notamment de voitures incendiées), et il débute précisément quand l'émeute de la veille est terminée : c'est une journée « normale » qui commence, et elle ne sera ponctuée que d'événements quotidiens et banals (même s'ils sont significatifs d'un climat plus large). Et le film se terminera par une nouvelle bavure policière dont on ne verra cependant pas les conséquences. Le point de vue du cinéaste est évidemment très proche de celui de ces trois jeunes (même s'ils ne prétendent pas représenter l'ensemble de la jeunesse des banlieues comme on a pu le reprocher indûment à Kassovitz) et constitue une prise de position politique (au sens fort) à l'opposé de la vision des médias télévisuels, qui était à la fois superficielle (« les banlieues brûlent ») et proche du pouvoir étatique (« les Français moyens ont peur... ») [37].
L'exemple paraît sans doute évident dans la mesure où la situation [38] évoquée dans le film est bien connue d'une majorité de spectateurs. Mais la relation peut être beaucoup moins explicite, et c'est alors aux spectateurs d'imaginer les différents contextes permettant d'éclairer le sens du film envisagé. Dans le Fils réalisé en 2002, Jean-Pierre et Luc Dardenne imaginent un formateur en menuiserie prenant en apprentissage un jeune adolescent dont on comprend bientôt qu'il est le meurtrier de son fils ! Tout le film va jouer sur une tension créée par notre interrogation sur les intentions muettes d'Olivier, le personnage principal : veut-il se venger ? veut-il punir le coupable ? veut-il comprendre l'adolescent mutique ? L'issue de l'intrigue sera cependant une forme de pardon, sans doute ambigu, mais dont le sens s'éclaire si l'on compare le film des Dardenne à d'autres films en apparence très éloignés et d'un genre tout à fait différent, à des bandes dessinées ou même à des faits divers rapportés par la presse. Le thème de la vengeance est en effet extrêmement présent dans les médias et au cinéma en particulier [39] : au moment de la sortie du Fils, les spectateurs pouvaient se rappeler des films comme Un justicier dans la ville de Michael Winner (avec Charles Bronson, 1974, vu et revu à la télévision), Josey Wales hors-la-loi de Clint Eastwood (1976), Gladiator de Ridley Scott (2000, avec Russell Crowe), Payback de Brian Helgeland (1999, avec Mel Gibson) et bien d'autres titres encore. Bien que très différents, tous ces films présentaient certaines constantes comme un fort manichéisme qui fait du coupable dont le héros cherche à se venger un être foncièrement mauvais et détestable, ainsi qu'une impossibilité d'utiliser des moyens légaux, ce qui oblige le personnage à recourir à une vengeance individuelle. Par ailleurs, en Belgique, l'affaire Dutroux était encore dans toutes les mémoires, ayant révélé notamment de graves carences judiciaires et suscité une forte indignation dans l'opinion publique. On peut parler d'un contexte latent de légitimation de la vengeance par la fiction cinématographique, mais aussi par le traitement médiatique des faits divers, contexte dans lequel le film des Dardenne apparaît comme porteur d'un questionnement sur la nature du mal et la manière d'y réagir: là où un discours manichéen domine, ils vont au contraire chercher à susciter une suspension au moins temporaire du jugement moral [40]. La comparaison entre le Fils et les autres films évoqués doit alors se faire au niveau du « contenu » (intrigue, propos du film, point de vue des différents cinéastes...), mais également de l'esthétique cinématographique : là où un cinéma bavard explicite de façon très claire les motivations des personnages et souligne la nature foncièrement mauvaise des criminels mis en scène, la caméra des Dardenne suit au plus près Olivier, un personnage mutique, dont les gestes nous sont montrés de façon brute et ambiguë. Proches du personnage, nous sommes pourtant obligés de nous interroger sur ses motivations et de suspendre comme lui notre jugement sur le personnage qui lui fait face, le jeune Francis dont la nature « criminelle » est également questionnée. La comparaison entre films appartenant à des genres très différents (cinéma d'auteur/cinéma d'aventures spectaculaires) relève donc de la « navigation » au sens entendu ici et révèle la portée signifiante de styles cinématographiques (explicite/distancié) très contrastés.

Oliver Twist
un film de Roman Polanski (2005)
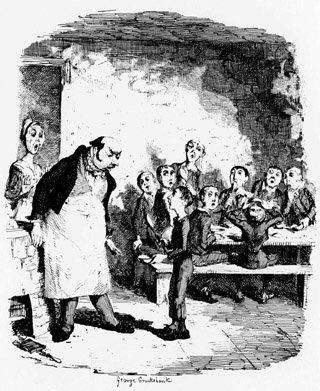
Une illustration de George Cruikshank pour le roman de Charles Dickens
Dans la culture scolaire, l'exercice classique de « navigation » entre genres ou entre médias consiste à comparer un texte littéraire avec son adaptation cinématographique pour en souligner les différences notamment en termes de « langages », écrit d'une part, audiovisuel de l'autre [41]. Un tel exercice est cependant souvent austère et artificiel : lorsque nous voyons un film, nous ne nous empressons pas de lire le roman dont il est éventuellement tiré ! D'autres types de « navigation », sans doute moins évidents, méritent dès lors qu'on s'y attarde. Ainsi, l'on peut utiliser le domaine pictural pour trouver d'utiles points de comparaison avec un film. En 2005, Roman Polanski a proposé une nouvelle adaptation du célèbre roman de Charles Dickens, Oliver Twist : si la comparaison avec l'œuvre originale semble s'imposer, elle est pourtant lourde à mettre en œuvre ne serait-ce qu'à cause du volume du roman original (qui a d'ailleurs souvent été abrégé dans les éditions pour enfants) ; il est en revanche très facile de rapprocher le film des gravures de George Cruikshank (1782-1878) qui a illustré les premières éditions du livre. Une série de ressemblances et de différences apparaissent facilement [42] : si les gravures ont souvent un trait caricatural, on remarque des similitudes troublantes entre certaines d'entre elles et plusieurs séquences du film, et il semble dès lors évident que le cinéaste s'est inspiré pour certains gestes, certaines postures, certains décors, certains costumes de cette œuvre gravée. Il peut s'agir de quelques détails (un chapeau...) ou d'une mise en scène d'ensemble, et l'on ne peut que difficilement tirer de considérations générales de ces observations. Mais chaque comparaison révèle une manière spécifique de traiter les mêmes événements, un point de vue original, une accentuation de certains effets ou de certaines émotions : là où le graveur par exemple n'hésite pas à user de la caricature que ce soit dans le traitement des figures ou dans le choix des attitudes, le cinéaste reste guidé par les principes d'un cinéma « réaliste » et recourt plutôt à l'ironie induite par des procédés cinématographiques comme le recours aux gros plans qui déforment légèrement les visages, des plongées ou contre-plongées qui soulignent le caractère inégalitaire des relations entre personnages, ou encore des gestes d'acteurs moins accentués mais finement mis en évidence par la caméra comme de brefs échanges de regards. Là où une analyse purement interne du film ne perçoit qu'un traitement esthétique homogène, la navigation entre des médias différents permet de saisir des caractéristiques propres à chaque séquence qui, sans cela, risqueraient de rester invisibles.
Dans le cas d'Oliver Twist, le rapprochement entre médias différents semble s'imposer spontanément puisque l'œuvre gravée et le film sont inspirés du même roman original de Charles Dickens (et le cinéaste connaissait manifestement les gravures de Cruikshank, qu'il s'en soit plus ou moins inspiré ou au contraire qu'il s'en soit écarté). Mais la navigation entre médias peut être beaucoup plus aléatoire et se révéler pleinement signifiante. On l'a vu avec le thème de la violence en images qui peut être analysé à travers le cinéma, mais également la télévision, les jeux vidéos, la photographie, la bande dessinée... Si les intentions, les esthétiques (au sens large), les effets sont sans aucun doute différents, la comparaison entre médias permet alors certainement de mieux saisir la spécificité de chaque réalisation. Beaucoup d'autres thèmes – la nature, l'amour, le conflit, la ville, la campagne, les inégalités sociales, la solitude... – peuvent ainsi être abordés grâce à une navigation à travers différents médias.

Eldorado
un film de Bouli Lanners (2008)

La mort d'Adam de Piero della Francesca (1452-1466)
La similitude des gestes induit une réflexion sur une possible analogie thématique entre ces œuvres apparemment très différentes (par exemple, une méditation sur la mort et la finitude de toute chose).
Bien entendu, dans le cadre d'une analyse cinématographique, l'accent portera plus particulièrement sur le film envisagé. Pour donner un dernier exemple d'une telle navigation, l'on considérera un film comme Eldorado de Bouli Lanners, un cinéaste belge qui ne cache pas l'importance de sa formation picturale dans sa carrière artistique : à partir d'une série d'images du film, les spectateurs seront invités à opérer des rapprochements avec des peintures plus ou moins connues, soit pour relever des analogies soit au contraire pour marquer des différences ou des contrastes. La navigation pourra être très large et l'on utilisera aussi bien des intérieurs hollandais du 17e siècle que des paysages romantiques ou des œuvres expressionnistes ou encore des peintures d'époques très éloignées montrant néanmoins des gestes similaires (un homme s'appuyant sur le manche d'une bêche, des personnages posant frontalement devant le peintre...). Si de tels rapprochements [43] peuvent donner lieu à des interprétations différentes, ils permettent en tout cas de sensibiliser les spectateurs à certaines caractéristiques de l'image qui sont difficilement définissables verbalement – la « photographie », la « lumière », les « cadrages », la « composition », « l'atmosphère »... –, mais qui apparaissent plus facilement grâce à la comparaison d'images.
La navigation joue par ailleurs un rôle essentiel dans l'évaluation du caractère fictionnel d'un film ou de certains de ses éléments. Dans l'univers filmique, tout apparaît avec le même degré de réalité, et les « aliens » ont autant de présence que les vaisseaux spatiaux, les humains, les objets quotidiens ou les paysages terrestres. C'est évidemment grâce à un savoir extérieur que nous savons que les « aliens » n'existent vraisemblablement pas ou qu'en tout cas toute l'histoire racontée dans le film de Ridley Scott est le fruit de l'imagination de ses scénaristes !
Une illusion courante consiste cependant à croire que les jugements que nous portons sur la vérité ou au contraire l'absence de vérité d'une représentation (film, discours, photographie, reportage...) résultent de notre connaissance directe de la réalité que nous pourrions alors comparer avec cette représentation. Si une telle comparaison est possible dans la vie quotidienne où il me suffit de vérifier comme on vient de me le dire qu'il y a ou non du lait dans le frigo, une telle démarche est pratiquement impossible face à la masse d'informations dont nous prenons quotidiennement connaissance : tout le monde sait que Napoléon fut l'empereur des Français, que l'Argentine se situe en Amérique du Sud, qu'il y a une guerre en Syrie et en Irak, que la terre est ronde, que le tabac est cancérigène, que la matière est constituée d'atomes et de molécules, mais bien peu d'entre nous peuvent vérifier empiriquement ces affirmations sans que pourtant cet état de fait problématique ne remette en cause nos croyances. Comment pouvons-nous alors avoir de telles certitudes ou plus précisément comment faisons-nous le partage entre ce que nous estimons vrai, certain ou au contraire incertain, faux ou fictionnel ?

Il était une fois en Amérique
de Sergio Leone (1984)
avec en arrière-plan le célèbre pont de Manhattan à New York.
L'image pose la question : quand est-on dans la « réalité » ? Où commence la fiction ?
Comment savons-nous par exemple que le film Il était une fois en Amérique de Sergio Leone (1984) est une fiction ? Et comment jugeons-nous à l'inverse de la vérité d'un documentaire comme la Marche de l'Empereur de Luc Jacquet (2005) qui nous montre les mœurs d'un étrange animal qu'on ne rencontre pas dans nos contrées tempérées, le manchot empereur ? La réponse à cette question est relativement simple : nous faisons confiance à certaines sources d'informations, et c'est en fonction de la fiabilité supposée de ces sources que nous évaluons la véracité des nouvelles « informations » (au sens le plus large) qui nous parviennent : la photo d'un manchot n'est pas plus crédible en soi que celle d'un « alien », mais nous trouvons dans des encyclopédies (en ligne, comme Wikipedia, ou non), dans des ouvrages de vulgarisation scientifique, dans des reportages photographiques ou télévisuels, de multiples attestations de l'existence de cet animal dont la vie, les mœurs, les caractéristiques font l'objet de descriptions concordantes. Nous n'avons donc aucune raison de douter de l'authenticité des images qui nous sont montrées dans la Marche de l'Empereur.
Un film comme Il était une fois en Amérique va en revanche susciter un questionnement plus complexe sur son éventuelle valeur de vérité : aucune encyclopédie, ni aucun article de journal, même ancien, ne nous parlera d'un gangster juif du nom de Noodles ayant vécu dans les années 1920 à New York ; notre connaissance générale des genres littéraires et cinématographiques nous permet par ailleurs de supposer qu'il s'agit là d'un personnage de fiction. En revanche, nous savons que les gangsters ont existé, notamment aux États-Unis à cette époque ; la mafia d'origine italienne est également bien connue : le nom d'Al Capone est aujourd'hui encore célèbre. L'on sait aussi que les États-Unis sont nés d'un melting pot, d'un mélange d'immigrations de multiples origines, notamment une immigration juive venue d'Europe orientale. Enfin, l'histoire de la Prohibition est largement documentée, tout comme la mode des chapeaux mous à la même époque, et il n'est pas difficile de trouver des images, anciennes ou contemporaines, du pont de Manhattan qui apparaît à plusieurs reprises dans le film. Nous opérons donc un partage plus ou moins fin, plus ou moins assuré, dans ce film, entre des éléments que nous jugeons clairement fictifs et d'autres que nous estimons vrais (la fin de la Prohibition a bien été déclarée en avril 1933) et d'autres enfin que nous jugeons plus ou moins vraisemblables (une mafia juive a sans doute existé à New York à cette époque même si elle est moins connue que la mafia d'origine sicilienne). Or, pour opérer un tel partage (qui peut être sujet à certaines révisions ou qui peut faire l'objet de certaines polémiques), nous n'avons nul besoin d'avoir mis les pieds à New York ni dans les années 1920 ni même aujourd'hui : c'est grâce à une navigation, qu'elle soit actuelle ou plus ancienne, à travers d'innombrables sources d'information que nous pouvons affecter une valeur de vérité différente aux multiples éléments d'un film de fiction comme Il était une fois en Amérique.
Bien entendu, nous ne disposons pas tous des mêmes sources d'information, et nous n'accordons pas tous le même crédit aux mêmes sources. Mais ce que nous estimons être la vérité ou au contraire la fausseté ou encore la fiction [44] ne résulte pas (sauf exception) d'une connaissance directe et personnelle de la réalité, mais bien plus généralement d'une navigation complexe, multiple et répétée à travers les médias. L'on comprend dès lors facilement que l'analyse filmique ne peut pas être purement « interne », et qu'elle doit nécessairement recourir à des sources d'informations externes pour juger par exemple du réalisme d'un film et prendre la mesure de la part de fiction ou de reconstitution qui y intervient. C'est le cas évidemment des films historiques qui supposent que l'on connaisse un minimum la période mise en scène pour évaluer la véracité des événements représentés : dans une perspective éducative, il est alors intéressant de procéder à une « navigation » à travers de multiples documents (ouvrages historiques, reportages, documentation diverse...) pour améliorer les connaissances souvent sommaires des spectateurs [45].

Moi, Daniel Blake
un film de Ken Loach (2016)
La situation dramatique de ce personnage doit-elle être considérée comme exceptionnelle et extrême, ou bien n'est-elle qu'un exemple parmi des milliers d'autres?
Juger de la vérité objective d'un film (comme de toute autre représentation) implique que l'on dispose d'informations extérieures pour prendre la mesure du contexte général où s'inscrivent les événements mis en scène.
La vérité morale en revanche — une telle situation est-elle en définitive juste ou au contraire profondément injuste? — ne se mesure pas en nombre, et les spectateurs réagiront pour la plupart par l'indignation devant les vexations qu'une administration kafkaïenne fait subir à cet homme.
La vérité politique du film, que défend le réalisateur, joue entre ces deux types de vérité, le film s'appuyant sur cet exemple pour dénoncer une politique néolibérale qui est à l'origine des mesures prises pour contrôler les personnes sans-emploi et dont est victime Daniel Blake. Ces trois types de vérité (qui résultent donc d'interprétations différentes en fonction du contexte auquel on fait référence) expliquent que des spectateurs puissent réagir de façon différente au même film (l'indignation morale n'impliquant pas nécessairement le combat politique).
Mais une telle démarche est sans doute nécessaire pour tout film à prétention réaliste : l'on peut ainsi partager l'indignation d'un Ken Loach qui, dans Moi, Daniel Blake (2016), dénonce le harcèlement exercé à l'encontre des travailleurs sans emploi, mais il faut nécessairement des informations complémentaires pour savoir si les faits dénoncés sont ponctuels, quelle est leur ampleur, quel est le nombre de personnes touchées par ces mesures, quelles sont les conséquences de ces mesures sur la vie des personnes concernées. Seule une telle information permet par exemple de juger si l'histoire mise en scène par Ken Loach représente un cas extrême choisi pour accentuer le caractère dramatique d'une situation plus générale (celle de tous les chômeurs dont on prétend augmenter « l'employabilité ») ou s'il s'agit d'un exemple « moyen » pris parmi des centaines ou des milliers d'autres [46].
La « vérité » d'un film ne se mesure cependant pas seulement à travers des informations détaillées sur des faits historiques précis ou des réalités sociales décrites de façon statistique (comme on vient de l'évoquer à l'instant), et repose sur des considérations beaucoup plus générales d'ordre moral, politique, philosophique, esthétique ou autre : Ken Loach ne dénonce évidemment pas uniquement une injustice individuelle ou limitée à une catégorie restreinte de personnes (les travailleurs sans emploi accusés d'être des profiteurs de la sécurité sociale) et il vise l'ensemble d'une politique qu'on peut qualifier de néo-libérale, mise en œuvre en Grande-Bretagne et ailleurs depuis les années 1980 par le gouvernement de Margaret Thatcher et d'autres [47]. La réflexion sur le propos du film, sur le point de vue de son auteur, lorsque celui-ci n'entend pas seulement distraire le spectateur, 48 mais « dire » quelque chose sur le sens de la vie et du monde qui nous entoure, implique une navigation plus ou moins complexe pour juger de la pertinence de ce propos : un concept en apparence aussi simple que celui du néolibéralisme se construit en fait par une accumulation d'informations à travers de multiples médias (presse, reportages, télévision, tribunes ou analyses politiques...), ce qui explique qu'il soit inaccessible notamment à des enfants qui seront dès lors incapables de comprendre les véritables enjeux du film de Ken Loach.
38 témoins
un film de Lucas Belvaux (2012)
Roman, article universitaire, film : trois regards différents sur le même événement
Bien entendu, la majorité des spectateurs ont un bagage culturel suffisant pour comprendre le propos d'un film comme Moi, Daniel Blake. Mais, dans une perspective éducative, il est toujours intéressant de proposer une « navigation » entre différents médias pouvant fournir des contrepoints pertinents au film envisagé et qui peuvent éclairer sous un jour nouveau son propos. On en donnera encore un exemple, relativement différent de ceux abordés jusqu'ici. En 2012, le cinéaste belge Lucas Belvaux réalise 38 témoins, une fiction qui raconte comment une jeune femme a été assassinée la nuit dans une rue du Havre alors que trente-huit personnes alertées par ses cris ont pu voir le crime, mais ne sont pas intervenues. Cette histoire, largement réécrite du point de vue d'un de ces témoins qui finalement dénoncera la passivité générale dont pourtant il s'est lui aussi rendu coupable, s'inspire d'un fait divers authentique qui s'est déroulé à New York en 1964. Ce fait divers a fait l'objet de quatre « narrations », mais aussi de quatre interprétations subséquentes contrastées, dont celle de Lucas Belvaux, la dernière en date : il s'agit d'abord d'un compte rendu journalistique écrit rapidement après les faits, puis d'un article de psychologie sociale dont le retentissement fut très important dans le domaine scientifique et enfin d'une réécriture romanesque de Didier Decoin, auteur de plusieurs « polars », en 2009. Une comparaison fouillée entre ces quatre versions des mêmes événements révèle des points de vue contrastés, des approches profondément différentes, sinon même des « visions du monde » orientées diversement : l'écriture journalistique privilégie en effet l'aspect sensationnaliste du fait divers en mettant en cause la passivité supposée scandaleuse des « témoins » livrés alors à la vindicte publique ; en revanche, la psychologie sociale livre ici un de ses textes fondateurs en adoptant une démarche explicative, neutre axiologiquement, qui trouve dans les éléments de la situation générale les causes de l'absence de réaction des témoins (persuadés que quelqu'un va réagir ou a déjà réagi) ; l'écrivain réagissant bien longtemps après que les passions suscitées par ce fait divers se sont assagies va proposer une lecture beaucoup plus pessimiste sur l'ensemble d'une société foncièrement corrompue dont les témoins ne sont que les tristes représentants et qui laisse les êtres les plus faibles sans défense (son roman s'intitule significativement de manière tout à fait générale : Est-ce ainsi que les femmes meurent ?) ; enfin, le cinéaste, dont le pessimisme se rapproche de celui du romancier, met quant à lui l'accent sur la culpabilité individuelle, profondément intériorisée, du seul témoin qui avouera finalement aux yeux de tous sa totale passivité, accédant ainsi à une forme de rédemption. Cette comparaison, qui mérite d'être développée [49], souligne encore une fois la pertinence d'une « navigation » notamment pour mieux comprendre le point de vue de l'auteur du film, sa « vision du monde » qui oriente profondément son travail de mise en scène (au sens large).
L'écriture au sens de la production ou de la réalisation d'un objet médiatique semble à première vue à l'opposé de la démarche d'analyse filmique centrée sur le processus de réception. Néanmoins, l'on comprend facilement que l'analyse, si elle n'est pas destinée à rester muette, implique nécessairement un dialogue avec d'autres spectateurs : la forme la plus courante de l'exercice critique débouche ainsi sur l'écriture d'un article, scientifique ou journalistique, ou encore d'une simple opinion sur un forum ou un courrier des lecteurs d'un site web (comme AlloCiné ou SensCritique).
Les deux processus, la « lecture » et « l'écriture », impliquent dès lors des compétences très différentes : quelqu'un peut analyser de manière pertinente un film, mais ne pas être capable de produire un texte construit et convaincant. L'écriture au sens restreint (c'est-à-dire la production d'un texte écrit) est un exercice très spécifique que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ou maîtrisent mal : on sait bien qu'il ne suffit pas d'avoir des « idées » pour les coucher de façon efficace sur le papier. Bien entendu, ce n'est pas le lieu ici de développer les techniques visant à améliorer les compétences en matière d'écriture.
On soulignera à ce propos une différence importante entre la critique et l'analyse filmique qui sont souvent confondues [50] : la critique repose toujours sur un jugement de valeur que l'auteur va alors essayer de justifier par la mise en avant d'une série de caractéristiques du film qu'il juge admirables ou au contraire détestables. En cela, comme on l'a déjà montré, il s'agit toujours pour une part d'un exercice subjectif : on aime ou on n'aime pas le jeu d'un acteur, on aime ou on n'aime pas le style de mise en scène spectaculaire d'un cinéaste, on déteste ou on admire le rythme ralenti ou le caractère contemplatif d'un film, on estime un portrait particulièrement juste et subtil ou au contraire banal et cliché ... L'analyse en revanche implique que l'on suspende, au moins temporairement, tout jugement de valeur et que l'on s'attache à décrire de façon neutre le film envisagé et à comprendre comment il est construit, comment il « fonctionne », quel est son propos, quelle est sa forme, quelle est sa portée, quel est le travail de mise en scène du réalisateur. L'analyse est en principe un exercice de connaissance, ce que n'est pas nécessairement la critique (même si cette dernière comporte souvent aussi une part d'analyse).
Écrire une analyse repose donc sur un travail préalable de « lecture » (dans le sens défini ici) dont on ne retient cependant que certains éléments jugés plus pertinents. Tout ce qui aura été, dans un premier temps, observé, noté, interprété, ne prendra pas nécessairement place dans l'analyse finale : celle-ci obéira généralement à un principe de cohérence, et certains traits qu'on estimera secondaires ou extérieurs à l'axe principal de l'analyse seront alors négligés. On passe ainsi d'une « lecture » qui fonctionne plus ou moins comme un brain storming (même si le processus est individuel), où toutes les idées sont valides et notées en désordre, à un processus d'écriture qui implique de déterminer un axe d'analyse suffisamment pertinent pour rendre compte des principales caractéristiques du film.
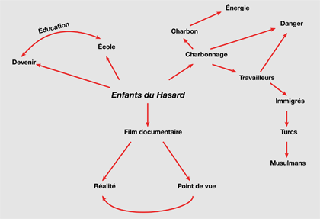
Les Enfants du Hasard
un documentaire de Thierry Michel et Pascal Colson (2017)
La mise en ordre des idées s'est faite autour du mot Hasard qui, en l'occurrence, désigne la chance mais également le site d'une mine de charbon dans la région liégeoise où ont travaillé pendant des décennies des immigrés d'origine turque dont les enfants et les petits-enfants se retrouvent dans la même école des environs. On pourra se reporter au dossier pédagogique réalisé par les Grignoux sur ce film.
Cette seconde étape est sans doute décisive et souvent très complexe pour les personnes maîtrisant peu ou mal l'écriture : elle vise à répondre à la question « Qu'est-ce qu'on va dire ? » Contrairement à ce qui est affirmé dans certains manuels d'analyse filmique, il n'y a pas de méthode universelle qui permette de déterminer quel est l'axe d'analyse le plus pertinent, car les films, comme d'ailleurs les autres productions culturelles, se signalent par une extrême diversité de forme, de propos, d'intention, de techniques utilisées, de situation historique, de public visé : on n'aborde pas un documentaire comme un dessin animé, on n'analyse pas un film des frères Lumière comme une production hollywoodienne contemporaine à grand spectacle, on ne regarde pas de la même façon un film à prétention réaliste et un film fantastique... À chaque fois, il faut au contraire définir un « angle d'attaque », déterminer ce qui dans le film apparaît comme le plus important, le plus pertinent, le plus original.
En situation d'animation de groupe, une manière de faire souvent efficace est de proposer aux participants de citer un mot qui leur vient spontanément à l'esprit pour résumer l'impression principale que leur a laissée la vision du film : l'animateur note tous ces mots sur un tableau, puis dans un second temps, essaie de les réunir par « famille » de façon à déterminer des ensembles significatifs qui serviront alors d'axe d'analyse. Ces « familles » seront sans doute très diverses et varieront aussi bien en fonction des films que des participants : certains seront sensibles aux thèmes abordés, d'autres à la mise en scène, d'autres encore aux émotions ressenties. Mais cette mise en ordre permet généralement de dégager un ou plusieurs axes d'analyse pertinents que l'on développera en répondant à des questions comme : qu'est-ce qui explique l'impression d'ensemble ressentie ? Quels sont les éléments filmiques qui concourent à cette impression ? Quels sont ceux qui paraissent secondaires par rapport à cette impression ? Comment peut-on décrire l'évolution de cette impression ? Quels en sont les moments clés ? Quelles sont les scènes dont on se souvient le plus facilement pour expliquer cette impression ? Peut-on relier l'impression principale – celle qui serait au centre de la famille de mots – aux impressions plus secondaires que la discussion aura fait éventuellement émerger ? Peut-on également distinguer dans le film un axe principal – qu'il soit thématique, formel, esthétique ou de toute autre nature que ce soit – et d'autres aspects plus accessoires ? Les réponses à ces questions devraient alors permettre d'écrire une analyse cohérente [51].
Dans cette perspective, il nous paraît cependant intéressant de mettre l'accent sur d'autres formes d'écriture entendue alors dans un sens élargi. Il faut à ce propos faire une remarque préalable. Faire une analyse filmique consiste fondamentalement à « parler » d'un film, à décrire et à interpréter ses caractéristiques dans un autre « langage » : c'est ce qu'on appelle une opération métalangagière, c'est-à-dire qu'on analyse le « langage cinématographique » grâce à un autre langage. Or le métalangage [52] utilisé dans cette opération sera nécessairement la langue, la langue que nous parlons ou écrivons tous les jours : un cours d'analyse filmique par exemple se fait avec des mots, éventuellement accompagnés par des gestes pour montrer certaines caractéristiques de l'image, mais la langue constitue le médium fondamental d'une telle opération. Il existe des analyses cinématographiques qui se présentent sous forme de petits films (par exemple en supplément à certains DVD), mais l'on remarque facilement que, même dans ces films, la langue parlée (plus rarement écrite) reste l'outil essentiel de la communication pour décrire et interpréter les éléments filmiques jugés pertinents [53]. Autrement dit, la langue constitue en fait le métalangage universel qui permet de parler des autres « langages », qu'il s'agisse de cinéma, de peinture, de publicité, de musique ou même du code de la route (dont les manuels écrits et imprimés sont nécessaires pour expliquer le sens des panneaux routiers par exemple) [54].
Dès lors, l'on considérera que les autres formes « d'écriture » que l'on va à présent aborder plutôt comme des aides ou des compléments à l'analyse qui passera toujours pour l'essentiel par le canal verbal. Un exemple éclairera facilement ce point : un graphique illustrant le schéma du récit filmique ou les relations entre les personnages peut être un outil extrêmement efficace pour montrer de façon visuelle des relations qui s'établissent dans le cours temporel de la projection. Un tel outil permet de « penser » le film (sa structure, sa construction, son organisation...), mais il devra nécessairement s'accompagner de commentaires oraux ou écrits.
L'utilité de ce genre d'outils ne doit cependant pas être sous-estimée. Un graphique permet en effet de visualiser des relations qui ne sont pas le plus souvent visibles à l'écran. Un film nous montre la réalité – même si cette « réalité » est en fait une fiction – sous forme fragmentaire, et c'est le spectateur qui doit reconstituer la cohérence entre ces différents fragments. Ces relations peuvent cependant être de différentes natures et donner lieu dès lors à des représentations graphiques très diverses. Si certains schémas canoniques sont bien connus – par exemple celui du récit en cinq étapes [55] ou celui des actants élaboré par A.J Greimas [56] –, il est certainement intéressant dans le cadre de l'acquisition de compétences médiatiques de suggérer aux spectateurs de construire plutôt leur propre schéma en se basant sur les informations qu'ils jugent les plus pertinentes. En effet, en fonction du film, de ses thèmes, de sa construction, l'analyse de certaines dimensions sera sans doute plus significative que d'autres.
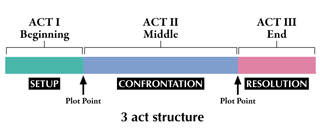
Un modèle de construction du scénario
tel qu'il est fréquemment enseigné aux États-Unis dans les écoles de cinéma
Ce modèle s'applique particulièrement bien à un film comme Irina Palm de Sam Garbarski.
Ainsi, certains films se laissent facilement découper en quelques grands « blocs », mais leur nombre, contrairement à ce qu'affirment les théories du récit [57], n'est pas nécessairement fixé d'avance. Beaucoup de scénarios filmiques se présentent en trois grandes parties : une situation problématique de départ, le développement de cette situation et ses complications et enfin la résolution [58]. Mais on n'en compte parfois que deux, par exemple dans le film de Stanley Kubrick Full Metal Jacket (1987) qui montre d'abord l'entraînement des marines aux États-Unis puis leur déploiement au Viêt-nam, ces deux parties fonctionnant en « miroir ». Et l'on peut trouver des exemples de scénarios avec cinq ou six grandes étapes : ainsi, dans l'adaptation du roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, par Tim Burton, on reconnaît facilement, outre la situation de départ et avant la résolution finale, cinq grandes étapes marquées chacune par l'épreuve subie par un personnage, caractérisées en outre par un lieu spécifique et enfin marquées par une couleur dominante soigneusement choisie par les décorateurs [59].
Mais, pour rendre compte de la dynamique du récit, il est souvent préférable de construire une représentation sous forme de graphe plutôt que sous forme de blocs trop statiques. Une ligne ondulée peut ainsi révéler de manière significative le « parcours » du personnage, les grands moments d'inflexion de l'histoire, les « hauts » et les « bas » dans une aventure où le spectateur est souvent aussi impliqué émotionnellement que le héros : on voit ainsi facilement la dynamique du récit et la manière dont à la fois il maintient le suspens et dont il le renouvelle [60]. Encore une fois, il vaut sans doute mieux renoncer à l'illusion d'un modèle canonique et construire un graphique le mieux adapté au film qu'on souhaite analyser.
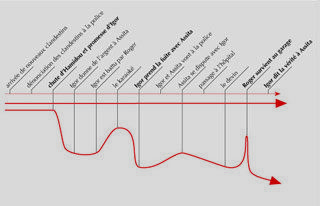
La Promesse
un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne (1995)
Un exemple de représentation graphique de la dynamique du récit: la ligne rouge supérieure désigne le parcours du père Roger; la ligne rouge inférieure, celle de son fils Igor qui s'éloigne progressivement.
Toutes les formes sont envisageables pour autant qu'elles rendent compte de façon visuelle et significative de la manière dont le récit est construit : pour schématiser le récit dans un film comme la Promesse de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui raconte l'éloignement progressif d'un père et de son jeune fils exploitant des travailleurs clandestins dans une banlieue victime de la désindustrialisation, on préférera sans doute tracer (de gauche à droite) deux lignes symbolisant l'éloignement, mais aussi le rapprochement ponctuel des personnages. Un tel graphique permet notamment de repérer les moments « forts » du film, qui marquent la mémoire des spectateurs, et de les inscrire dans la dynamique générale du récit [61] : on comprend alors facilement que ces moments correspondent aux inflexions majeures de l'histoire, quand le personnage principal est face à un choix, conscient ou inconscient, dont l'enjeu essentiel est l'affection d'un père qui, par ailleurs, est moralement abject.
Un autre exemple d'une telle structure d'éloignement entre deux personnages ou deux groupes de personnages se retrouve dans un film très différent de nature historique comme La Liste de Schindler de Steven Spielberg (1993) : cette évocation de la situation tragique de la communauté juive de Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale décrit la dégradation progressive de cette communauté soumise par les occupants nazis à des procédures successives de ségrégation, d'isolement, de mise au travail forcé, avant la déportation puis la mise à mort dans les chambres à gaz d'Auschwitz, mais en se focalisant sur un petit groupe qui échappera à la mort grâce aux interventions répétées d'un industriel allemand, Oskar Schindler, le film amène le spectateur à s'identifier de plus en plus fortement à ce petit groupe, ce qui suscite même une forme de « soulagement » à la fin de la projection, ce qu'un simple schéma met facilement en évidence [62]. Mais un tel « soulagement » ne correspondait certainement pas au sentiment éprouvé par les survivants de la Shoah dont la plus grande partie de la communauté, des proches, des parents, des amis, avait été massacrée (seulement 10% des Juifs polonais environ ont échappé à l'extermination). L'on comprend alors que le film de Spielberg, malgré ses intentions honorables, ait pu susciter de nombreuses critiques notamment d'un point de vue historique.
D'autres aspects du film que le récit peuvent cependant faire l'objet d'une transcription sous forme graphique. Les relations entre les personnages constituent ainsi souvent un enjeu essentiel du propos du film, plus important parfois que les péripéties de l'intrigue, et il est dès lors pertinent de représenter ces relations sous forme de diagrammes (de Venn ou autres) ou de graphes orientés (au sens courant du terme sans référence à la théorie mathématique).
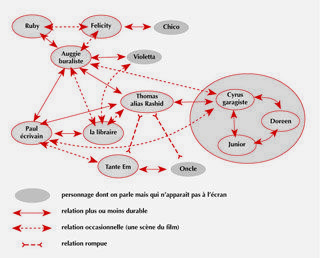
Smoke
un film de Wayne Wang et Paul Auster (1995)
Un exemple de représentation des relations entre personnages: Auggie, Paul et Rashid forment le triangle de base, et tous les autres personnages peuvent être considérés comme plus ou moins secondaires. Même si l'on a oublié le nom de certains personnages ou même leur rôle, il est facile de déterminer leur position par rapport à ce triangle de base.
Ainsi, il est pratiquement impossible sur base des souvenirs laissés par la projection de résumer un film comme Smoke de Wayne Wang et Paul Auster (1995), ponctué de mille petits événements divers qu'il semble impossible d'ordonner de façon cohérente ; en revanche, il est très facile de se remémorer les personnages principaux au nombre de trois (Auggie le buraliste, Paul l'écrivain et Rashid le jeune adolescent noir dont on découvrira plus tard la véritable identité) et de décrire leurs relations sous la forme d'un triangle dont chacun occuperait un sommet. À partir de là, il est facile de situer les multiples personnages secondaires qui sont reliés de façon diverse à un des sommets du triangle. On peut ensuite complexifier le graphe en différenciant la nature des relations en cause, certaines étant durables, d'autres plus occasionnelles, d'autres enfin ayant été rompues au cours du temps. Alors que le film se présente comme un kaléidoscope d'événements sans grands rapports entre eux, le schéma révèle facilement l'importance des relations entre les personnages qui constituent effectivement un des thèmes essentiels du récit, à savoir la rupture toujours possible des relations humaines et la solitude qui en résulte.
Bien entendu, certains types de films se prêtent mieux que d'autres à ce genre de représentation graphique [63] : par exemple, l'architecture d'un film « choral » avec une multitude de personnages, se déroulant en différents lieux ou à différentes époques, apparaîtra souvent facilement grâce à un graphe des personnages, plus ou moins détaillé, plus ou moins complexe. Un type de représentation n'est d'ailleurs pas exclusif d'un autre, et rien n'empêche de tester plusieurs modèles – les relations entre personnages, la dynamique de la narration, les différentes parties du film... – qui pourront se révéler plus ou moins pertinents et éventuellement se compléter mutuellement.
Mais l'on peut aussi suggérer de réaliser une représentation graphique de certaines dimensions filmiques plus inattendues comme la géographie des lieux représentés. On prendra un premier exemple tiré du célèbre dessin animé de Paul Grimault, le Roi et l'Oiseau (1980) : si l'on demande aux participants de faire un plan de la ville de Takicardie, même de façon sommaire, la tâche est pratiquement impossible s'ils essaient de réaliser une projection horizontale comme sur une carte de géographie traditionnelle : en revanche, il est très facile de dessiner un plan vertical où s'opposent de manière visible, d'une part, les étages supérieurs réservés au roi Charles Cinq Et Trois Font Huit Et Huit Et Huit Font Seize, qui utilise d'ailleurs pour y accéder un ascenseur ultra-moderne, et, d'autre part, les bas-fonds où vit le peuple misérable contraint d'y séjourner. Ce simple schéma conduit alors aisément à une analyse esthétique des mouvements du film qui, à l'exception de ceux du roi, sont essentiellement des chutes évidemment orientées de haut en bas. Les cadrages quant à eux privilégient largement des perspectives accentuées et des plongées ou des contreplongées spectaculaires sur des architectures vertigineuses [64].
D'autres exemples peuvent bien sûr être évoqués. Par exemple, dans le Cheval venu de la mer de Mike Newell, une carte de l'Irlande permet de repérer très simplement le voyage des principaux protagonistes – deux enfants issus du monde des Travellers, une population nomade irlandaise – à travers le pays puisqu'ils fuient à cheval de Dublin pour arriver au terme de leur périple dans le Connemara, précisément aux falaises de Moher à l'extrême ouest du pays : cette géographie très simple éclaire alors le sens du titre original du film, Into the West, le voyage vers l'Ouest qui bien sûr évoque également celui des colons en Amérique du Nord [65]. De la même façon, beaucoup de spectateurs comprennent assez mal les enjeux de la bataille judiciaire menée dans Amistad de Steven Spielberg à une époque où l'esclavage était toujours autorisé dans le sud des États-Unis, mais où la traite des esclaves à partir de l'Afrique était interdite sous la pression de l'Empire britannique : les voyages des différents bateaux – la Tecora, puis l'Amistad –, le transbordement des captifs à la Havane, l'arraisonnement de l'Amistad par un navire américain dont le capitaine prendra soin de se diriger ensuite vers un État esclavagiste, tous ces éléments qui sont au cœur du récit mis en scène par Spielberg apparaissent clairement sur une carte où l'on retrace ces différentes navigations [66].
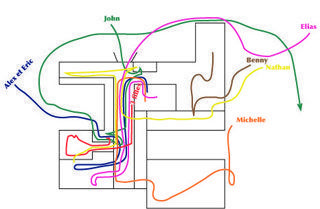
Elephant
un film de Gus Van Sant (2003)
Les déplacements des personnages selon un schéma du réalisateur.
À l'inverse, certaines reconstitutions se révèlent extrêmement complexes sinon impossibles, alors même qu'elles semblent appelées par la construction même du film. Elephant de Gus Van Sant en est un bon exemple. Comme on le sait, ce film est une reconstitution fictionnelle de la tuerie qui a eu lieu au lycée de Columbine aux États-Unis : la caméra suit (ou parfois précède) différents protagonistes dont on ne sait pas grand-chose et dont on ne peut pas prévoir le destin, même si l'on devine qu'il pourrait être tragique étant donné le sujet du film, sans doute connu par la plupart des spectateurs avant la projection ; ces personnages se croisent souvent sans se voir, paraissent déambuler souvent sans but visible dans les couloirs, sont confrontés enfin aux tueurs dont l'identité ne nous est révélée que tardivement. On s'aperçoit d'ailleurs que la chronologie est bouleversée et que certaines scènes se répètent même si elles sont filmées sous un angle différent. La reconstitution des différents parcours paraît donc difficile, voire impossible (même si Gus Van Sant lui-même en a livré un schéma [67]), mais cette difficulté est précisément révélatrice du propos du cinéaste qui cherche à nous désorienter, que ce soit au sens proprement géographique ou plus largement mental : on peut alors interpréter de façon différente cette volonté de désorientation – on peut par exemple penser que le bouleversement chronologique et géographique du film reproduit le cheminement de la mémoire des personnages qui n'arrêtent pas de revoir les mêmes images traumatiques avec de légères variantes –, mais l'on voit qu'elle est au cœur même du projet esthétique du cinéaste qui, loin de nous délivrer un message explicite, préfère au contraire nous plonger dans un flux d'événements dont l'ordre, le sens, la « logique » nous échappent largement.
De telles représentations graphiques, aussi intéressantes soient-elles, semblent cependant ne pas concerner – du moins directement – une dimension essentielle du film envisagé, à savoir le propos du cinéaste, son « message » éventuel ou ses choix esthétiques. L'intentionnalité ne semble pas à première vue pouvoir être représentée sous forme graphique. Pourtant, l'histoire des mathématiques montre que « l'écriture » graphique peut être une aide importante à la pensée la plus abstraite. C'est également le cas pour l'analyse filmique : si les intentions de l'auteur du film (il s'agit très généralement du cinéaste) restent généralement implicites et ne se traduisent à l'écran que par des indices qui doivent être interprétés de façon partiellement hypothétique par les spectateurs, il est possible d'interpréter ces intentions selon des axes logiques, contraste, différence, opposition, similitude, qui peuvent faire l'objet d'une représentation graphique. Celle-ci permettra en particulier de passer d'un niveau concret – les personnages représentés, l'histoire racontée, les événements singuliers mis en scène...– à un niveau plus abstrait où ces éléments prennent une signification plus générale.
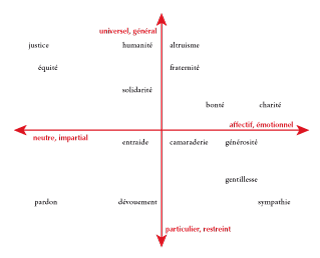
Les Neiges du Kilimandjaro
un film de Robert Guédiguian (2011)
Une représentation des différentes valeurs mises en jeu dans le film à partir d'une caractérisation possible de l'attitude des personnages principaux.
On en donnera un petit exemple. Dans les Neiges du Kilimandjaro (2011), Robert Guédiguian met en scène Michel, un délégué syndical qui, dans un contexte de restructuration industrielle, accepte d'être licencié avec d'autres pour permettre la continuation des activités sur les chantiers navals de Marseille ; pour lui, c'est sans doute l'occasion de profiter d'une retraite anticipée et de réaliser un vieux rêve, découvrir avec sa femme les fameuses neiges du Kilimandjaro ; mais il est bientôt victime d'une agression violente au cours de laquelle on lui dérobe la cagnotte qui a été réunie par ses collègues et qui devait lui permettre de faire ce voyage ; il découvre ensuite que, parmi ses agresseurs, il y a un jeune collègue licencié en même temps que lui. Quelle attitude adopter face à une telle situation quand s'entremêlent des sentiments d'injustice, de vengeance, d'incompréhension, et peut-être de pardon et de solidarité ? À travers cette histoire, le cinéaste entend certainement défendre, mais aussi questionner certaines valeurs dont sont porteurs, ou non, les différents personnages. Mais ces valeurs abstraites ne sont jamais énoncées en tant que telles.
Pour caractériser les deux personnages principaux, Michel et sa femme, on peut sans doute suggérer aux spectateurs des termes comme : justice, entraide, générosité, gentillesse, camaraderie, fraternité, solidarité, charité, équité, sympathie, bonté, pardon, altruisme, dévouement, humanité... Mais lequel de ces termes correspond au propos du cinéaste ? Il n'est pas du tout sûr que les spectateurs s'entendent sur ces valeurs, et il est dès lors nécessaire de clarifier autant que faire se peut ces différents concepts. Pour faciliter une telle réflexion, l'on pourra construire un graphe des termes proposés en fonction de leurs différentes nuances de sens, en procédant d'abord à un rapprochement de ces différents concepts en fonction de leur parenté sémantique (selon le principe des « nuages de mots »), puis en représentant les différents axes sur lesquels s'opposent ces différents termes. Dans ce cas-ci, l'on voit notamment qu'il y a une première opposition entre l'universel et le particulier et une deuxième entre l'impartialité et l'affectivité : ainsi, le dévouement s'adresse à des personnes particulières (comme les personnes âgées dont s'occupe Marie-Claire), mais repose moins sur des considérations affectives que sur des considérations générales comme l'état de besoin où se trouvent ces personnes. La gentillesse en revanche est une disposition essentiellement affective, mais vise un plus grand nombre de personnes. Au bord opposé du tableau, justice et équité sont extrêmement proches, neutres d'un point de vue affectif et ayant une portée universelle : l'équité implique cependant un principe d'égalité concrète entre les hommes, alors que la justice peut ne tenir compte que d'une égalité toute formelle en ne considérant par exemple que les actes commis et en négligeant les circonstances.
Un tel graphique [68] (qui peut se présenter de différentes façons) permet, on le voit, de « penser » le film, d'évaluer le comportement des différents personnages et leur évolution éventuelle au cours de l'histoire mise en scène, mais également des éléments filmiques précis comme la musique du film (la chanson qui donne son titre au film penche évidemment du côté de l'affectif) ou certains cadrages (les plans d'ensemble visent par exemple à souligner à certains moments la solidarité de groupe des travailleurs). Il permet aussi de caractériser de façon beaucoup plus précise l'attitude des différents spectateurs eux-mêmes : certains seront sans doute plus sensibles au caractère attachant des personnages, à leur gentillesse, à leur dévouement, alors que d'autres souligneront les valeurs de solidarité dont ils font largement preuve. Tout cela mérite bien sûr d'être nuancé en fonction des situations et des moments du film, mais, grâce cet outil d'abstraction, il est possible d'articuler les deux aspects essentiels des films de fiction, à savoir, d'une part le caractère concret des personnages et des événements mis en scène, et, d'autre part, des significations (qu'il s'agisse de « valeurs », de « thèses » ou d'« idées ») nécessairement plus générales, plus abstraites et qui restent le plus souvent à l'état implicite.
Outre le texte écrit, outre les nombreux types de graphiques, il existe différentes formes « d'écriture » exploitables dans l'analyse filmique.
La plus évidente, qui a déjà été évoquée incidemment, est le simple dialogue entre spectateurs qui doit leur permettre notamment d'expliciter leurs impressions, mais aussi d'organiser leurs idées, de les clarifier, de les ordonner et de les confronter entre elles. De multiples méthodes d'animation sont susceptibles d'être utilisées pour mener de façon constructive de telles discussions : certaines comme le dialogue philosophique [69] connaissent un succès croissant, d'autres sont moins connues, mais méritent qu'on s'y attarde [70] ; ces méthodes ont souvent des objectifs différents (la maîtrise du raisonnement, l'éducation à la citoyenneté, la défense de la démocratie, la promotion de la santé...) et des orientations contrastées (privilégiant par exemple la dimension émotionnelle ou au contraire l'expression des idées), mais elles peuvent être mises au service de l'analyse filmique pour autant que l'on procède de manière réfléchie en clarifiant notamment les objectifs poursuivis qui sont évidemment spécifiques à l'éducation aux médias.
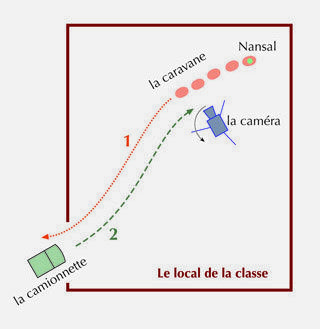
Le Chien jaune de Mongolie
un film de Byambasuren Davaa (2005)
On suggère de refaire dans un local fermé (une classe par exemple) avec les moyens du bord (comme un téléphone portable) le dernier plan de ce film qui se déroule dans les steppes de Mongolie…
On signalera également l'intérêt d'une forme d'écriture médiatique que l'on pourrait qualifier d'imitatrice : de la même manière qu'on peut écrire un texte à la manière d'un écrivain célèbre, on peut imaginer de refaire avec des moyens limités un plan ou même une courte séquence qui a paru remarquable et qui mérite d'être mieux analysée. Refaire ce qui a déjà été fait permet non seulement d'observer minutieusement un court extrait, d'en apercevoir éventuellement des éléments qui n'ont pas été vus, mais également de comprendre les difficultés de réalisation [71]. Il y a également des aspects filmiques qui sont extrêmement difficiles à décrire avec des mots, mais qu'il est possible d'imiter, parfois de façon exagérée, pour mieux en saisir la particularité : c'est le cas notamment du jeu des acteurs, et nombre de spectateurs peuvent ainsi imiter les gestes, les expressions, les attitudes, les accents, les postures de leurs acteurs préférés. Loin d'être naïves ou seulement caricaturales, ces imitations permettent, bien mieux que le langage verbal, de comprendre ce qui fait la singularité du jeu de tel ou tel acteur.
Enfin, on peut imaginer d'autres formes d'expression pour l'analyse filmique comme le montage vidéo. Mais une telle démarche, si elle voulait dépasser le cadre d'une réalisation sommaire (« podcasting » d'un cours d'analyse filmique, commentaires sur des extraits vidéos d'un film...), reste actuellement exceptionnelle dans la mesure où les « coûts » (au sens le plus large) d'une telle réalisation dépassent généralement les moyens dont disposent des individus privés : actuellement, l'on comprend facilement que l'analyse filmique privilégie largement l'écrit (avec le support éventuel de graphiques), l'expression orale ainsi que leur diffusion via Internet. On va cependant revenir sur ce dernier média qui implique des compétences spécifiques en matière d'organisation.
Beaucoup de personnes ont l'occasion d'écrire des critiques, parfois sommaires, parfois plus élaborées ; les concours de critiques sont fréquents et donnent l'envie à de nombreux spectateurs non seulement de donner leur avis sur un film, mais aussi de mener une réflexion plus approfondie pour mieux étayer leur avis. L'analyse de films, au sens le plus large, tel qu'on l'a entendu ici, n'est sans doute pas réservée à une minorité ni à une élite, même si l'on reconnaîtra facilement que certains professionnels – les journalistes spécialisés, les critiques des grandes revues, les chercheurs universitaires... – ont sans doute un avis plus autorisé que d'autres.
Mais réaliser une analyse filmique, outre la lecture, la navigation et l'écriture, précédemment abordées, implique une quatrième phase, même si elle est facilement négligée parce que tellement évidente, à savoir l'édition ou la publication, ce qui relève, comme on va le voir, d'un travail d'organisation. L'on comprend immédiatement que les quatre phases que l'on a distinguées ne reflètent pas du tout un ordre chronologique : si je décide ou si j'ai la chance de participer à un concours de critiques lors d'un festival de cinéma, l'organisation de ce concours est évidemment antérieure à la vision du film généralement inédit sur lequel je vais devoir exercer mes talents ; semblablement, si je veux donner mon avis sur un site web consacré au cinéma, tout le dispositif de présentation des films avec l'espace réservé aux réactions des internautes aura été mis en place par les concepteurs du site (il s'agit très généralement d'une équipe) bien avant que je ne m'y exprime.
La publication ou l'édition constitue bien une activité d'organisation médiatique puisqu'il s'agit de rassembler des textes, des exposés oraux, des images, des vidéos ou d'autres réalisations médiatiques de quelque nature qu'elles soient, dans un ensemble médiatique cohérent ; revue de cinéma, site web, émission télévisée ou radiophonique... C'est l'organisateur de ces dispositifs qui prendra une série de décisions importantes (qui passent souvent inaperçues aux yeux du public) comme le format des textes, leur place dans la revue ou le site web, les éventuels outils de recherche ou de navigation sur un blog, les temps de parole accordés aux intervenants dans une émission radiophonique, le type de questions (généralement posées par un journaliste) à poser aux différents intervenants...
Les écrivains, les chercheurs, les critiques cinéphiles, tous ceux qui produisent des « textes médiatiques » et dont l'activité relève de ce qu'on a appelé « l'écriture » médiatique, déconsidèrent fréquemment l'étape de la publication ou de l'édition qu'ils estiment secondaire ou au service de leurs propres réalisations. Mais ils font également très souvent l'épreuve des contraintes inattendues qu'ils doivent affronter pour être effectivement diffusés ou publiés : l'éditeur exige qu'un texte soit réécrit ou raccourci, le directeur de la revue écrit un chapô [72] et des intertitres dont il est le seul maître, le critique en herbe s'aperçoit que sa réaction sur le web est limitée à quelques milliers de signes, les temps de parole dans les interviews sont strictement minutés et les tours de parole imposés, le blogueur constate que son article dense et difficile est accompagné de publicités pour des produits sans aucun rapport avec l'objet de son texte (et qui varient en outre avec les préférences du lecteur [73])...
Il faut donc considérer l'organisation médiatique comme une étape importante dans l'analyse filmique et qu'on peut articuler autour des points suivants : où et comment publier l'analyse que l'on a réalisée ? Quel est le public visé ? Quel support – écrit, audiovisuel, en réseau... – sera le plus efficace pour la diffusion ? Quel dispositif médiatique va-t-on mettre en place pour la publication d'une ou plusieurs analyses filmiques ? Quels éléments – textes, images, vidéos, graphiques, extraits sonores... – prendront place dans ce dispositif et sous quelle forme ? Ces questions sont souvent présentes dès le moment de l'écriture, au moins de façon implicite, mais elles seront certainement plus évidentes au moment de l'organisation de la diffusion médiatique.

Un compte Twitter
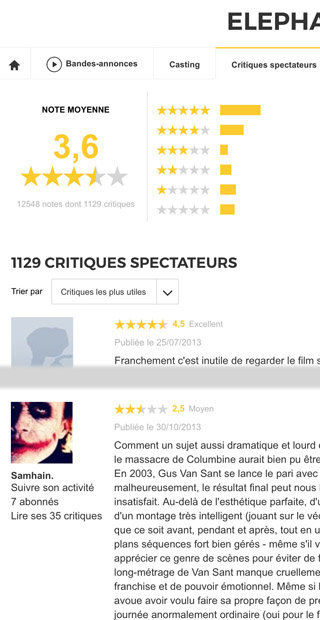
Les avis des Internautes sur AlloCine
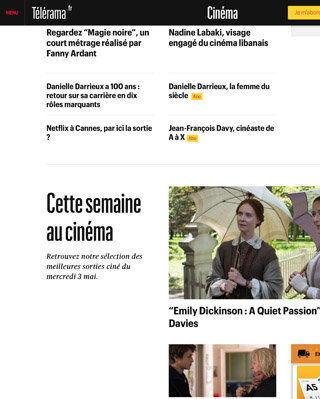
Le site web de Télérama
Trois manières différentes d'organiser l'information, de la présenter, de la hiérarchiser, de la diffuser…
Il est impossible d'évoquer, dans la perspective d'une publication d'une ou de plusieurs analyses filmiques, tous les problèmes d'organisation médiatique qui peuvent se poser et qui varient notamment en fonction des médias envisagés (presse écrite, site Internet, émission radiophonique...). On n'évoquera donc ici que quelques exemples (et quelques problèmes) d'un tel travail d'organisation médiatique.
Faire une publication sur le web est aujourd'hui une opération facile et très répandue, qu'il s'agisse d'un blog individuel, du site d'une association ou d'une école, ou d'un réseau social comme Facebook. Plusieurs choix se posent néanmoins si l'on veut par exemple publier une analyse de films. Le premier sera celui de l'orientation du lecteur potentiel : comment va-t-il trouver cette page ? Sera-t-elle insérée dans un site entièrement consacré au cinéma ? Sous quel « volet » ? Avec quelle voie d'accès ? Y aura-t-il un index de tous les films analysés ? Par titre, par réalisateur, par acteur, par succès ? Comment rendre visible cette publication ?
Il faut ensuite réfléchir à la présentation de l'analyse : avec quel titre, quels intertitres, quelle accroche ? En une seule page ou sur plusieurs ? Sera-t-elle accompagnée d'illustrations, de graphiques, d'extraits vidéos ? Il faut immédiatement remarquer à ce propos que se pose une question de droits : il n'est pas permis de reproduire de façon publique des photos de film ni des extraits vidéos, qui sont tous deux soumis au droit des auteurs. On sait que ce droit est souvent mal respecté sur Internet, et beaucoup d'images sont reproduites sans autorisation des ayant-droits. Mais les contrôles se multiplient aujourd'hui et tout responsable de sites doit s'interroger sur ce qu'il est permis de faire ou non en ce domaine. Pour l'analyse de films, cela pose un problème, car il est difficile de « montrer » certains éléments que l'on juge pertinents sans recourir à des images ou des vidéos. Or, s'il existe un droit de citation pour les textes écrits, il ne s'applique pas au domaine des images. L'illustration d'un article mérite donc qu'on s'y attarde afin de trouver la solution la plus adéquate.
De façon générale, l'existence d'outils préexistants sur Internet comme les réseaux sociaux, les blogs ou les sites « clés en main » masque souvent l'importance du travail d'organisation qui, dans ce cas, pose des problèmes simples, mais importants comme la couleur du fond, la présentation en une ou plusieurs colonnes, l'utilisation d'encadrés ou d'illustrations, la mise en évidence de certains mots ou de certaines phrases, le jeu sur des typographies différentes... À l'heure où les modes de communication sont profondément bouleversés, tous ces choix qui sont souvent faits de façon spontanée sur base de traditions plus ou moins héritées [74], méritent, on le voit, d'être questionnés.
Un autre exemple d'organisation pourrait être celui d'une table ronde retransmise par vidéo ou par radio avec plusieurs intervenants exposant leurs avis et leurs analyses d'un film. On voit facilement qu'une telle table ronde implique une division du travail entre notamment des techniciens chargés de la prise de son et du mixage, d'un journaliste ou d'un animateur chargé de poser des questions, de relancer le débat et de régler les tours de parole et d'un réalisateur qui décide du déroulement général de l'émission, de son thème, de son style, des intermèdes éventuels [75], des intervenants invités en tenant compte notamment du public auquel on s'adresse. Encore une fois, il existe des modèles préexistants d'organisation de ce genre de débats – certains très connus, d'autres moins –, mais ces modèles, aussi séduisants ou évidents soient-ils, méritent d'être interrogés et éventuellement transformés en fonction des objectifs que l'on poursuit et du contexte dans lequel on se trouve.
On n'approfondira pas toutes ces questions ici, notamment parce que les compétences en matière d'organisation médiatique sont sans doute perçues comme des compétences professionnelles comme celles d'un créateur de sites web, d'un réalisateur radiophonique ou télévisuel, d'un éditeur de journal ou de magazine. Et il est vrai qu'il s'agit là de métiers spécialisés, parfois hautement spécialisés, impliquant en outre des équipes de professionnels très diversifiées [76]. Néanmoins, dans une perspective d'éducation citoyenne, il est important de prendre conscience des enjeux liés aux dispositifs médiatiques et en particulier à leur « organisation » (au sens entendu ici) : sans prétendre à un caractère professionnalisant, un minimum de compétences en la matière est aujourd'hui certainement nécessaire.
1. CSEM (Conseil Supérieur de l'Éducation aux Médias), Les compétences en éducation aux médias. Un enjeu éducatif majeur. 2013.
Ce document est complété par Treize Propositions d'activité pédagogiques. 2015.
2. La communication met nécessairement en relation un émetteur et un récepteur. L'émetteur comme le récepteur peut être unique (l'auteur d'un roman) ou multiple (le public d'un film). L'un et l'autre peuvent être en présence l'un de l'autre (dans une conversation orale) ou se situer dans des lieux différents (dans une conversation téléphonique) et à des moments différents (le public d'une exposition d'art ancien). Mais la nature relationnelle de la communication implique nécessairement une dimension sociale.
3. En janvier 2017, un graffeur bruxellois anonyme réalise une fresque inspirée de ce tableau du Caravage qu'il recadre autour du visage d'Isaac menacé par le couteau d'Abraham. Les premiers journalistes qui évoquent cette fresque dont ils publient également une photo parlent d'une scène représentant un égorgement, et un homme politique interrogé à ce propos parle même d'un « appel à la violence ». Il faudra les réactions de lecteurs amateurs de peinture pour que la référence au tableau du Caravage apparaisse clairement. Néanmoins, des journalistes continuent à négliger la référence picturale et parlent d'une fresque qui « s'inspire très probablement de la Bible » : même s'il y a une référence biblique, celle-ci est évidemment indirecte, et le graffeur s'est inspiré d'abord et avant tout du tableau du Caravage. On voit comment la faible culture picturale des journalistes entraîne dans ce cas une double mésinterprétation. Dans une perspective d'éducation aux médias, on voit aussi comment les journalistes privilégient une « lecture » scandaleuse et scandalisée de ce genre d'événements : la fresque aurait été une incitation à la violence (et non une dénonciation de la violence par exemple).
En janvier 2017, un graffeur bruxellois anonyme réalise une fresque inspirée de ce tableau du Caravage qu'il recadre autour du visage d'Isaac menacé par le couteau d'Abraham. Les premiers journalistes qui évoquent cette fresque dont ils publient également une photo parlent d'une scène représentant un égorgement, et un homme politique interrogé à ce propos parle même d'un « appel à la violence ». Il faudra les réactions de lecteurs amateurs de peinture pour que la référence au tableau du Caravage apparaisse clairement. Néanmoins, des journalistes continuent à négliger la référence picturale et parlent d'une fresque qui « s'inspire très probablement de la Bible » : même s'il y a une référence biblique, celle-ci est évidemment indirecte, et le graffeur s'est inspiré d'abord et avant tout du tableau du Caravage. On voit comment la faible culture picturale des journalistes entraîne dans ce cas une double mésinterprétation. Dans une perspective d'éducation aux médias, on voit aussi comment les journalistes privilégient une « lecture » scandaleuse et scandalisée de ce genre d'événements : la fresque aurait été une incitation à la violence (et non une dénonciation de la violence par exemple).
On relèvera encore qu'un des premiers articles évoquant cette fresque affirme que « le dessin représente visiblement une femme, coincée au sol et menacée d'égorgement ». L'erreur d'interprétation est manifeste mais mérite d'être interrogée : elle témoigne certainement d'un préjugé de genres qui associe spontanément la violence à la masculinité et corrolairement la position victimaire à la féminité. Le journaliste « voit visiblement » ce qu'il croit, à savoir que les bourreaux ne peuvent être que des hommes, et les victimes des femmes.
4. C'est le cas de la règle dite des 180° : si l'on filme deux personnages en champ-contrechamp, la caméra doit rester du même côté d'une ligne imaginaire reliant les deux personnages et se déplacer donc dans un espace de 180° seulement. Si cette règle n'est pas respectée, le spectateur aura l'impression que les personnages ne sont pas face-à-face ou qu'ils ont changé instantanément de position ou de posture. Cette règle a un corollaire appelé le raccord des regards, à savoir qu'à l'image, l'un des interlocuteurs regardera vers la droite du cadre, et l'autre vers la gauche donnant ainsi l'impression d'un échange ou d'un croisement des regards. Le non-respect de la règle des 180° a pour effet de donner l'impression que les deux personnages regardent dans la même direction. Bien entendu, cette règle qui est le résultat de constatations empiriques des cinéastes n'est pas absolue et peut être enfreinte de multiples manières. À l'inverse, le respect de cette règle ne garantit pas que le raccord sera « réussi » si d'autres éléments (comme l'éclairage) se révèlent contradictoires avec l'effet de continuité recherché. (Voir illustration ci-contre)
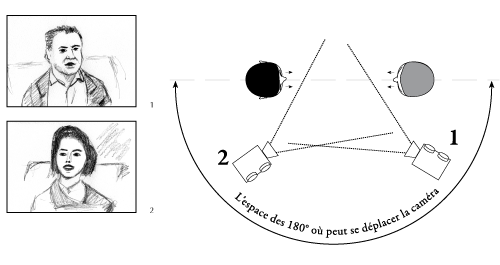
Une illustration de la règle des 180°
Dans la pratique, cette règle souffre de nombreuses exceptions.
5. Cette remarque doit bien sûr être considérée comme légèrement ironique. Il s'agit seulement de souligner le fait que l'utilisation de la télécommande favorise le « zapping », donc des informations présentées de façon brève et spectaculaire. Or certains objets médiatiques impliquent une « lecture » longue et approfondie, qu'il s'agisse d'un livre (par exemple un roman), d'un film (par exemple d'auteur), d'une série télévisée (avec des caractères se développant sur plusieurs épisodes) ou d'un argumentaire construit. Le zapping a manifestement favorisé un nouveau style de télévision, cherchant constamment à relancer l'attention du spectateur par des informations (au sens le plus large du terme) brèves, frappantes et très diversifiées ainsi que par des variations constantes de rythme, d'intensité et de forme.
6. On voit évidemment à travers cet exemple que la distinction entre navigation et organisation ne doit pas être considérée de manière trop tranchée. Il y a certainement une zone de recouvrement, et certaines activités peuvent être vues aussi bien comme de la navigation que comme de l'organisation. On observe bien sûr le même continuum entre d'une part la lecture et la navigation et d'autre part entre l'écriture et l'organisation. Même la distinction entre écriture et lecture connaît certains recouvrements : quand je souligne au marqueur les phrases importantes dans un texte, je mélange ma lecture à un acte d'écriture graphique (le soulignement).
7. Dans le domaine du cinéma, l'exemple des studios RKO est célèbre au point que l'on parle désormais d'un « style RKO ». Fondés par la RCA, une société de radio, ces studios seront marqués depuis leur naissance en 1928, au moment où apparaît le cinéma parlant, par des personnalités comme le producteur David Selznick ou un directeur artistique talentueux, Van Nest Polglase, qui donneront une touche spécifique à un grand nombre de réalisations de ces studios.
8. Cette définition de la réalisation comme travail d'organisation risque de heurter les tenants de la conception française du cinéma d'auteur, auteur qui serait responsable de tous les choix esthétiques et qui maîtriserait tous les aspects de la création cinématographique. Il faut évidemment reconnaître que certains réalisateurs contrôlent de façon minutieuse le travail de leurs collaborateurs et impriment leur marque personnelle aux différents aspects, même mineurs, de ce travail. En outre, toutes les collaborations auxquelles le cinéaste fait appel sont mises au service de la réalisation d'un film unique et non d'un rassemblement d'objets médiatiques comme un journal. On doit donc considérer que la réalisation d'un film consiste bien d'abord en une activité d'« écriture » cinématographique. Mais considérer cette activité sous l'angle de l'organisation permet de mettre en évidence la part importante du travail de collaboration entre différents spécialistes techniques mais aussi artistiques, tout en soulignant certains continuums entre l'écriture et l'organisation : dans les séries télévisuelles, l'on constate par exemple que les différents épisodes sont souvent dirigés par plusieurs réalisateurs qui ne peuvent dès lors pas être considérés comme les auteurs de la série entière ; d'autres réalisations comme les journaux télévisés se présentent a priori comme une collection d'objets médiatiques – les interventions du présentateur, l'interview d'un témoin, les reportages faits à l'extérieur, etc. –, et le rôle du réalisateur sera alors vu comme celui d'un organisateur (proche d'un éditeur de journal) ; mais le journal télévisé constitue également un objet unique (en particulier quand les spectateurs le regardent de bout en bout) avec une manière singulière (différente de celle d'une autre chaîne) de présenter l'information, de la hiérarchiser, de privilégier certaines valeurs (morales, politiques ou même affectives) et certaines caractéristiques esthétiques (au sens le plus large), ne serait-ce que le choix du décor de présentation. Dans ce cas, la différence entre écriture et organisation a donc tendance à s'estomper.
9. On se souviendra que le spectateur du film se demande pendant un long moment quelle est l'apparence exacte de cette créature : celle-ci constitue donc bien une information qui peut être partielle, qui peut également être retardée ou différée.
10. Les spécialistes opposent facilement, dans l'analyse et la théorie filmiques, des éléments qui seraient spécifiquement cinématographiques (les mouvements de caméra, le cadrage, le montage...) à d'autres qui ne le seraient pas (le scénario, les « thèmes », l'idéologie...) et qui seraient de ce fait secondaires et inessentiels. Mais l'opposition ne repose pas sur des critères « formels » et résulte en réalité d'un processus de division historique du travail cinématographique au terme duquel les cinéastes ont été reconnus comme les auteurs « véritables » des films au détriment notamment des scénaristes (mais également des acteurs ou des producteurs) dont la participation a été définie comme secondaire. On trouvera des indications complémentaires sur cette question dans Michel Condé, « Le réalisateur, figure historique », in Comment parler d'un film ? Liège, Les Grignoux, 2010, p. 21.
11. La place manque ici pour expliquer pourquoi le son au cinéma est fondamentalement une image, un enregistrement qui ne se confond pas avec la « réalité » qu'il représente. Remarquons seulement que le son au cinéma peut faire l'objet (comme l'image visuelle d'ailleurs) de nombreuses déformations ou distorsions qui révèlent sa nature médiatique et représentationnelle.
12. On peut à ce propos se reporter à un ouvrage classique comme celui de Marcel Martin, Le Langage cinématographique, Paris, Cerf, 2001 (5e édition).
13. Une caractéristique essentielle de l'image est qu'elle est continue alors que la langue est constituée d'éléments discontinus (qu'on appelle en linguistique des éléments discrets) comme les phonèmes /p/ et /b/ qui permettent de distinguer sans ambiguïté « pas » et « bas ». L'observation des caractéristiques d'une image est donc potentiellement infinie : aujourd'hui, une photographie numérique est par exemple composée d'environ un million de pixels (de « points ») qui chacun d'entre eux peuvent être caractérisés par 16,7 millions de nuances de couleur différentes. La question est donc non pas de tout observer – ce qui est impossible – mais de déterminer la pertinence des éléments ou des traits à observer.
14. Ce qu'on appelle la « forme » (par opposition au contenu) est en fait porteur d'un sens, dans ce cas, esthétique.
15. On peut considérer qu'une part importante de notre connaissance du monde est faite d'images mentales – je garde en mémoire l'image de mes connaissances –, mais ces « images » sont évidemment d'une nature fondamentalement différente des photographies ou des images de cinéma.
16. Telle que cette notion est définie notamment par Jean-Michel Adam en particulier dans Les textes types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue, Armand Colin, 2005 (2e édition). Cette typologie textuelle a été adaptée à l'analyse filmique par Michel Condé, Comprendre le sens d'un film. À propos de six films récents, Liège, Les Grignoux, 1995
17. On peut se reporter à l'ouvrage classique d'André Bazin, Orson Welles, Paris, Ramsay, 1985 et à la relecture du film de Jean-Pierre Berthomé et François Thomas, Citizen Kane, Paris, Flammarion, 1992.
18. Le Dernier des Hommes de Friedrich Murnau (1924) est un exemple célèbre de film muet avec très peu d'intertitres.
19. Ce n'est pas tout à fait exact : la littérature n'a pas besoin de tout expliciter pour dire les choses, et il suffit qu'on nomme « un policier » pour que nous imaginions aussitôt un uniforme mais aussi des schèmes de comportements plus ou moins standardisés (« un policier arrête les voleurs », etc.)
20. Un exemple célèbre de cette confusion a été mis en évidence par le cinéaste russe Lev Koulechov (1899-1970) qui fit l'expérience suivante : « D'après le témoignage de Poudovkine, Koulechov choisit dans un film de Bauer trois gros plans assez neutres de l'acteur Ivan Mosjoukine, le regard porté vers le hors-champ, qu'il monta avant trois plans représentant : 1) Une assiette de soupe sur une table. 2) Une jeune femme morte gisant dans un cercueil. 3) Une fillette en train de jouer. Les spectateurs, écrit-il, admirèrent le jeu de Mosjoukine qui savait merveilleusement exprimer : 1. L'appétit. 2. La tristesse. 3. La tendresse... » Cette expérience, dont l'interprétation est toujours objet de discussions, signale au moins que la réception filmique est un processus largement intuitif dont les « mécanismes » échappent à la perception consciente de la plupart des spectateurs.
21. Dans Profession : reporter, la caméra installée dans une chambre s'avance vers la fenêtre ouverte mais barrée par une grille verticale : le mouvement fluide et très lent du cadre nous fait traverser presque naturellement cet obstacle qui aurait dû pourtant s'opposer à l'avancée de la caméra qui se retrouve bientôt dans la rue à l'extérieur de la chambre. Un trucage a évidemment été nécessaire pour réaliser ce plan, mais certains spectateurs, qui ne sont pas sensibles à la présence de la caméra, ne perçoivent pas la prouesse technique que constitue le tournage de ce plan.
22. Dans la Soif du mal par exemple, la fluidité du mouvement de la caméra contraste esthétiquement avec l'obstacle physique et administratif que constitue le poste frontière entre le Mexique et les États-Unis.
23. On trouvera d'autres exemples de gestes particulièrement significatifs dans ce film de Clint Eastwood sur le site des Grignoux la page de présentation d'une animation sur ce film (en réponse à la consigne d'observation 6).
24. On trouvera sur le site des Grignoux plusieurs exemples d'une telle démarche appliquée au film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby (à la page déjà citée), ou au Mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès (à la page suivante) ou bien au film de François Ozon Potiche (à la page suivante) ou encore à Rosetta de Jean-Pierre et Luc Dardenne dans le dossier réalisé par les Grignoux.
25. Pour rappel, l'inférence désigne toute forme de raisonnement, plus ou moins logique, plus ou moins étayé par des prémisses supposées vraies : « Inférence est [...] le terme le plus général, dont raisonnement, déduction, induction, etc., sont des cas spéciaux » (André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, PUF, 1923). Les inférences sont innombrables et spontanées mais sont néanmoins construites : ainsi, Jean Piaget (La construction du réel chez l'enfant, Neuchâtel; Delachaux et Niestlé, 1937) a montré que les tout jeunes enfants n'ont pas la « permanence » de l'objet et croient que le jouet qui disparaît de leur vue n'existe plus. En revanche, devenus adultes, nous nous baissons pour ramasser la salière tombée de la table et nous serions très étonnés de ne pas la trouver sur le sol !
26. Au-delà de certaines caractérisations sommaires – sobre, intense, expressionniste, excessif, tout en retenue... –, il est par exemple très difficile de définir précisément le jeu d'un acteur. De façon similaire, un mouvement de caméra complexe comme un plan-séquence tourné au steadycam (une caméra portée sur un harnais avec des systèmes d'amortisseurs qui fluidifient le mouvement) sera généralement perçu de façon globale sans pouvoir être analysé en détail.
27. Il est donc possible en principe de porter des jugements de valeur objectifs sur des objets comme des œuvres d'art pour autant que l'on s'accorde préalablement sur des échelles ou des critères d'évaluation : il est incontestable que la peinture d'Édouard Manet est novatrice par rapport à celle de ses contemporains Meissonnier ou Bouguereau. Mais le choix de tel ou tel critère reste subjectif. En outre, certains de ces critères sont peu manipulables : c'est le cas de l'originalité artistique, largement valorisée par les avant-gardes, mais qui est souvent difficile à mesurer de façon précise.
28. On trouvera à ce propos des réflexions plus développées dans notre étude intitulée : Cinéma et éducation aux médias. Quelles compétences sont nécessaires pour voir, comprendre et analyser un film ?
29. Ces œuvres sont seulement citées à titre d'exemple, et les spécialistes pourraient bien sûr contester ces oppositions simplistes entre différents moments de la carrière de ces grands cinéastes, mais des analyses plus nuancées conduiraient seulement à des distinctions plus fines, destinées à montrer notamment l'originalité de chacune des réalisations en cause. Ainsi, Fenêtre sur cour et Vertigo de Hitchcock, très généralement considérés comme des sommets de sa carrière hollywoodienne, ne peuvent évidemment pas être confondus l'un avec l'autre.
30. Cf. notamment Jacques Rivette, « Génie de Howard Hawks », Cahiers du cinéma, n° 23, mai 1953, p. 16-23.
31. La présence dans un film d'une actrice jeune et jolie ne « prouve » rien : ce choix peut s'expliquer par les nécessités du scénario, par la renommée de l'actrice ou par de multiples raisons plus ou moins contingentes. Seule une analyse statistique (plus ou moins rigoureuse) peut faire apparaître la « prime » donnée au physique des acteurs et surtout des actrices, mais également le décalage d'âge dans les couples à l'écran où la femme est très généralement plus jeune que son compagnon ou mari (l'égalité est fréquente, mais il est exceptionnel que l'homme paraisse plus jeune que sa compagne).
32. Les « études de genres » s'intéressent à la construction des genres (masculin/féminin, hétérosexuel/homosexuel/transexuel...) à travers les représentations sociales dans la mesure où elles considèrent que les genres sont d'abord et avant tout une construction culturelle et non un fait de nature ; en second lieu, elles analysent les répercussions de ces représentations « genrées » au niveau des réalités sociales, politiques, économiques, culturelles (au sens étroit), etc. Ces études se sont surtout développées aux États-Unis mais ont rencontré des résistances importantes dans le domaine francophone. On lira néanmoins l'ouvrage en français de Noël Burch et Geneviève Sellier, La Drôle de guerre des sexes du cinéma français : 1930-1956, Paris, Nathan Université, 1996.
33. Dans Baïonnette au canon, un des personnages principaux meurt d'une balle qui a ricoheté sur les parois de la grotte où la petite troupe s'est réfugiée.
34. Auteur par ailleurs en 1949 d'un documentaire, Le Sang des bêtes, sur les abattoirs parisiens, que ne renieraient pas les défenseurs de la cause animale aujourd'hui.
35. On trouvera un compte rendu de cette animation à la page suivante.
36. Pour une analyse plus complète, l'on peut se reporter au dossier pédagogique réalisé par les Grignoux sur la Haine.
37. On trouvera dans le dossier pédagogique réalisé par les Grignoux et consacré à la Haineune analyse procédant à une « navigation » à travers dix documents qui, par comparaison, éclairent de diverses manières le film de Mathieu Kassovitz.
38. On remarquera dès à présent que notre connaissance d'une réalité sociale comme « les banlieues françaises » provient pour la plus grande part des médias et n'est donc pas directe : même l'habitant d'une cité ne connaît immédiatement que sa cité ou les cités environnantes, et c'est essentiellement par les médias – télévision, Internet, réseaux sociaux... – qu'il appréhende la situation supposée générale des « banlieues ». Nous n'avons pas de relation directe avec la plus grande partie de la réalité qui nous entoure, et c'est par une navigation à travers de multiples médias que nous nous faisons une idée de ce que sont par exemple les « États-Unis », le « monde politique », la « Deuxième Guerre mondiale », les « nuits parisiennes », les « violences conjugales », le « monde de l'art », la « finance internationale »... Même si nous pouvons connaître certains aspects d'une telle réalité, par exemple une mère célibataire, c'est à travers les médias que nous aurons une connaissance générale de la situation difficile des « mères célibataires » : bien entendu, l'image donnée par les médias n'est pas nécessairement homogène, et c'est par une navigation entre différents médias que j'adhérerai sans doute à la représentation (médiatique) qui correspond le mieux à ma connaissance personnelle d'une telle réalité.
39. Le tag « vengeance » donne plus de mille titres de films sur AlloCiné !
40. On pourra se reporter au dossier pédagogique réalisé par les Grignoux sur le Fils, en particulier au chapitre intitulé « Personne ne ferait ça », pages 31 à 34.
41. Une telle comparaison implique souvent, notamment dans le champ de la critique, un jugement de valeur implicite, le cinéma étant perçu comme un art moins prestigieux, moins raffiné, moins complexe, plus « pauvre » que la littérature. L'adaptation serait nécessairement une trahison, et la comparaison sera très généralement faite en défaveur du cinéma : mieux vaudrait lire le Nom de la rose d'Umberto Eco que de voir le film qu'en a tiré Jean-Jacques Annaud. On devine aussi que, pour certains professeurs de français ou de littérature, l'adaptation est utilisée comme un pis-aller pour des élèves qu'on juge incapables de lire l'œuvre originale. (On trouvera dans le dossier pédagogique réalisé par les Grignoux sur le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud une comparaison avec le roman original.)
42. On trouvera un exemple d'une telle comparaison dans un document complémentaire au dossier pédagogique réalisé par les Grignoux sur le film de Roman Polanski, disponible à la page suivante.
43. On trouvera sur le site des Grignoux quelques exemples commentés d'une telle démarche./p>
44. La fiction a un statut différent de l'erreur ou du mensonge. Un mensonge est un énoncé faux mais présenté comme vrai par son auteur dans un but de tromperie. Une erreur est un énoncé faux (du moins de notre point de vue) mais que son auteur croit vrai. La fiction est un énoncé faux – Mme Bovary n'a jamais existé – mais que son auteur ne prétend pas être vrai comme l'indique par exemple la mention « roman » sur la couverture : par convention, auteur et lecteur (ou spectateur de film) ne questionnent pas la valeur de vérité de la fiction dans le cadre limité du roman ou du film. Mais dès que l'on sort de ce cadre, on peut mettre en cause la vérité plus ou moins grande de la fiction : Mme Bovary, personnage fictif, peut-elle être par exemple considérée comme représentative des femmes de la bourgeoisie provinciale en France au 19e siècle ?
45. On trouvera sur le site des Grignoux un exemple d'un tel travail consacré au film Amen de Costa-Gavras qui met en scène un épisode authentique du génocide des Juifs par les nazis (connu sous le nom de « rapport Gerstein ») mais qui modifie néanmoins certains éléments de la réalité (sans que cela n'implique la moindre volonté de falsification de la part du réalisateur).
46. On signalera que plusieurs films traitant de sujets sensibles comme les mariages forcés, les « crimes d'honneur » ou le viol légitimé ou non par certaines traditions (par exemple Difret de Zeresenay Mehari, Die Fremde de Feo Aladag, La Squale de Fabrice Genestal, Noces de Stephan Streker ou encore Mustang de Deniz Gamze Ergüven) ont pu être très mal reçus par certains critiques ou certains spectateurs parce qu'ils donnent l'impression d'ériger un fait divers extrême ou exceptionnel (même s'il est authentique) en « révélateur » d'une situation sociale ou culturelle beaucoup plus large, stigmatisant ainsi toute une communauté ou toute une société (généralement étrangère).
47. On pourra se reporter à ce propos aux analyses proposées dans le dossier réalisé par les Grignoux et consacré au film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake.
48. Bien entendu, même un film de pure distraction traduit un certain point de vue, ne serait-ce que « Mieux vaut se distraire que penser à des choses sérieuses ! »
49. On trouvera une analyse plus complète de ces différentes versions sur le site des Grignoux à la page suivante.
50. On se reportera à ce propos aux réflexions développées dans l'étude suivante : Michel Condé, Comment parler d'un film ? le cinéma comme lieu de réflexion, d'échange et de discussion, Liège, Les Grignoux, 2010, p. 12-19.
51. On a également proposé dans un dossier pédagogique intitulé Regards documentaires une méthodologie pour dégager un axe d'analyse générale pour les documentaires.
52. En sémiotique, un métalangage est donc un langage qui permet de parler d'un autre langage. De façon plus spécifique, la fonction métalinguistique, telle que l'entend notamment Roman Jakobson, consiste à utiliser la langue pour parler de la langue elle-même (par exemple dans un manuel de grammaire).
53. On remarque ainsi que beaucoup de DVD proposent un commentaire du réalisateur ou d'un spécialiste à la place (ou en complément) de la bande-son originale : là encore, l'analyse passe d'abord et avant tout par la langue.
54. Roland Barthes avait déjà fait une remarque similaire, considérant à l'inverse de Saussure que la sémiologie (la « science des signes » de quelque nature qu'ils soient) était une partie de la linguistique parce que la signification (des signes) passe toujours par le système de la langue (on ne peut pas « penser » sans la langue). On ne partagera pas ici ce point de vue radical qui, à la fois, donne une prééminence théorique à la « langue » et institue une différence de nature entre la langue et le monde (supposé être une masse informe, en soi non-signifiante). On recommandera à ce propos le dernier ouvrage du groupe µ, Principia Semiotica. Aux sources du sens (Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2015) qui s'interroge de façon nouvelle sur l'origine naturelle de la signification (que nous partageons avec d'autres espèces animales évoluées). C'est dans un contexte pratique d'apprentissage que nous soulignons seulement le rôle central de la langue dans la relation pédagogique.
55. On analyse classiquement un schéma narratif en cinq étapes : une situation initiale, un événement déclencheur ou perturbateur, des péripéties, la résolution et la situation finale, qui peuvent être représentées graphiquement sous forme de cinq cases ou cinq « boîtes » alignées horizontalement. Cette structure est souvent considérée comme universelle – tous les récits se présenteraient ainsi – mais cela n'est pas réellement démontré.
56. A. J. Greimas distingue le sujet, l'objet (par exemple de la quête), l'adjuvant, l'opposant, le destinateur (celui qui désigne l'objet de la quête) et le destinataire (à qui l'on désigne l'objet de la quête).
Greimas considère qu'il s'agit d'actants universels mais dans ce cas aussi la démonstration n'en a pas été réellement faite. Greimas écrit à propos de ce modèle actanciel mythique dans sa Sémantique structurale de façon très prudente : « Induit à partir des inventaires, qui restent, malgré tout, sujets à caution, construit en tenant compte de la structure syntaxique des langues naturelles, ce modèle semble posséder, en raison de sa simplicité, et pour l'analyse de ses manifestations mythiques seulement, une certaine valeur opérationnelle. Sa simplicité réside dans el fait qu'il est tout entier axé sur l'objet du désir visé par le sujet, et situé, comme objet de communication, entre le destinateur et le destinataire, le désir du sujet étant, de son côté, modulé en projections d'adjuvant et d'opposant ». (Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 180).
57. Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'invalider ces théories qui sont plus complexes que la brève présentation qui en est faite ici : beaucoup de films, beaucoup de romans comprennent ainsi plusieurs récits, soit successifs, soit enchâssés les uns dans les autres, ce qui suffit à complexifier le modèle initial.
58. On trouvera un exemple de ce schéma dans l'analyse que les Grignoux ont consacrée au film de Sam Garbaski, Irina Palm.
59. Dans la théorie du récit, ces quatre ou cinq étapes « valent » en fait pour une seule (ce sont des « épreuves » réussies ou ratées par les protagonistes), mais l'on voit tout l'intérêt à bien les distinguer dans ce cas-ci. On pourra se reporter au dossier pédagogique réalisé par les Grignoux à propos de Charlie et la chocolaterie de Tim Burton.
Les quatre épisodes principaux de Charlie et la chocolaterieChaque épisode a une couleur dominante tout-à-fait identifiable — vert, noir, bleu, blanc —, comme les Oompa-Loompas qui changent chaque fois de costume — rouge, noir, jaune, blanc —. Ces couleurs sont également très franches, très pures, très homogènes. Même le chocolat est d'un beau brun luisant qui a de véritables reflets comme un miroir. |
|||
|
La salle où disparaîtra Augustus est tapissée d'une herbe verte et traversée par une rivière de chocolat d'un brun éclatant. Les « arbres » de ce décor sont de multiples couleurs, mais l'on se souvient notamment d'un rouge appétissant qui barbouillera notamment la bouche de la mère de Violette. Les Oompa-Loompas qui plongeront l'un après l'autre, comme dans un ballet aquatique, dans la rivière de chocolat ont quant à eux des combinaisons rouge vif. |
La couleur du laboratoire où Violette se transformera en énorme myrtille n'est pas très marquante : le fond général est noir avec des appareils de verre ou de métal luisant avec quelques taches de couleur de-ci de-là. Les Oompa-Loompas qui pousseront dehors l'énorme myrtille qu'est devenue Violette porteront des combinaisons noires. |
L'atelier des écureuils, on s'en souvient facilement, est comme un ciel d'été, bleu clair avec de grandes lignes blanches qui forment une spirale vers le centre de la salle où se trouve le conduit à ordures. Les Oompa-Loompas qui chanteront leur petite chanson en l'honneur de Véruca et de son père sont d'un jaune éclatant comme le soleil. |
Enfin, comment oublier la salle de télévision, tellement blanche que les personnages doivent mettre de grosses lunettes fumées pour ne pas être éblouis ! Cette fois, les Oompa-Loompas se fondent dans le décor puisque leurs combinaisons sont également d'un blanc immaculé (avec quelques touches noires). |
60. On trouvera deux exemples différents d'un tel schéma dans le dossier réalisé par les Grignoux et consacré au film de Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de Bergerac et dans celui consacré au Château de ma mère d'Yves Robert.
61. On trouvera un exemple d'un tel schéma dans le dossier pédagogique réalisé par les Grignoux et consacré à la Promesse.
62. Cf. le dossier réalisé par les Grignoux sur la Liste de Schindler.
63. On en trouvera quelques exemples dans les dossiers pédagogiques que les Grignoux ont réalisés entre autres sur : Disconnect de Henry Alex Rubin (2013) (page 10 du dossier), Mustang de Deniz Gamze Ergüven (2015) (page 8 du dossier) ou encore Joue-la comme Beckham de Gurinder Chadha (2002) (page 7 du dossier)
64. Cf. le dossier réalisé par les Grignoux sur le Roi et l'Oiseau (page 19-23)
65. Cf. le dossier réalisé par les Grignoux sur le Cheval venu de la mer.
66. On se reportera à la page suivante du dossier pédagogique des Grignoux consacré à Amistad.
67. Cf. le dossier réalisé par les Grignoux sur Elephant de Gus Van Sant (page 20).
68. Ce graphique est plus largement commenté dans le dossier pédagogique que les Grignoux ont réalisé sur les Neiges du Kilimandjaro.
69. On consultera notamment le site http://www.philocite.eu
70. Alain Douiller, 25 techniques d'animation pour promouvoir la santé. Brignais, Le Coudrier, 2015, notamment pages 100 à 104.
71. On a ainsi proposé de refaire dans une classe scolaire avec les moyens du bord le dernier plan du film Le Chien jaune de Mongolie de Byambasuren Davaa (2005). Ce plan en apparence très simple se relève dans le cadre d'une telle analyse « imitatrice » comme hautement élaboré.
72. Dans le domaine journalistique, un chapô est un court texte d'introduction, généralement en gras, qui surmonte l'article et qui doit inciter à la lecture de l'article. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un « bon » chapô n'est généralement pas un résumé de l'article mais plutôt la mise en évidence d'un élément saillant de l'article qui interpelle le lecteur et le pousse à lire la suite.
73. L'on sait qu'aujourd'hui, ce sont les préférences du visiteur du site web qui déterminent très souvent, grâce à des cookies, les publicités qu'il voit. Ces cookies, qui s'installent au gré de sa navigation, emmagasinent les différents choix qu'il a faits et qui révèlent progressivement ses centres d'intérêt : la publicité qui lui sera adressée quand il visitera un nouveau site sera personnalisée grâce aux informations recueillies par ces cookies.
74. Un professeur d'université en sciences humaines a ainsi exigé d'un étudiant que les images d'illustration de son travail de fin d'études soient rejetées en annexe : il s'agissait en l'occurrence d'une analyse de certains réseaux sociaux, et les illustrations consistaient en captures d'écran d'échanges significatifs. Pour ce professeur, le modèle de l'étude en sciences humaines restait ainsi le texte écrit en continu, seulement divisé en chapitres avec une introduction et une conclusion. Magazines et journaux recourent aujourd'hui à des mises en pages bien plus complexes avec des illustrations, des encadrés, des « pavés » qui favorisent une lecture rapide et brève, mais qui restent interdites dans le monde universitaire.
75. L'utilisation de moments musicaux est fréquente à la radio, mais il faut rappeler à nouveau qu'elle est soumise, comme la reproduction d'images, au droit d'auteur.
76. La conception d'un site web implique ainsi aujourd'hui souvent un développeur, un webdesigner, un responsable technique, un responsable de sécurité, un ergonome, ces différents intervenants travaillant généralement sous la direction d'un chef de projet. La liste de ces métiers évolue d'ailleurs grandement, avec par exemple l'apparition des tablettes et des téléphones mobiles.