





Le film historique : quelle vérité ?
une étude réalisée par les Grignoux
Cette étude consacrée au film historique s'adresse à un public d'adultes intéressés par le cinéma ainsi qu'aux animateurs en éducation permanente. Son objectif est de susciter une réflexion sur un genre cinématographique populaire et largement diffusé mais qui pose de nombreuses questions quant à l'éventuelle authenticité des films effectivement produits et de leurs rapports avec le savoir historique de type scientifique.
Cliquez ici pour obtenir une version pdf facilement imprimable de ce document![]()
Le film historique est un des genres cinématographiques les plus anciens - en France, dès 1908, André Calmettes réalise l'Assassinat du duc de Guise ; en Italie, Cabiria de Giovanni Pastrone, sorti en 1914, est un des premiers péplums à connaître un immense succès ; et aux États-Unis, Naissance d'une Nation de William Griffith, un film pourtant violemment raciste sur les conséquences de la Guerre de Sécession, révolutionne l'art du montage et de la narration cinématographiques -, et, contrairement à d'autres genres comme le western qui ont connu des périodes d'éclipse, il sera illustré tout au long du vingtième et vingt-et-unième siècles par des films aussi différents que le Cuirassé Potemkine d'Eisenstein (1925), Napoléon d'Abel Gance (1927), Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz (1963), Spartacus de Stanley Kubrick (1964), Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci (1987), Le Destin de Youssef Chahine (1996), La Chute d'Oliver Hirschbiegel (2006), Lincoln de Steven Spielberg (2013)... Certains personnages ou certains événements sont ainsi régulièrement représentés au cinéma, sans doute de manière très différente comme Jeanne d'Arc mise en scène notamment dans La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Dreyer (1928), Joan of Arc de Victor Fleming (1948), Sainte Jeanne d'Otto Preminger (1957), Le Procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson (1962), Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette (1994) ou encore Jeanne d'Arc de Luc Besson (1999).
De nombreuses études universitaires[1] ont été consacrées à ce genre et s'attachent en particulier à la manière dont les films représentent certains événements historiques, tout en soulignant l'influence que des préoccupations contemporaines ont sur cette représentation : loin d'être un simple reflet du passé, les films historiques (comme les autres d'ailleurs) traduisent très généralement des valeurs, des opinions, des certitudes et parfois des partis pris qui appartiennent au temps présent - celui de la réalisation - et qui sont parfois très éloignés de l'époque mise en scène.
La perspective adoptée ici cependant sera différente, privilégiant une approche centrée sur l'éducation permanente : il s'agira essentiellement de prendre en compte le point de vue des spectateurs de cinéma que nous sommes tous à un degré plus ou moins important. L'objectif sera moins d'étudier le film historique comme genre que de mieux comprendre comment nous regardons un film de ce type, comment nous l'interprétons, comment nous le percevons, le jugeons, l'apprécions notamment en termes de représentation historique fidèle ou au contraire fausse, tendancieuse, partiale ou erronée... D'emblée, on soulignera que les réponses à une telle interrogation seront nécessairement partielles dans la mesure où le « spectateur » de cinéma - défini de façon abstraite ou universelle - n'existe pas et que l'on doit prendre en compte la diversité des publics, que ce soit d'un point de vue social, historique ou simplement individuel. En l'absence d'enquêtes sur les publics de cinéma (en particulier si l'on considère un genre spécifique comme le film historique[2]), on visera avant tout à susciter le questionnement des spectateurs (et lecteurs) face à la représentation cinématographique de l'Histoire.

La Liste de Schindler de Steven Spielberg

Shoah de Claude Lanzmann
Avant d'aborder la question de la représentation - vraie ou fausse, authentique ou biaisée, partielle ou partiale... - de l'histoire, il faut se demander ce qu'est un film historique ou plus exactement comment, en tant que spectateurs de cinéma[3], nous reconnaissons un film comme étant historique. La psychologie cognitive nous apprend que nous utilisons rarement des concepts définis de façon abstraite et formelle et que nous privilégions un exemple type[4]pour déterminer une catégorie plus large : si je dois parler d'un oiseau, je penserai plus facilement à un moineau ou à un canari qu'à une autruche, et j'en conclurai peut-être trop rapidement et de façon erronée que les oiseaux volent contrairement aux mammifères (car j'aurai également oublié qu'il y a des mammifères volants comme les chauves-souris...).
Dans le cas du film historique, l'on comprend facilement que le choix de l'exemple type va dépendre très largement de la culture cinématographique des spectateurs (qui dépend elle-même de leur âge, de leur éducation, de leur situation sociale...) : pour un spectateur dans les années 1960, Le Jour le plus long pourra facilement être pris comme modèle du genre alors que dans les années 2000, l'on privilégiera plutôt Il faut sauver le soldat Ryan (Saving Private Ryan de Steven Spielberg, 1998) encore dans bien des mémoires. Les choix, les valeurs, les intérêts des uns et des autres joueront également un rôle important, et, si La Liste de Schindler de Steven Spielberg (Schindler's List, 1993) a marqué l'esprit du grand public, les cinéphiles citeront plus volontiers sur le même sujet tragique Shoah de Claude Lanzmann (1985).
Si les spectateurs se réfèrent ainsi à des exemples types (qui peuvent induire certains biais), ils doivent cependant pouvoir généraliser ces exemples pour classer les nouveaux films rencontrés et les catégoriser sur base de critères plus ou moins valides. Dans le cas du film historique, plusieurs critères sont sans doute utilisés par les spectateurs dans l'utilisation de cette catégorie.
Le premier et le plus évident est certainement l'appartenance (réelle ou supposée) des faits représentés à un passé plus ou moins lointain. Cette explicitation est cependant insatisfaisante dans la mesure où tout film (si l'on excepte les films d'anticipation) représente des événements passés, même si la distance temporelle qui nous sépare de ces événements est relativement courte (quelques mois, quelques années...).
Pour parler d'un film historique, il faut que le passé évoqué soit perçu comme suffisamment « lointain », qu'il y ait une distance significative entre le passé et le présent, qu'il y ait, non pas une distance mesurable en nombre d'années, mais ce qu'on pourrait appeler une « déliaison » entre le passé et le présent : le « passé » n'est tel que dans la mesure où il a perdu d'une manière ou d'une autre son « actualité ». On peut prendre quelques films de Costa-Gavras pour illustrer ce phénomène.

Missing de Costa-Gavras
Quand ce cinéaste réalise en 1969 Z sur l'assassinat d'un député de gauche en Grèce en 1963, puis l'année suivante l'Aveu qui retrace l'histoire des procès de Prague en 1952, et bientôt Missing (1982), une évocation de la disparition d'un journaliste américain lors du coup d'État de Pinochet en 1973, la plupart des spectateurs qui ont vu ces films à leur sortie ont certainement considéré qu'il s'agissait là de films d'actualité parce que les dictatures dénoncées dans ces films - que ce soit en Grèce[5], dans les pays de l'Est européen ou au Chili - étaient encore en place et brutalement agissantes. Les faits dénoncés par Costa-Gavras appartenaient encore bien au présent. En revanche, quand le même cinéaste réalise en 2002 Amen., qui évoque l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ce film sera immédiatement perçu par tous les spectateurs comme « historique », représentant une tragédie qui s'est achevée en 1945 avec la chute du régime nazi.
Dans le cas des trois premiers films en prise sur l'actualité, il faut cependant voir la différence entre les événements effectivement montrés à l'écran (même s'il s'agit d'une reconstitution) et la dénonciation qui est beaucoup plus large et concerne des régimes politiques toujours actifs au moment de la réalisation. Déterminer ce qui appartient au passé et ce qui appartient au présent suppose donc une interprétation d'une réalité qui ne se réduit pas à son aspect visible et audible, ni à un seul événement aussi saillant soit-il (comme un assassinat politique). Ainsi, parler d'un « régime dictatorial » suppose que l'on définisse intellectuellement une entité politique relativement abstraite, très vaste et multidimensionnelle (la fin du régime parlementaire, l'arrestation arbitraire d'opposants, la censure, les violences policières, la torture, etc.) et que les événements précis, historiquement datés, représentés dans ces films de Costa-Gavras, relèvent bien d'une telle politique, moralement condamnable et beaucoup plus large (et non pas par exemple d'excès policiers contingents). C'est la manière dont nous comprenons la réalité, dont nous la « découpons » conceptuellement, dont nous relions une multitude de faits et d'événements apparaissant de manière discontinue, qui nous permet de définir ce qui touche encore au présent et ce qui, au contraire, a désormais basculé dans le passé.
Le passé ou le présent n'existent comme tels que parce qu'on les interprète ainsi, et certains spectateurs de tendance communiste ont très bien pu estimer au début des années 1970 que l'Aveu dénonçait des faits anciens, « dépassés », appartenant à la période stalinienne désormais close par le rapport de Khrouchtchev au XXe Congrès du Parti de 1956. Aujourd'hui les spectateurs qui reverront ces films de Costa-Gavras auront certainement tendance à les considérer comme des films historiques puisque les différents régimes dénoncés ont disparu, mais, même si pratiquement tout le monde reconnaîtra cet état de fait - la fin de ces dictatures -, cette reconnaissance repose elle aussi sur une interprétation, aussi largement partagée soit-elle par les spectateurs (certains pourraient par exemple prétendre que le fascisme est toujours vivant sous un autre visage...).

Soldier Blue de Ralph Nelson
À l'inverse, des films historiques, mettant en scène des faits manifestement anciens, peuvent être interprétés comme tout à fait actuels. Ce fut le cas par exemple de Soldier Blue réalisé par Ralph Nelson en 1970, un film qui racontait le massacre de toute une tribu indienne par la cavalerie américaine dans les années 1860[6] et qui a très souvent été vu comme une allusion aux crimes de guerre commis au même moment par l'armée américaine en pleine guerre du Viêt-nam (comme le massacre de My Lai). Pour de nombreux spectateurs admirateurs du film, une évidente continuité entre les différentes guerres menées par l'armée des États-Unis abolissait la distance historique.
Ce dernier exemple montre cependant qu'un deuxième critère intervient dans la définition d'un film comme étant historique : la distance temporelle est en effet dans ce cas tellement importante - plus d'un siècle - que personne sans doute ne sera choqué si l'on définit (par exemple sur un site web encyclopédique) Soldier Blue comme un film historique, malgré son éventuelle « actualité ». Mais à partir de quand cette distance temporelle est-elle suffisante pour que, sans conteste possible, l'on puisse considérer que des événements mis en scène au cinéma relèvent définitivement de l'histoire ?
On suggérera ici que la mémoire individuelle joue un rôle important, mémoire qui varie naturellement avec l'âge des individus : ce que nous avons vécu personnellement, ce dont nous avons le souvenir, est sans aucun doute beaucoup plus « vivant », beaucoup plus « présent » que des événements plus anciens nécessairement fondés sur des témoignages de personnes disparues. Aujourd'hui, beaucoup de quinquagénaires ou quadragénaires se souviennent facilement d'événements comme l'invasion du Koweit et la guerre du Golfe qui s'en est suivie, la chute du Mur de Berlin, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le génocide au Rwanda... même s'ils n'ont pas été liés directement à ces événements et qu'ils en ont été seulement informés par les médias. L'incertitude du présent en cours - que va-t-il arriver ? que s'est-il exactement passé ? - mais aussi le caractère plus ou moins surprenant de l'information nouvelle[7] marquent notamment l'esprit des contemporains qui peuvent avoir le sentiment d'avoir « vécu » ces événements avec une plus ou moins grande intensité. En revanche, les faits cités appartiennent désormais pour les adolescents indubitablement à l'Histoire.

Lincoln de Steven Spielberg
Dans le domaine cinématographique, un jeune spectateur d'aujourd'hui pourra ainsi estimer que le Nixon d'Oliver Stone, réalisé en 1995 un an après la mort de l'ancien président, est un film historique, alors que beaucoup de spectateurs plus âgés garderont vraisemblablement une mémoire suffisamment vive de sa présidence (sinon de son débat télévisuel avec John Kennedy en 1960) pour considérer qu'il s'agit plutôt là d'une « biographie » d'une personnalité « actuelle » (sinon vivante...) que d'un film historique. En revanche, le Lincoln de Steven Spielberg (2013) ne peut évidemment réveiller aucun souvenir chez personne et sera immédiatement reconnu par tous comme « historique ».
On nuancera cette distinction entre mémoire et histoire[8] en tenant compte des éventuels phénomènes de transmission personnelle de mémoire entre générations, notamment entre grands-parents, parents et enfants : certains événements, en particulier s'ils ont été directement vécus comme les deux Guerres mondiales en Europe, peuvent rester « vivants » aux yeux de certains individus qui n'en ont pourtant pas été contemporains mais qui ont recueilli les souvenirs de témoins directs (notamment familiaux). Steven Spielberg, né en 1946, a ainsi expliqué dans plusieurs interviews qu'il avait réalisé son film Il faut sauver le soldat Ryan à cause de son père, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, dont il a entendu souvent raconter les histoires : comme le cinéaste américain, beaucoup de spectateurs, nés également après 1945, ont certainement voulu comparer ce film aux souvenirs - sans doute différents mais marqués par ce conflit - qu'ils avaient pu recueillir de leurs parents ou grands-parents, et le film de Spielberg a dès lors certainement été vu d'une tout autre manière que le péplum 300 de Zack Snyder, reconstitution à grand spectacle de la bataille des Thermopyles[9].
La distance temporelle ne suffit cependant pas à définir un film comme historique, ainsi qu'en témoignent de nombreux westerns : personne ne considérera les films de Sergio Leone, Pour une poignée de dollars (1964), Et pour quelques dollars de plus (1966) ou Il était une fois dans l'Ouest (1968) autrement que comme des fictions prenant seulement l'Ouest américain comme un décor pour des aventures inventées. C'est également le cas de plusieurs péplums comme la série des Maciste (Maciste contre les hommes de pierre de Giacomo Gentilomo, 1964, Maciste contre les géants de Michele Lupo, 1963, etc.) ou de certains films de guerre comme De l'or pour les braves de Brian G. Hutton (Kelly's Heroes, 1970) ou La Grande Vadrouille de Gérard Oury (1966) qui mettent en scène des événements manifestement fictionnels.

Bloody Sunday de Paul Greengrass
En revanche, un film historique met en scène des personnages connus, des événements célèbres, des faits qui, de façon générale, sont attestés par le Savoir historique, tel qu'il est construit et transmis par une multitude d'ouvrages et de manuels, par les commémorations et les musées, par des médias de toutes sortes et par l'école bien sûr qui joue un rôle central en ce domaine : évoquer au cinéma des figures comme celle de Napoléon, Louis XIV, Nelson Mandela, Hitler ou Gandhi, représenter le débarquement en Normandie de juin 1944, la bataille de Gettysburg, la liquidation du ghetto de Varsovie par les Nazis, le Bloody Sunday en Irlande du Nord en 1972, la révolte des marins du cuirassé Potemkine, les derniers jours de Pompéi ou l'un ou l'autre épisode de la Révolution française réveillent chez la plupart des spectateurs des connaissances sans doute imprécises[10] mais qui suffisent à reconnaître ces faits ou ces personnages comme relevant de l'Histoire.
Ainsi, c'est très généralement la mise en scène de faits précis mais célèbres, de personnes singulières et illustres (qu'on qualifie souvent de grands hommes) qui nous permet de déterminer qu'un film relève du genre historique, parce que le savoir historique a longtemps privilégié et privilégie encore de tels événements et de telles figures[11]. Il faut donc bien comprendre que c'est le Savoir historique, extérieur au champ cinématographique, qui définit de façon essentielle ce qui relève de l'Histoire et ce qui n'en relève pas. Ainsi, le cinéma peut mettre en scène de nombreux faits divers, plus ou moins authentiques, appartenant à un passé plus ou moins lointain - par exemple Erin Brockovich de Steven Soderbergh (2000) qui évoque l'histoire d'une avocate aux prises avec une industrie polluante, Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg (Catch Me If You Can, 2002) qui raconte les aventures d'un escroc talentueux dans les années 1960, Into the Wild de Sean Penn (2007) sur l'odyssée d'un jeune hippie mort en 1992 en Alaska ou encore Mesrine : l'ennemi public n° 1 de Jean-François Richet (2008) qui retrace la carrière d'un célèbre bandit -, mais cela ne suffit pas à transformer ces réalisations en films historiques : on parlera dans ce cas plutôt de « biopic » ou encore de film policier parce que les faits rapportés n'ont pas (ou pas encore) reçu d'attestation du Savoir historique[12].

Lucky Luciano de Francesco Rosi

Moi, Pierre Rivière... de René Allio
Le cas du Lucky Luciano de Francesco Rosi (1974) permet une nouvelle fois de souligner la complexité et la flexibilité de ce système de catégorisation que nous utilisons pour définir le genre des films (comme d'ailleurs des autres productions culturelles). Retraçant la « carrière » d'un célèbre mafieux aux États-Unis, ce film ne sera cependant pas vu, au moment de sa sortie, comme un film « policier » mais plutôt comme un film « politique » et « historique », à cause bien sûr de la carrière antérieure du réalisateur italien, mais surtout parce que son film met l'accent sur les relations troubles entre ce mafieux et les autorités politiques américaines qui auraient libéré ce gangster en échange de l'aide apportée aux forces alliées lors de la libération de la Sicile, mais qui permettront également à l'organisation criminelle d'y reprendre pied de façon durable après la période fasciste. Le fait divers cède ainsi la place à l'analyse politique et sociale, et le film policier se transforme en film historique.
Bien entendu, il ne faut pas considérer le Savoir historique comme un domaine rigide et fermé, et l'éventail des « objets » susceptibles de devenir historiques évolue constamment. Si, à une époque, les rois, leurs épouses et leurs maîtresses paraissaient particulièrement dignes d'intérêt, c'est sans doute moins le cas aujourd'hui, et la Marie-Antoinette de Sofia Coppola, souvent qualifiée de kitsch et de rococo[13], sera à peine considérée comme un film « historique » par la presse et le public, qui parleront seulement du portrait d'une adolescence éternelle...[14] À l'inverse, un sujet comme l'immigration est resté longtemps méconnu des historiens, et ce sont sans doute des cinéastes comme Yamina Benguigui (Mémoires d'immigrés, 1997) qui ont permis de le mettre en lumière, sinon de lui donner le statut d'objet historique. Ainsi encore, un fait divers apparemment aussi exceptionnel et sensationnel qu'un meurtre familial, généralement négligé par l'analyse historique, a pu devenir un sujet digne d'intérêt et de réflexion sous la plume de Michel Foucault (Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma s¦ur et mon frère... Un cas de parricide au XIXe siècle présenté par Michel Foucault, Paris Gallimard, 1973), ce qui permettra à René Allio d'en faire un film quelques années plus tard (Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma s¦ur et mon frère..., 1976) dont l'aspect pleinement historique sera immédiatement reconnu par la critique et le public : en revanche, L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara (1951), pourtant également inspiré d'une célèbre affaire criminelle, sera généralement vu comme une comédie grinçante sans aucune portée historique. Le traitement cinématographique du fait divers par René Allio est certainement très différent de celui d'Autant-Lara, mais il n'est pas du tout sûr que beaucoup de spectateurs aient vu dans son film autre chose que la mise en scène d'un fait divers et compris les raisons qui avaient permis quelques années plus tôt à Foucault et ses collaborateurs[15] de le transformer en « objet historique ». La caution de l'historien renommé a suffi néanmoins à transformer la réalisation de René Allio en exemple type du « film historique ».
Les trois critères que l'on a jusqu'à présent distingués - la rupture supposée entre le passé et le présent, une distance historique suffisamment grande au-delà de la mémoire individuelle, la caution du Savoir historique -, même s'ils laissent une marge d'appréciation, permettent de catégoriser de façon claire de nombreux films comme relevant du genre historique, du moins en ce qui concerne les documentaires. La fiction cinématographique implique quant à elle la prise en compte d'un autre aspect essentiel, à savoir la part de reconstitution mais aussi d'invention que comportent de tels films.

Le Bossu de Philippe de Broca (1997)
Adapté d'un roman de Paul Féval (1857), le film de Philippe de Broca est perçu essentiellement comme une fiction: les personnages principaux sont imaginaires comme l'intrigue qui les relie. Seuls des personnages secondaires (le régent), des événements brièvement évoqués (la banqueroute de Law), les décors... sont perçus comme authentiques ou vraisemblables.

Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci (1987)
Même si nous ne connaissons que très sommairement l'histoire de la Chine et si nous savons bien que le film est une reconstitution, nous supposons que les événements évoqués sont authentiques. Le fait, rapporté par la presse, que Bertolucci a pu tourner dans la Cité interdite, joue comme un facteur d'authentification: les décors sont vrais comme les événements rapportés...
Ainsi, à la vision du Bossu de Philippe de Broca (1997), adapté du roman de Paul Féval, beaucoup de spectateurs reconnaissent facilement que le Régent est une figure historique, ils ont également déjà entendu parler de la banqueroute de Law, et ils se souviennent peut-être que la Louisiane fut une colonie française et servit même de lieu de déportation pour nombre de « mauvais sujets »[16] de la Royauté... En revanche, les personnages de Lagardère, de Philippe de Nevers et de son cousin le malfaisant Gonzague semblent tout droit sortis de l'imagination du romancier populaire. Le spectateur, qui dispose de connaissances historiques même approximatives, va ainsi faire un partage constant entre les événements et personnages qu'il sait authentiques et ceux qu'il juge fictionnels, avec une part d'indétermination concernant certains d'entre eux : non, le régent n'a pas pu se battre à l'épée avec Lagardère, comme on le voit au début du film de Philippe de Broca, puisque ce héros est clairement une créature de fiction, mais il est possible, vraisemblable ou au contraire peu vraisemblable, que ce prince croisât le fer à l'occasion avec l'un ou l'autre spadassin... Mais l'importance prise par la « fiction » - qui concerne essentiellement les personnages et les événements mis en scène[17] - justifie que l'on parle dans ce cas de film de cape et d'épée plutôt que de film historique.
En revanche , si l'on considère des films comme Gandhi de Richard Attenborough (1982) ou Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci (1987), l'authenticité du personnage principal garantit sans doute aux yeux des spectateurs (qui pourtant ne connaissent pour la plupart que des bribes d'histoire de l'Inde ou de la Chine) le caractère globalement historique des événements rapportés même s'ils sont conscients de la part de reconstitution et de mise en scène qu'impliquent de telles fresques à grand spectacle. Dès lors, bien que difficilement mesurable en tant que telle, la part de la fiction - ne serait-ce que le fait que les personnages sont évidemment interprétés par des acteurs, ou que leurs paroles et leurs gestes sont en grande partie reconstitués sinon inventés, quelle que soit par ailleurs leur vraisemblance - semble inessentielle ou secondaire, et certains critiques pourront même reprocher aux réalisateurs des erreurs, des contrevérités ou même des mensonges présents dans de tels films dont la prétention à la vérité sera mise en question comme celle de n'importe quel ouvrage ou documentaire historique (ce qui ne sera pas le cas pour un film de cape et d'épée comme celui évoqué à l'instant à qui personne ne reprochera de falsifier l'Histoire avec ses fantaisies imaginatives).
En fonction de leurs propres connaissances[18], les spectateurs évalueront l'importance plus ou moins grande de la fiction dans ces différents films qu'ils classeront alors selon le cas comme « film historique » ou au contraire comme « film de fiction » (western, film d'aventures, film de pirates, film de cape et d'épée...) sans véritable prétention historique. Cette évaluation reste sans aucun doute floue et imprécise, et ces catégories ne sont certainement pas étanches : ainsi, si l'on considère des films aussi différents que la Reine Margot de Patrice Chéreau (1994), Les Hommes contre de Francesco Rosi (Uomini contro, 1970), Spartacus de Stanley Kubrick (1961), la Chute d’Oliver Hirschbiegel (2005) ou encore le Nouveau Monde de Terrence Malick (2006), les uns et les autres seront plus ou moins sensibles aux éléments historiques mis en scène dans ces films, à l'éventuelle authenticité de certains événements représentés, ou au contraire à la part de recréation, d'imagination ou même d'anachronisme qui y est également présente, mais la plupart des spectateurs reconnaîtront sans doute facilement que ces films mélangent ces deux aspects de manière inextricable.

Le Dictateur de Charles Chaplin

La Poursuite infernale de John Ford
De façon exceptionnelle, la fiction peut néanmoins contredire l'Histoire (telle qu'elle est connue de tous) et exclure de ce fait un film du genre historique, malgré la mise en scène de personnages ou d'événements célèbres : ainsi, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, qui, dans sa séquence finale, montre l'assassinat de Hitler et des principaux dignitaires nazis par un commando de soldats juifs américains, ne peut être reçu par les spectateurs que comme une fiction née de l'imagination débordante de son auteur (le site Wikipedia parlant ainsi joliment d'un « film de guerre uchronique »...). Bien que réalisés à une tout autre époque et dans des conditions très différentes, le Dictateur de Chaplin (1940) ou To Be or Not to Be d'Ernst Lubitsch (1942), qui étaient en prise directe avec l'actualité au moment de leur réalisation, ne seront sans doute jamais considérés comme de véritables films historiques, malgré l'éloignement du temps, à cause précisément de leur dimension essentielle de comédie (même noire) qui contredit trop fortement la nature mortifère et tragique du nazisme[19].
Les différents critères que l'on a relevés - la distance historique plus ou moins grande, la référence à l'Histoire comme savoir, la part plus ou moins importante de la fiction... - ne fonctionnent pas de manière discriminante et opèrent au contraire de manière continue entre des « zones » aux frontières floues[20]. Certains films pourront alors être pris, comme on l'a vu, comme exemples types du « film historique » lorsqu'ils se situent au « centre » de ces différentes zones (définies par une distance historique suffisante, par la référence à des faits attestés par le Savoir historique et par une part de fiction perçue comme secondaire ou inessentielle), alors que d'autres se situant à la limite de ces zones ou de certaines de ces zones vont plutôt être considérés comme appartenant à un autre genre (défini d'ailleurs de manière aussi floue). Ainsi, bien qu'il mette en scène des faits historiquement attestés, un film comme celui de John Ford, la Poursuite infernale (My Darling Clementine, 1946), sera plus facilement considéré comme un western - parce qu'ayant lieu au Far West, parce que mettant en scène des cow-boys, parce que se déroulant dans la seconde moitié du XIXe siècle, parce qu'évoquant des faits historiquement peu importants... - que comme un film proprement historique. D'autres catégories comme le film de guerre, le film de cape et d'épée, le péplum, le « biopic »[21], permettront ainsi de mieux qualifier ces films qui ne présentent que certaines des caractéristiques essentielles pour définir le genre historique.
Déterminer l'appartenance d'un film au genre « historique » ne signifie évidemment pas affirmer sa vérité ni garantir son authenticité. Même si l'on n'a que des connaissances historiques sommaires, l'on sait qu'un film est le résultat d'une mise en scène (dans le cas d'une fiction) ou d'une reconstruction (dans le cas d'un documentaire) : il y a sans doute des spectateurs « naïfs » comme les enfants qui croient immédiatement à la « réalité » des images qui leur sont montrées, mais la valorisation de l'esprit critique (et parfois très critique[22]) notamment par l'école incite certainement les spectateurs adultes ou adolescents à considérer avec un minimum de distance des films qui prétendent de façon plus ou moins affirmée à la vérité historique. Même si notre savoir historique personnel n'est pas assez précis pour opérer un partage exact entre les faits authentiques et d'autres éléments plus contestables, notre connaissance générale du processus de réalisation cinématographique est souvent suffisante pour comprendre que, dans un film de fiction, les personnages sont interprétés par des acteurs et que leurs faits et gestes sont nécessairement reconstitués avec une part d'approximation, ou bien que, dans un documentaire, il y a une sélection dans les documents d'archive éventuellement montrés comme dans les faits évoqués : raconter par exemple l'histoire des somptueuses résidences royales et princières de l'époque classique signifie presque nécessairement faire l'impasse sur les conditions d'existence du plus grand nombre à l'époque, à savoir les paysans souvent misérables...
Tous les spectateurs ne font sans doute pas preuve du même esprit critique, mais tous les films historiques subissent certainement le feu des critiques, même lorsqu'ils prétendent être garantis par des historiens professionnels : la série télévisuelle Apocalypse d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle, retraçant la Seconde Guerre mondiale, a ainsi été critiquée aussi bien pour l'utilisation d'un procédé de colorisation d'images d'archives à l'origine en noir et blanc[23] que pour une approche plus ou moins biaisée des faits évoqués[24]...
Trois grandes critiques de principe peuvent ainsi être faites à n'importe quel film historique.
La première est que toute représentation est nécessairement partielle et implique une sélection des faits mis en scène : la vérité, qui implique la correspondance entre une représentation et les faits représentés, n'est pas synonyme de la réalité qui est nécessairement plus vaste, plus diverse, plus complexe que n'importe quelle représentation (ce que les géographes expriment par la formule éclairante « une carte n'est pas le territoire »[25], même si la carte est parfaitement exacte...).
La seconde critique concerne les supposés partis pris de l'auteur du film : toute représentation est partielle mais également partiale (au sens de subjectivement orientée) puisque les choix du réalisateur ne sont pas déterminés par la réalité elle-même mais par ses propres intérêts, valeurs, présupposés ou partis pris. Ce type de critique suppose cependant une interprétation des intentions de l'auteur du film, intentions qui sont rarement explicitées comme telles et qui font donc l'objet d'une reconstruction hypothétique et dans certains cas d'un « procès d'intention ».

Mississippi Burning d'Alan Parker
Enfin, s'il est assez rare que l'on dénonce des erreurs factuelles (sinon mineures) dans un film historique, il est beaucoup plus fréquent que l'on mette en cause les interprétations de ces faits qui en sont données par l'auteur (par exemple concernant les causes supposées des événements, les responsabilités éventuelles des différents personnages, l'importance accordée à certains faits au détriment d'autres) : ainsi, le film d'Alan Parker Mississippi Burning (1989), qui racontait l'enquête menée sur l'assassinat en 1964 de trois militants antiségrégationnistes par des membres du Ku Klux Klan d'une petite bourgade du sud des États-Unis, a été fortement critiqué au moment de sa sortie[26] notamment parce qu'il donnait un rôle central et positif aux agents du FBI, reléguant les Noirs au statut de victimes passives alors que ceux-ci ont au contraire été les véritables acteurs du mouvement des droits civiques (Civil Rights Movement) face à l'indifférence sinon à l'hostilité des autorités fédérales (et du FBI en particulier). Dans ce cas d'ailleurs, l'on voit bien comment les trois types de critiques peuvent se mélanger et porter à la fois sur la représentation fragmentaire de la réalité (« Alan Parker ne parle pas des Noirs... »), son caractère partial (« il veut plaire à un public majoritairement blanc... ») et le caractère biaisé de son interprétation des faits (« il donne le beau rôle à des policiers blancs... »).
Quel que soit le type de critique, elle pourra notamment porter, dans le cas d'un film de fiction à prétention historique, sur les falsifications éventuelles, les mésinterprétations mais également les effets émotionnels que le recours à la fiction peut précisément induire ou favoriser. On se souvient en particulier de la scène de la douche dans la Liste de Schindler de Steven Spielberg, scène fortement critiquée parce qu'elle crée un suspense - du gaz mortel va-t-il sortir de ces douches ? - qui se conclut cependant par une forme de soulagement pour le spectateur - c'est de l'eau qui s'échappe finalement des douches - ; mais cet effet émotionnel, spectaculairement accentué par le cinéaste (par la bande-son, par les gros plans sur les visages terrifiés...), masque d'une certaine manière la réalité de l'extermination, le film s'attachant bien plus à un groupe de survivants qu'aux millions de Juifs assassinés par ailleurs[27]. Autrement dit, l'éventuelle vérité de cette scène (l'anecdote se trouve dans l'ouvrage de Thomas Keneally, publié en 1982 et dont s'inspire le film, même si elle racontée très brièvement et de façon beaucoup plus neutre) ne correspond pas à la réalité beaucoup plus large et beaucoup plus tragique dont le film ne donne ainsi qu'une représentation partielle et partiale (si l'on suit ces critiques) en recourant précisément à toutes les techniques (manipulatoires) du cinéma de fiction.
Documentaire et/ou fictionMême si elle est souvent critiquée, l'opposition entre documentaire et fiction reste fondamentale : si, dans les deux cas, il y a sans doute partis pris, subjectivité, travail de montage, part de recréation... le documentaire prétend à la vérité et à l'authenticité en chacun de ses éléments, alors que la fiction échappe à la logique du vrai et du faux du discours « sérieux ». On peut accuser un documentaire de mentir ou de falsifier les faits, mais personne ne reprochera à un film de fiction (même à prétention historique) d'inventer certains personnages ou certains événements, ni de faire interpréter des rôles historiques par des acteurs. Sur ce point, l'analyse de Paul Grice nous semble incontournable : il décrit en effet la fiction comme un discours qui feint d'affirmer certaines choses - par exemple l'existence de Madame Bovary - mais sans s'engager sérieusement quant à la véracité de ses affirmations - personne ne recherchera dans les registres d'état civil cette supposée Madame Bovary -. La fiction repose donc sur une convention partagée avec le lecteur ou le spectateur et qui implique essentiellement une suspension temporaire des règles de la conversation courante comme « Que votre contribution soit véridique » et « N'affirmez pas ce que vous croyez être faux » (Paul Grice, « Logique et conversation », dans Communications, n° 30, 1979, p. 53 et s.). Outre cette différence essentielle qui constitue ce qu'on appelle une convention pragmatique liant « l'énonciateur » et le « destinataire » du message, on observe par ailleurs de nombreuses différences esthétiques entre les deux genres, même si aucune de ces caractéristiques n'est essentielle ni décisive : la fiction peut imiter parfois le documentaire (comme les actualités reconstituées au début de Citizen Kane d'Orson Welles), et inversement. |
S'il est facile de comprendre que la vérité ne se confond pas avec la réalité, qu'un livre par exemple ne nous donne qu'une représentation partielle de l'Histoire telle qu'elle a pu se dérouler, une telle position critique ou réflexive se heurte cependant à la nature même de l'image photographique et cinématographique qui, lorsqu'elle n'est pas manipulée ou falsifiée[28], a une valeur documentaire immédiate : comme d'autres documents d'archives qu'utilise l'historien pour accéder aux réalités anciennes, l'image est témoignage[29] de ce qu'elle représente, de la même manière que des fondations en ruines, révélées par des fouilles archéologiques, peuvent attester de l'existence en ces lieux d'une cité antique. Non seulement l'image photographique ou filmée est témoignage, mais elle nous montre les faits directement, « bruts », sans interprétation[30] ni subjectivité[31], tels qu'ils se sont déroulés... Ce que nous voyons (à l'exception bien sûr des images falsifiées) s'est effectivement passé il y a dix, vingt, trente ou cent ans : les images attestent que Kennedy a été assassiné à Dallas, que Martin Luther King a prononcé ces mots « I have a dream » sur les marches du Mémorial de Lincoln, que le mur de Berlin a été franchi par des milliers d'Est-Berlinois dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989...[32]

Il était une fois en Amérique de Sergio Leone


Ces trois images du pont de Manhattan ont été prises à des époques différentes et sous des angles différents; en outre, dans le cas du film de Sergio Leone, il y a eu très certainement un trucage pour faire apparaître la silhouette du pont à l'arrière-plan. La richesse visuelle de l'image nous permet cependant de reconnaître, sans informations extérieures, qu'il s'agit très vraisemblablement du même pont, différent par exemple de celui de Brooklyn dont nous connaissons également la silhouette par la photo et le cinéma.
Autrement dit, par rapport à d'autres documents historiques comme des ruines archéologiques ou des textes d'archives, l'image photographique[33] produit un « effet de réel » qui exerce, on le sait, une indéniable fascination sur le spectateur : celui-ci en effet a l'impression de voir les choses telles qu'elles se sont déroulées sans devoir les interpréter. Ce n'est pas tout à fait exact[34] comme on va le montrer, mais une des caractéristiques de l'image photographique est effectivement de pouvoir transmettre une très grande quantité d'informations visuelles (mais aussi sonores) qui échappent en revanche à l'écrit comme à la parole : ce type d'image est suffisamment informatif pour me permettre par exemple de reconnaître une personnalité célèbre que je n'aurais pourtant jamais rencontrée personnellement mais que j'aurai vue à la télévision. Semblablement, même si je n'ai jamais mis les pieds à New York, les décors de cette ville si souvent montrée au cinéma me seront sans doute familiers le jour où j'aurai l'occasion de m'y rendre...
Il faut cependant prendre conscience du fait que, comme spectateurs, il est très rare que nous regardions des photos ou des films « bruts » sans aucun contexte ni commentaire... En outre, nous mettons en ¦uvre de multiples savoirs pour interpréter ces images qui, sans cela, nous paraîtraient insignifiantes ou incompréhensibles. C'est évident lorsqu'on considère les actualités télévisées où les vidéos sont toujours accompagnées de paroles (en voix off) et de textes (en surimpression) qui précisent où et quand les faits se sont déroulés, et quels sont les tenants et les aboutissants des faits représentés. Lorsque ces explications manquent, les images « brutes » (visuelles et sonores) sont extrêmement difficiles à interpréter : qui sont ces gens ? que s'est-il passé avant les événements montrés ? quelles sont les causes de cette agitation ? quand ces images ont-elles été filmées, et où ? Nos connaissances se révèlent alors très souvent insuffisantes pour comprendre des reportages qui peuvent venir des quatre coins du monde, qui peuvent être d'une actualité récente ou au contraire dater de plusieurs années[35].
C'est également le cas pour les photos et les films de nature historique. Si j'ai quelques connaissances en ce domaine, je pourrai sans doute reconnaître sur une photo ancienne un soldat français dans une tranchée pendant la Première Guerre mondiale, mais il me sera beaucoup plus difficile de dater et de situer de façon précise la prise de vue. Le nom, l'identité, l'histoire de ce soldat, de ses compagnons éventuels resteront également totalement inconnus si je ne dispose que des informations délivrées par cette photo. Les bandes cinématographiques tournées à cette époque ne seront pas beaucoup plus explicites et susciteront les mêmes questions : qui sont ces soldats ? où et quand ces événements ont-ils eu lieu ? quelles en ont été les conséquences ? ces bandes ont-elles été filmées « sur le vif » ou bien ont-elles été reconstituées à l'arrière du front ?[36] Et, si plusieurs plans se succèdent - un canon tire, des soldats montent à l'assaut... -, je pourrai me demander si ces plans ont été tournés au même moment ou s'il s'agit de scènes sans rapport réel entre elles, peut-être filmées en des lieux et à des moments éloignés mais rapprochés artificiellement par le montage. Sans informations extérieures, la nature même de certaines images peut en outre se révéler problématique, car il n'est pas possible sur base des seuls indices visuels de décider si elles sont authentiques ou s'il s'agit au contraire de reconstitutions ultérieures[37]. Ainsi, les images, qui montrent les faits dans leur aspect le plus concret et qui peuvent être terriblement marquantes - l'on pense par exemple aux photos de cadavres mutilés -, se révèlent en fait des documents relativement peu informatifs, et elles sont d'ailleurs souvent réduites, notamment dans les ouvrages à vocation historique, au simple statut d'illustration d'un événement beaucoup plus large - la guerre - ou d'un aspect général de cet événement - les horreurs de la guerre -.



Tous au Larzac de Christian Rouaud
La première image montre un texte incrusté.
La seconde est une image d'archive.
La troisième met en scène un témoin actuel qui commente l'image précédente et en donne le sens: les paysans on rassemblé leurs troupeaux de brebis sur la place de la mairie en signe de protestation.
Dans les documentaires historiques, l'on constate dès lors que les images photographiques ou cinématographiques d'époque sont très généralement accompagnées d'un commentaire, d'un texte ou encore de cartes et de schémas, ou bien croisées avec des interviews qui en éclairent le contexte, en précisent le sens, en définissent les circonstances, les tenants et les aboutissants, tout en les inscrivant dans une Histoire beaucoup plus large et plus complète. Loin d'être montrées « brutes », les images d'archives sont agencées, mélangées parfois avec des images d'une tout autre nature (comme des témoignages recueillis après les événements), montées de manière à traduire ou à révéler une signification d'ensemble dont elles ne sont pas en elles-mêmes porteuses, permettant d'illustrer par exemple les grandes étapes d'une chronologie (la Première Guerre mondiale) ou les différents aspects d'une situation historique (la vie et la mort sur le front / la vie à l'arrière...). Autrement dit, aussi marquantes soient-elles, les images seules ne suffisent pas à faire l'histoire.
Par ailleurs, même si elles nous renseignent visuellement de façon très concrète sur les personnages et les événements du passé, elles en donnent une représentation partielle, réduite à un instant (dans le cas de la photographie) ou à quelques moments, souvent assez courts (dans le cas du cinéma ou de la vidéo). En outre, des aspects importants de la situation réelle leur échappent comme les sons (à l'époque du muet), les odeurs (l'odeur des cadavres a marqué tous les soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale), le goût (même si c'est un aspect qui peut souvent paraître secondaire) et le toucher. Toutes les sensations corporelles, notre capacité à nous situer immédiatement dans l'espace, à localiser l'origine des sons, à effectuer des déplacements oculaires d'une très grande vitesse, à utiliser notre sens interne de l'équilibre pour localiser les objets vus... sont pratiquement intraduisibles au cinéma comme en témoignent par exemple les séquences de voltige aérienne qui désorientent les spectateurs mais ne rendent certainement pas compte des sensations éprouvées par les aviateurs[38].
Tout aussi importantes sont les émotions et les pensées des individus filmés qui ne peuvent pratiquement pas être captées par les caméras (sinon de façon fugace sur les visages). Qu'éprouvent les personnes que nous voyons à l'écran ? de la peur, de l'excitation, de la joie, de l'ennui, de la curiosité, du dégoût, de l'attirance, de la honte, de la stupeur ? Ces personnes montrent-elles leurs véritables sentiments ou essaient-elles plutôt de faire bonne figure devant la caméra ? La situation générale nous renseigne sans doute sur leurs émotions, mais nous sommes obligés d'interpréter ce que nous voyons, et nous sommes donc sujets à des erreurs d'interprétation[39]. Dans ce cas, le témoignage oral ou écrit (à travers par exemple les lettres ou les carnets écrits par les « poilus » dans les tranchées) donne sans doute des informations beaucoup plus exactes et plus complètes sur les sentiments réellement éprouvés par ces personnes.
L'image a donc une indéniable valeur documentaire, et les informations très concrètes qu'elle comprend exercent une indéniable fascination sur les spectateurs (même s'ils peuvent s'en distancier), mais il est clair aussi que l'image, aussi riche soit-elle, est nécessairement partielle et ne peut être confondue avec une réalité nécessairement plus vaste et plus complexe. Cela explique notamment que les photos et les films d'archive sont très généralement présentés avec des commentaires et un contexte explicatif nécessaires pour comprendre et préciser les informations dont ces images sont porteuses. Enfin, l'interprétation de ces images nécessite, comme tout autre document historique, des savoirs qui ne sont pas « donnés » par ces images et qui doivent être acquis par ailleurs (ainsi, pour distinguer les uniformes français et allemands sur des photos de la Première Guerre mondiale).
Si, dans les documentaires, les films et photographies d'archives sont en effet très souvent accompagnés de commentaires explicatifs de toutes sortes, le film de fiction historique semble pourtant tout à fait capable de s'en passer. Dans ce cas, l'image ne se suffit-elle pas à elle-même ? ne parvient-elle pas à reconstituer les événements d'une façon suffisamment complète et réaliste pour donner au spectateur l'impression de « voir » et de « comprendre » les événements passés ? Là où les films d'époque sur la guerre des tranchées ne sont constitués que de courtes séquences muettes en noir et blanc, peu explicites et assez vagues sur l'ensemble du contexte (par exemple la bataille en cours), des films comme Il faut sauver le soldat Ryan ou le Jour le plus long (de Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl F. Zanuck, 1962) paraissent nous donner une « image » saisissante, relativement claire et cohérente de ce qu'a pu être le débarquement allié en Normandie...
En cela cependant, les films de fiction historique ne se distinguent pas fondamentalement des autres films de fiction. Pour donner l'impression d'une continuité narrative, les réalisateurs disposent d'importants moyens, tout à fait différents de ceux des documentaristes : ils peuvent en effet agencer leur caméra à leur guise, placer les comédiens au bon endroit et sous le bon angle, leur indiquer les gestes à faire et les paroles à dire ; chaque prise peut être refaite plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit réussie ; les caméras (et les micros) peuvent occuper des positions qui seraient impossibles pour un cinéaste pris dans le cours des événements réels (par exemple des deux côtés d'une ligne de front) ; enfin, le montage permet de réunir tous les plans de manière à faire apparaître les continuités nécessaires à la compréhension (les mêmes personnages, leurs interactions, leurs déplacements, etc.). Tous les spectateurs qui connaissent même de façon sommaire les techniques de la réalisation cinématographique (écriture du scénario, tournage, montage) comprennent facilement le caractère entièrement artificiel de ce genre de reconstitutions qui, loin d'être filmées sur le vif, sont construites pour garantir une vision et une compréhension aussi claires que possible des événements.
L'impression de « réel » et de continuité narrative ne doit cependant pas masquer qu'il s'agit toujours bien là d'une « image », d'une représentation qui ne peut pas être confondue avec la réalité même. Les mêmes remarques déjà faites à propos du caractère partiel de toute représentation historique s'appliquent également ici : les vingt premières minutes du film de Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan, célèbres pour leur vision extrêmement réaliste des combats du débarquement, donnent un aperçu très raccourci d'événements qui se sont déroulés en fait sur plus d'une demi-journée... et si l'expérience des soldats américains à Omaha Beach fut sans doute très proche de celle montrée dans le film (et aussi sanglante), les expériences furent également diverses et parfois différentes (sans oublier que le débarquement américain sur Utah Beach distante de quelques kilomètres n'a entraîné que des pertes limitées).

La Prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini
Mais surtout, la fiction cinématographique oriente et interprète de façon importante les événements représentés, aussi bien par le choix des scènes reconstituées, que par la manière de les filmer et de les sonoriser ainsi que par le montage des différentes séquences. Il suffit de considérer les deux films cités pour comprendre que leur propos est très différent, presque opposé : Le Jour le plus long vise à célébrer une victoire militaire et à reconstituer son déroulement d'ensemble alors que le film de Spielberg montre surtout la violence des combats et le sacrifice des soldats en première ligne. Ainsi encore, des reconstitutions comme La Prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini (1966) et Le roi danse de Gérard Corbiau (2000) donnent des images très différentes du Roi-Soleil : le premier film décrit un souverain calculateur, sinon manipulateur, pleinement conscient des stratégies qu'il met en place, utilisant la cour comme un théâtre sinon un simulacre, alors que le second montre l'engagement psychologique intense du jeune souverain dans une activité où il excelle de façon presque jouissive, même si elle sert par ailleurs la glorification de son pouvoir ; et, si le premier voit par exemple dans l'utilisation des costumes une pure man¦uvre politique visant à asservir la noblesse aux caprices dispendieux de la mode, le second souligne avant tout le caractère d'apparat et la fascination du spectacle de cette sacralisation du corps du roi.
Dans la fiction cinématographique, le caractère orienté, plus ou moins unilatéral, souvent subjectif et parfois partial de la reconstitution est particulièrement manifeste et peut concerner tous les éléments du film qui, contrairement au documentaire[40], font l'objet d'un travail de mise en scène généralement très élaboré. Autrement dit, la fiction aussi saisissante soit-elle, aussi fortes soient les impressions et les émotions suscitées, aussi convaincante soit la mise en scène, doit plus que tout autre récit être confrontée à d'autres sources historiques si l'on veut que la représentation spectaculaire (même si elle est volontairement épurée ou distanciée chez une cinéaste comme Rossellini) ne « masque » pas la réalité dans ses multiples aspects mais aussi et surtout avec les multiples interprétations qui peuvent en être faites. Cela ne signifie d'ailleurs pas que ce recours à d'autres sources d'information permettra de « trancher » entre des interprétations concurrentes ni d'établir une quelconque « vérité » historique incontestable : à propos d'une figure comme celle de Louis XIV, on constatera sans doute les mêmes divergences d'opinion entre historiens qu'entre les deux cinéastes cités à l'instant[41]. L'Histoire reste aussi pour une grande part indécidable.
Les derniers exemples cités mettent en évidence le fait que l'Histoire comme récit - qu'il s'agisse d'un ouvrage écrit par un historien, d'un documentaire filmé ou d'une fiction cinématographique - n'est jamais un simple reflet de la réalité et implique toujours une part de construction ou de reconstruction. Ainsi, un historien peut récolter l'évolution du prix du blé pendant l'Ancien Régime et montrer que les augmentations brutales des prix correspondent à des crises frumentaires et à des disettes sinon à des famines[42] ; mais une telle interprétation suppose la constitution de séries chiffrées (prix et années), l'élaboration de graphiques pour visualiser l'amplitude des variations et leur évolution sur le long terme, la mise en correspondance de ces variations et des disettes. Autrement dit, l'historien ne se contente pas d'accumuler les faits ou les données de façon fragmentaire, discontinue et désordonnée; il les met en relation - en reliant notamment les causes et les effets supposés -, il les généralise - en parlant par exemple de l'opinion publique française, de la classe ouvrière, de la société capitaliste, de l'Ancien Régime, des Grandes Découvertes... -, il les analyse - en soulignant la proportion de paysans dans la France médiévale, en distinguant l'utilisation tactique différente des blindés par les armées française et allemande en juin 1940, en retenant les dates-clés d'un règne ou d'une présidence[43]... - mais ces relations, ces généralisations et ces analyses, même si elles sont vérifiables et vérifiées, sont bien une construction de l'historien et ne sont pas directement « présentes » ni inscrites dans les documents d'archive de toutes sortes dont il dispose.
Au cinéma, le documentariste va de la même manière sélectionner les images dont il dispose, les organiser - souvent de manière chronologique -, ajouter des commentaires, des sous-titres, des intertitres, des cartes, des graphiques parfois, agencer les séquences de manière à faire apparaître entre elles des liens, des redondances, des confirmations mais aussi des contrastes ou même des contradictions. On relèvera en particulier l'utilisation très fréquente de témoignages filmés mais également de propos oraux ou écrits postérieurs aux événements rapportés, propos qui peuvent être ceux d'un simple témoin, d'un historien ou d'un personnage important (qui, dans ce cas, pourront d'ailleurs être repris ou répétés en voix off par un acteur avec parfois l'image de l'ouvrage dont ils sont tirés[44]). Tous ces commentaires de nature très différente auront alors pour fonction de dire le sens de ces événements, d'en éclairer certains aspects, d'en préciser la valeur, d'en tirer une « leçon » plus ou moins générale...


The War de Ken Burns et Lynn Novick
L'expérience individuelle d'un soldat prend facilement une valeur générale.
Le témoignage des civils est retenu dans la mesure où il traduit avant tout l'impact de la guerre sur leur vie personnelle.

La Vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier (1966)
Philippe Noiret joue le rôle d'un officier chargé, deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, de recenser et d'identifier les soldats disparus.
Bien entendu, c'est le documentariste lui-même qui est en dernière instance le responsable du sens général donné aux événements, que ce soit par l'importance donnée aux différents éléments dont il dispose, par le choix et l'organisation générale des séquences, par les commentaires écrits ou oraux qui accompagnent les images, ou par le crédit accordé à certains témoins ou certains historiens, ou au contraire par la dénonciation de certains propos comme étant erronés ou mensongers (ainsi des images de propagande nazie confrontées aux films tournés lors de la libération des camps). Tout ce travail, loin d'être simplement dicté par les faits eux-mêmes, est bien une construction, une interprétation, une élaboration qui à la fois définit le sens des événements, leur valeur (morale, politique, humaine, philosophique, esthétique parfois...), le contexte où ils s'inscrivent, leur portée plus ou moins générale.
Cette élaboration peut souvent passer inaperçue tant certains de ses procédés sont évidents et implicites. Ainsi, Ken Burns et Lynn Novick, les réalisateurs de la série documentaire The War consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vue du point de vue américain, ont recueilli les témoignages d'une quarantaine de personnes originaires de quatre villes des États-Unis, en supposant que ces témoignages étaient représentatifs de l'expérience d'un beaucoup plus grand nombre de personnes et pouvaient ainsi donner une image générale de la manière dont cette guerre avait été vécue par une majorité d'Américains. Cette généralisation, que le spectateur est également amené à faire implicitement, a néanmoins été critiquée notamment par la communauté hispanique qui a constaté qu'aucun de ses membres ne figurait parmi les témoins retenus[45]. En outre, on remarquera que la sélection des témoignages dans cette série repose sur la conviction qu'ils étaient marqués d'une manière ou d'une autre par l'expérience de la guerre, ce qui justifie bien sûr le grand nombre de témoignages d'anciens combattants : un certain nombre d'Américains ont cependant pu vivre toute cette période avec une beaucoup plus grande distance (parce qu'ils étaient trop jeunes, trop vieux, ou parce qu'ils étaient des civils éloignés de l'effort de guerre[46]), mais, de ce fait, leurs éventuels témoignages n'ont pas été retenus. Par comparaison, on se souviendra du film de Robert Mulligan, Un été 42 (Summer of '42, 1971) qui évoque l'éducation sentimentale et sexuelle d'un jeune adolescent à l'écart de la guerre qui pourtant fait rage au même moment.
Encore une fois, il ne faut pas conclure que cette construction est nécessairement synonyme de fausseté ou de manipulation : la vérité des choses n'est pas donnée par les choses elles-mêmes mais doit être élaborée pour apparaître aux yeux de l'observateur, du lecteur comme du spectateur. L'impression d'immédiateté que donnent la photo et le cinéma ne doit pas non plus faire illusion : pour reprendre l'exemple facile d'une série documentaire sur la Première Guerre mondiale comme Apocalypse, les images, aussi « parlantes » soient-elles, pas plus d'ailleurs que d'autres documents d'époque, ne nous donnent un chiffre « simple » comme celui des pertes subies par les belligérants : pour mesurer l'ampleur de ces pertes (qui sont sans doute aujourd'hui bien connues), il a fallu consulter les archives militaires mais également civiles de multiples pays, faire dans de nombreux cas des estimations, parfois suppléer aux lacunes des documents, totaliser finalement des chiffres venant de plusieurs sources parfois difficilement accessibles. Il s'agit là précisément d'un travail d'historien (et plus certainement de nombreux historiens) consistant à élaborer des statistiques à partir de données « brutes », fragmentaires et dispersées[47].

La Liste de Schindler de Steven Spielberg
Le réalisateur a déclaré avoir tourné en noir et blanc par souci d'authenticité parce que les photos de l'époque étaient majoritairement en noir et blanc. Il s'agit pourtant d'une transposition puisque la vie ? même dans ses aspects les plus cruels ? est en couleur.

L'Image manquante de Rithy Panh (2013)
Le réalisateur d'origine cambodgienne Rithy Panh évoque l'histoire de son pays pendant la dictature des Khmers rouges (1975-1979) en utilisant notamment des figurines modelées en argile. L'histoire est authentique, basée essentiellement sur ses souvenirs personnels, mais fait l'objet d'une évidente transposition dans un média naturellement différent de la réalité évoquée.
La représentation vraie ou fausse est donc nécessairement distincte de la réalité, mais il faut encore aller un peu plus loin et préciser qu'elle est d'une autre nature, profondément différente. De manière un peu savante, on dira que la vérité ne peut apparaître que si la réalité fait l'objet d'une transposition dans un autre medium, que ce soit la langue (orale ou écrite), l'image, la photo, le cinéma... La phrase « le chien mord » ne mord évidemment pas et n'a pratiquement aucune des caractéristiques de la réalité qu'elle représente néanmoins. La distinction entre les mots et les choses auxquelles ils réfèrent peut paraître élémentaire, mais cela signifie que toute représentation a des caractéristiques qui ne sont pas celles de la réalité qu'elle représente : ainsi, sur une carte routière, les autoroutes peuvent être de couleur orange, les routes principales de couleur rouge et les voies secondaires de couleur jaune, alors qu'aucune de ces couleurs n'est évidemment présente dans la réalité. Sur une photo en deux dimensions, des zones adjacentes, proches l'une de l'autre, pourront néanmoins représenter des objets plus ou moins éloignés en profondeur. La narration historique peut bouleverser l'ordre chronologique et rassembler en quelques phrases des événements qui s'étalent sur plusieurs années et concernent des endroits très différents (« La guerre de Cent Ans oppose les royaumes de France et d'Angleterre »). La représentation possède donc une organisation (par exemple la syntaxe de la langue), une « structure » (les niveaux de gris ou les deux dimensions d'une photo en noir et blanc représentant une réalité en trois dimensions et en couleur), une disposition (le cadre d'une photo) ainsi qu'une série de caractéristiques plus ou moins dispersées, plus ou moins fragmentaires (au cinéma, un mouvement de zoom vers un objet pour en saisir un détail) qui lui sont propres et qui n'existent pas dans la réalité représentée.
L'histoire représentée, qu'elle soit vraie ou fausse, exacte ou inexacte, n'est jamais un simple « reflet » et implique nécessairement une transposition, une transformation, une manipulation (au sens neutre du terme), une adjonction d'éléments hétérogènes à la réalité représentée. Dans le cas du documentaire filmé par exemple, on note très souvent la présence de musiques d'accompagnement, absentes évidemment des faits racontés mais qui « traduisent », évoquent, suggèrent l'ambiance de l'époque ou le sens que l'auteur donne à ces événements : chaque épisode de la série The War de Ken Burns et Lynn Novick est ainsi accompagné de plusieurs morceaux de musique orchestrale que l'on peut qualifier selon sa sensibilité de mélancolique, de dramatique ou même de pompeuse et qui oriente la réception du spectateur notamment d'un point de vue émotionnel. Il serait absurde de qualifier cette musique de mensongère - même si certains pour des raisons diverses pourront l'estimer superflue et déplacée[48] -, mais il est clair qu'elle n'est pas « commandée » par les faits eux-mêmes et résulte d'un choix des réalisateurs, constituant une « adjonction » manifeste par rapport aux documents d'archive et aux témoignages dont ils disposaient.

«Les Belges ont des trains blindés et de puissants forts qui protègent les villes.»

«Pour les Allemands, c'est une mauvaise surprise. Ils perdent des jours sur leur plan de guerre»
Apocalypse. La Première Guerre mondiale
d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle (1998)
Ces deux images tirées de deux plans successifs illustrent facilement la fonction du montage dans ce documentaire.
Les premières images montrent un mitrailleur et un autre soldat belge sans grande précision : on ne sait ni où ni quand ni dans quelles conditions ces images ont été tournées. Elles ne correspondent pas en tout cas au texte dit en voix off : les soldats belges en question ne sont ni dans un fort ni dans un train blindé.
Les images suivantes n'ont pas pu, sauf hasard exceptionnel, être tournées au même moment ni au même endroit. Là aussi, le commentaire est relativement éloigné de ce que l'on voit effectivement à l'écran, puisqu'il parle d'un retard sur un plan de guerre, alors que les images montrent seulement des canonniers en action.
Par un procédé implicite de généralisation, le montage donne donc un sens original aux images : deux soldats représentent une armée belge faiblement équipée, tandis qu'un groupe d'artilleurs suggèrent la puissance de l'armée allemande.
On remarquera enfin que ces images ont fait l'objet d'une double transposition : tournées à l'origine en noir et blanc, elles ont été colorisées pour cette série.
Dans les documentaires, outre la musique et les commentaires, la manipulation la plus importante et la plus visible se situe certainement au niveau du montage : alors que les faits historiques se déroulent dans un présent continu, le montage coupe les séquences de manière arbitraire (mais sans doute signifiante), crée des ellipses temporelles ou spatiales plus ou moins brutales, bouleverse éventuellement la chronologie, rapproche des faits éloignés dans le temps ou dans l'espace, établit des rapprochements, des contrastes, des parallèles, des analogies entre des événements en réalité distincts et séparés... Encore une fois, de telles manipulations ne sont pas nécessairement mensongères ou erronées, mais elles constituent bien une construction extérieure aux faits eux-mêmes, traduisant très généralement une interprétation (plus ou moins valide) des faits eux-mêmes par les auteurs du documentaire ou leur porte-parole (dans le cas d'un commentaire en voix off censé donner le sens général des images montrées).
Enfin, les films de fiction à prétention historique impliquent évidemment une reconstruction totale (si l'on excepte l'utilisation de certaines images d'archives[49]), un travail de mise en scène, une direction d'acteur, des conditions de tournage qui font de la reconstitution quelque chose de tout à fait différent de la réalité elle-même. Et le spectateur qui se retrouve plongé dans les vingt premières minutes d'Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, aussi impressionné soit-il par les images qu'il voit, ne peut totalement oublier que c'est bien l'acteur Tom Hanks qu'il a devant les yeux et non un supposé capitaine Miller de l'armée américaine en juin 1944...
Qu'il s'agisse donc d'un documentaire ou d'un film de fiction (ou d'un genre mixte comme le docu-fiction), le travail de représentation ne consiste pas simplement à « traduire » ou à « refléter » une réalité, et il suppose une mise en ¦uvre complexe de techniques de toutes sortes qui sont étrangères à la réalité évoquée et qui induisent des effets de sens multiples, une dramaturgie, une temporalité, des impressions et des émotions spécifiques à la représentation. Si pratiquement aucun film n'échappe à une telle élaboration, se pose alors la question de la valeur de vérité du film, de l'ensemble de cette construction à prétention historique : si la manipulation est partout, toute manipulation est-elle mensongère ? Et inversement, si la vérité est nécessairement reconstruite, à quelles conditions une telle élaboration peut-elle prétendre à la vérité ? Enfin, plus spécifiquement, comment le spectateur qui n'est pas historien peut-il alors porter un jugement sur ce genre de films et sur leur éventuelle vérité ?
Pour juger de la vérité d'une représentation (propos, texte, image...), il semble qu'il nous suffit de comparer cette représentation à la réalité qu'elle est censée représenter : si quelqu'un prétend qu'il y a un chat couché sur la table du jardin, je n'ai qu'à jeter un ¦il sur cette table pour vérifier si c'est bien le cas... Pour valider ou infirmer une représentation il suffirait donc de se mettre dans la position d'un tiers observateur entre cette représentation et la réalité représentée.

1492. Christophe Colomb de Ridley Scott (1992)
Mais, dans un très grand nombre de situations, il est difficile d'opérer une telle vérification parce que, comme individu situé géographiquement et temporellement, je ne peux pas observer directement la réalité évoquée : ainsi, je suis incapable de vérifier par mes propres moyens que la longueur du fleuve Amazone est approximativement de 6 500 kilomètres... Et dans le cas des événements historiques, cette difficulté devient une impossibilité fondamentale : le réel n'existe plus, même si un certain nombre de traces en subsistent. Il m'est totalement impossible de vérifier de visu que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492 ou que Hitler a attaqué la Pologne le 1er septembre 1939. Bien entendu, j'ai suffisamment de témoignages, de traces, de documents, d'ouvrages de toutes sortes qui attestent de ces faits, pour ne pas devoir sérieusement en douter. Néanmoins, toutes les preuves historiques, archéologiques, documentaires, photographiques ou autres ne nous donnent qu'un accès indirect et limité à la réalité et supposent une interprétation qui peut toujours être mise en doute : Jésus-Christ est-il un personnage historique ou une légende ? Et Moïse ou Abraham ? Ou Homère ? Et le preux Roland ou Guillaume Tell ? Les preuves de leur existence sont-elles suffisantes ou faut-il en douter ? Et que penser des événements de leur vie ? Chaque jour, les historiens sont ainsi confrontés au manque de traces et à l'impossibilité d'atteindre une réalité disparue.
Nous sommes donc obligés de recourir à d'autres stratégies pour juger de la vérité des représentations multiples auxquelles nous sommes confrontés. La plus commune sans doute consiste à comparer les représentations nouvelles aux connaissances que nous possédons déjà et qui définissent pour nous des normes générales de vraisemblance.
Un exemple récent de manipulation d'images permet de mieux appréhender cette stratégie. On sait que les images des stars, notamment celles reproduites en couverture des magazines, sont modifiées avec des logiciels de retouche (dont le plus célèbre est Adobe Photoshop®), et certains sites s'amusent ainsi à comparer l'avant et l'après en révélant ainsi l'importance de ces améliorations. Or, quand on compare ces paires d'images, il n'est même pas nécessaire qu'on nous signale par une étiquette laquelle est retouchée, car nous devinons immédiatement, par notre connaissance personnelle des visages et des corps humains, qu'il est improbable que, sur les images modifiées, les peaux soient aussi lisses et exemptes de rides et de défaut, ou que les silhouettes soient aussi galbées et élancées. Sans avoir jamais vu aucune de ces stars, nous pouvons, en nous basant sur notre propre expérience du monde et sur une vraisemblance générale, déterminer facilement quelle est l'image la plus réaliste.

Les Hommes contre de Francesco Rosi

La Reine Margot de Patrice Chéreau
Une telle stratégie nous est particulièrement nécessaire face aux films de fiction (notamment s'ils ont une prétention historique), car aucun signe ne nous indique où finit l'histoire (authentique) et où commence la fiction : c'est une vraisemblance générale, très tôt acquise[50], qui nous permettra de décider facilement que les aventures comiques des deux compères de la Grande Vadrouille de Gérard Oury (1966) relève clairement de la fiction. En revanche, il nous sera sans doute plus difficile de décider si les étranges armures montrées par Francesco Rosi dans les Hommes contre (Uomini contro, 1970) ont réellement été expérimentées par l'armée italienne sur le front lors de la Première Guerre mondiale ou s'il s'agit d'une invention du cinéaste et de ses accessoiristes[51].
Mais notre connaissance du monde ne dépend que pour une part réduite de notre expérience personnelle : l'essentiel de nos connaissances (en particulier historiques) est acquis indirectement via l'école, les médias, les livres, Internet... et ces savoirs varient dès lors grandement selon les individus. Ainsi, même si nous ne connaissons que de nom la reine Margot, la plupart des spectateurs du film de Patrice Chéreau (1994) ne s'étonneront pas de voir les hommes de l'époque manier l'épée ou la hallebarde, ni de constater que les conflits politiques et religieux de l'époque ont pu déboucher sur de véritables massacres. Et bien sûr, les plus avertis se souviendront qu'il s'agit plus précisément du massacre de la Saint-Barthélemy. Mais ces souvenirs souvent d'origine scolaire ne définissent qu'une vraisemblance générale et ne nous permettront pas de dire si notamment les portraits des différents protagonistes de ce film ainsi que les événements rapportés sont relativement exacts ou bien tendancieux ou même complètement faux.

Le Pianiste de Roman Polanski
La vraisemblance, notamment lorsqu'elle est basée sur notre propre expérience des choses et du monde, atteint ainsi rapidement ses limites. Un film cependant n'apparaît jamais seul et il est très généralement accompagné de discours de promotion, d'interviews (du réalisateur ou des acteurs), de textes critiques, d'éventuelles émissions de télévision, de références sur Internet... qui fonctionnent comme des procédures d'authentification. Ainsi, le Pianiste de Roman Polanski a été montré non pas de façon « brute » mais avec tout un contexte explicatif précisant en particulier qu'il s'agissait de l'adaptation d'une autobiographie, celle de Wadyslaw Szpilman, un des rares survivants du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale : la référence à ce témoin permettait donc d'attester de l'authenticité (au moins globale) du film de Polanski (dont on savait par ailleurs que lui-même jeune enfant avait été enfermé à la même époque dans le ghetto de Cracovie et en avait réchappé par miracle). Le contexte - au sens le plus large - des différents films nous incite ainsi à donner un crédit plus ou moins grand aux faits et événements représentés. Il peut s'agir d'indications du générique comme « basé sur des faits réels », de l'incrustation au bas de l'écran des titres universitaires de certaines personnes interviewées (dans un documentaire), d'évocation éventuelle des sources historiques utilisées (qui peuvent apparaître à l'écran, notamment dans un documentaire), d'informations diffusées à travers la presse et les médias qui confirment, nuancent ou parfois infirment la véracité des faits représentés (de façon globale ou en détail)...
Mais il faut bien voir que c'est un contexte social et institutionnel beaucoup plus large qui fonde notre croyance dans l'authenticité de la grande majorité des faits historiques qui nous sont rapportés. Ainsi, nous croyons très généralement ce que nous enseignent nos professeurs d'histoire à l'école alors que nous n'avons pas les moyens de vérifier l'exactitude de leurs dires. Et nous les croyons parce qu'ils font partie d'une institution qui est censée contrôler les connaissances que produisent et diffusent ses membres : un individu peut se tromper occasionnellement, mais l'ensemble de l'institution est censé garantir la validité des enseignements prodigués.
De la même manière, lorsque l'on considère de grands médias comme la presse, le cinéma ou la télévision, nous estimons très généralement que les informations diffusées (pour autant qu'elles ne soient évidemment pas présentées comme fiction) sont vraies, notamment parce nous supposons que les erreurs, inexactitudes ou même mensonges éventuellement diffusés seront dénoncés par les autres médias. Nous croyons ce qu'on nous raconte parce que nous n'avons pas les moyens matériels de vérifier toutes ces informations, et parce que nous pensons que d'autres institutions ont la charge de contrôler leur validité. Ainsi, d'un point de vue individuel, nos connaissances historiques sont essentiellement fondées sur la croyance ou, si l'on veut, sur la confiance que nous accordons au « monde des historiens », c'est-à-dire à l'institution globale qui produit le savoir historique.
Il arrive bien sûr que les institutions, même les plus solides, soient en crise, et la monarchie absolue de droit divin s'est écroulée en France avec la Révolution française... Le monde des historiens n'échappe pas à la contestation et les querelles entre historiens ou écoles historiques sont fréquentes et parfois violentes. On observera cependant immédiatement qu'il n'y a pas de crise globale ni de remise en cause générale des certitudes historiques qui déboucherait sur un scepticisme général : la corporation des historiens - qui font partie dans leur grande majorité des institutions universitaires internationales - partage un certain nombre de méthodes et de normes de travail, reconnaît la validité de certaines preuves, de certains documents, de certains témoignages et s'accorde sur un très grand nombre de faits et d'événements historiques - aucun historien ne doute sérieusement de l'existence de Napoléon ni que l'homme ait posé le pied sur la lune en 1968 - mais également d'interprétations parfois extrêmement complexes : les spécialistes de l'assyriologie ont non seulement été capables de déchiffrer une écriture oubliée - l'écriture cunéiforme - mais ils ont découvert et compris (au moins en partie) une langue totalement inconnue, sans parenté aucune avec d'autres plus récentes, le sumérien, écrite et parlée par les « occupants archaïques de la Mésopotamie méridionale, promoteurs de sa haute civilisation à partir du IVe millénaire, inventeurs de son écriture autour de 3 200, puis disparus, absorbés par les Sémites plus vivaces et plus nombreux, au plus tard au tournant du IIIe au IIe millénaire »[52]. Les procédures d'interprétation historique d'une réalité dont les traces sont pourtant fragmentaires et fragiles sont suffisamment assurées pour permettre l'accord sur une interprétation extrêmement complexe et difficile que les non-spécialistes sont quant à eux incapables de maîtriser et de vérifier.

Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick

Sergent York de Howard Hawks
Débats et polémiques apparaissent donc dans des cadres de connaissance largement partagés, et l'on peut dire que les crises sont « locales » et relativement limitées. On remarque notamment que, si l'établissement des faits[53] donne peu matière à contestation en particulier dans les périodes récentes où les documents abondent, leur interprétation peut varier grandement et donner lieu à des querelles non résolues. Pour donner un exemple récent, l'attitude des soldats pendant la Première Guerre mondiale face à des situations d'une violence extrême et apparemment insoutenable - notamment aux yeux de nos contemporains - a donné lieu à de vives querelles entre écoles historiques : les uns soulignent les multiples contraintes et même l'oppression que le système militaire imposait à ces hommes (avec en particulier la menace des conseils de guerre et des exécutions sommaires), alors que d'autres mettent en avant une forme de consentement à la guerre, notamment au début du conflit perçu comme une « croisade » pour défendre la patrie, la civilisation, la foi ou « l'humanité » contre la « barbarie » et la sauvagerie[54]. (On remarquera que la même opposition se retrouve illustrée au cinéma par des films aussi différents que les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick (1957) qui dénonce l'iniquité des conseils de guerre de l'armée française et Sergent York de Howard Hawks (1941) qui raconte la métamorphose d'un jeune paysan pacifiste en héros militaire de la Première Guerre mondiale.)
Les crises peuvent parfois prendre une plus grande ampleur, notamment lorsque sont mis en cause les fondements mêmes de l'institution accusée de manquer à ses exigences de vérité et de soutenir des opinions partisanes, plus ou moins cachées : c'est ainsi qu'au cours du XXe siècle des critiques d'inspiration marxiste, féministe, anticolonialiste ou antiraciste ont été adressées au monde des historiens qui, dans leurs travaux, refléteraient le point de vue de la bourgeoise, du patriarcat, de l'Europe colonisatrice ou plus généralement de l'homme blanc. Néanmoins, même si ces remises en cause étaient plus profondes, déniant même dans certains cas la possibilité à l'Histoire d'atteindre à une quelconque vérité objective[55], elles ont servi le travail historique en renouvelant les approches, en proposant de nouveaux sujets d'étude (le peuple, les femmes, les colonisés, les migrants...), en multipliant les points de vue, et leurs auteurs ont très généralement été intégrés à l'institution universitaire (dont souvent ils faisaient d'ailleurs déjà partie[56]).
Mais, pour certains spectateurs qui ne sont pas historiens, l'institution, malgré son autorité et les certitudes fondamentales partagées par l'ensemble de ses membres, peut susciter la méfiance et un soupçon parfois radical. La croyance est mise en cause, les historiens étant accusés de collusion avec le pouvoir, les autorités, les puissants de ce monde ou même des forces occultes agissant dans l'ombre pour imposer un faux consensus et même des contre-vérités : l'exemple le plus visible d'une telle attitude hyper-critique est celui des « négationnistes » qui prétendent que les chambres à gaz dans les camps nazis n'ont jamais existé et sont un mythe historique. Si le négationnisme est sans aucun doute une attitude déraisonnable, fondée sur des partis pris imbibés de fanatisme et d'antisémitisme, il révèle cependant que tout crédit accordé à des autorités savantes comme les historiens a des limites, et qu'entre la croyance presque naïve aux récits historiques et une défiance exagérée, il y a sans doute, pour le large public, différentes manières de juger de façon plus ou moins critique de la vérité de ces récits, que ceux-ci soient le fait d'historiens de profession, de romanciers, de documentaristes ou de cinéastes. Si la confiance ne peut être absolue, notamment parce que sur certaines questions, il peut y avoir débat entre historiens, quelle stratégie est-il alors raisonnable d'adopter pour un non-spécialiste face à des films qui prétendent à des degrés divers à la vérité historique ?
Le négationnismeLa place manque ici pour démonter l'argumentation fallacieuse des négationnistes qui sont malheureusement capables de jeter le trouble dans l'esprit de personnes peu averties. Deux grands arguments méritent d'être rapidement exposés à ce propos. Les négationnistes constituent, selon l'expression de l'historien Pierre Vidal-Naquet, une secte, c'est-à-dire un petit groupe qui s'auto-alimente grâce notamment au réseau Internet, en se prétendant victime d'une conspiration des historiens « officiels », c'est-à-dire essentiellement universitaires. Alors que les membres de cette secte n'ont pas de formation en ce domaine, leurs thèses et leurs arguments sont rejetés par tous les historiens universitaires : or, à part la fausseté de ces thèses et arguments, rien ne peut expliquer l'unanimité des historiens en la matière puisque, comme on l'a vu, ceux-ci peuvent s'opposer sur bien d'autres sujets, parfois de façon violente. Comment expliquer que les historiens dans des pays aussi différents que la France, la Belgique, l'Allemagne ou les États-Unis s'accordent sur la réalité des chambres à gaz dans les camps d'extermination d'Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno ou Maidanek ? Remarquons qu'il ne s'agit pas là d'un argument d'autorité, même scientifique, mais d'une question de vraisemblance : le monde des historiens et les institutions universitaires auxquelles ils appartiennent sont ouverts à la critique, aux débats, aux opinions contradictoires même s'il y a accord général sur les méthodes de recherche, de recueil des données et de vérification des hypothèses (du moins à l'intérieur de chaque discipline : la validation en mathématiques n'est évidemment pas la même que dans le domaine historique) ; l'accord entre les historiens sur l'existence des chambres à gaz ainsi que sur le génocide ne peut donc pas leur avoir été imposé à tous comme une « légende officielle » et résulte nécessairement de l'évidence et de l'abondance des preuves disponibles. Par ailleurs, les négationnistes recourent à une méthode hyper-critique consistant à examiner de façon isolée chaque document témoignant de l'extermination pour en souligner d'éventuelles erreurs, incohérences, approximations ou faiblesses (comme par exemple les aveux des gardiens des camps d'extermination lors de leurs procès en Allemagne après la guerre). Ils espèrent ainsi montrer qu'il n'y a aucune preuve décisive de l'existence des chambres en gaz ni du génocide des Juifs (qui seraient morts de maladie ou d'épuisement ou même victimes des bombardements alliés). Or il n'existe pas en histoire de « preuve décisive », irréfutable, incontestable : un document en apparence authentique peut avoir été falsifié, un témoin peut se tromper, une trace archéologique peut être trop fragmentaire... L'établissement des faits repose sur le recueil d'un maximum de sources documentaires, d'origines diverses, de natures différentes, sans doutes partielles, parfois erronées ou contradictoires, mais dont l'ensemble permet de reconstituer les événements de façon vraisemblable et cohérente : le doute à l'égard d'un document considéré de façon isolée - et faut-il encore que ce questionnement soit réellement pertinent et ne se contente pas de nier toutes les réponses qui peuvent lui être apportées - ne permet pas de remettre en cause toutes les données dont l'ensemble a seul valeur de preuve et d'évidence. Dans le cas du génocide juif et plus particulièrement des chambres à gaz, on dispose entre autres de la liste des convois de déportés juifs de l'Europe de l'Ouest à partir de 1942 dont seule une très petite minorité a survécu (3% des Juifs déportés de France, 5% des Juifs déportés de Belgique), des témoignages de plusieurs membres des Sonderkommandos, ces déportés juifs affectés aux crématoires, mais aussi des aveux de gardiens et de responsables de ces camps lors des procès d'après-guerre, d'une somme de documents d'époque comme les plans des firmes allemandes chargées de construire les crématoriums d'Auschwitz dont les importantes dimensions étaient destinées à un meurtre de masse, ainsi que de plusieurs rapports, de comptes rendus et de témoignages rédigés par les exécuteurs eux-mêmes au moment des faits. On soulignera également les multiples aspects de la politique antisémite du régime nazi depuis les premières mesures d'exclusion et d'expropriation des Juifs allemands avant guerre, suivies à partir de l'invasion de la Pologne de l'enfermement des Juifs de l'Est européen dans des ghettos mortifères, de la déportation systématique des populations juives de tous les pays occupés, des massacres à grande échelle opérés par les Einsatzgruppen après l'invasion de l'URSS en 1941 (ces unités mobiles de l'armée et police allemandes ont fait sans doute 1 400 000 victimes)... On notera enfin que les nazis n'ont pas hésité à éliminer par ailleurs d'autres groupes jugés inaptes, dangereux ou simplement inutiles comme les handicapés en Allemagne (qui furent les premières victimes de gazage), les Tsiganes ou les prisonniers de guerre soviétiques (3,3 millions sur un total de 5,7 millions mourront de malnutrition et de mauvais traitements ou directement exécutés selon l'historien allemand Christian Gerlach). Pour les historiens, tous ces faits largement documentés ne constituent pas une simple accumulation mais ils montrent une radicalisation de la politique antisémite du régime nazi dont la violence ne cessa de croître dans un contexte de guerre « totale ». C'est donc l'ensemble de ces faits, documents et témoignages qui attestent pour les historiens d'une politique cohérente, de plus en plus raciste et meurtrière, débouchant à son dernier stade sur le génocide juif et l'extermination directe par les armes ou dans les chambres à gaz. Outre les ouvrages classiques de Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d'Europe. 2 volumes, Paris, Gallimard (Folio Histoire), 1991, d'Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Rückerl, Les chambres à gaz, secret d'État. Paris, Seuil (Points-Histoire), 1987, de Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire. Paris, La Découverte, 1991, et de Maxime Steinberg, Les Yeux du témoin et le Regard du borgne. L'Histoire face au révisionnisme. Paris, Les Éditions du Cerf, 1990, on peut consulter sur cette question notamment les sites web suivants (en français) : |
Si la confiance accordée à la parole des historiens ne peut pas être absolue, et si la vraisemblance générale reste un instrument de vérification très approximatif, comment alors juger de la validité historique d'un documentaire ou d'un film de fiction ?
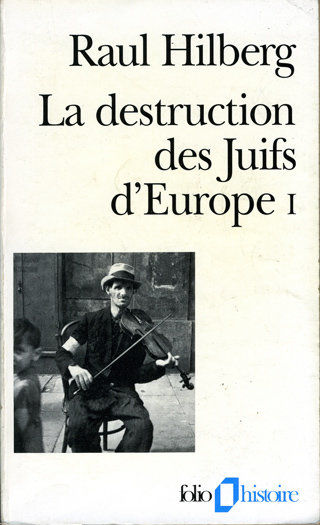
On remarquera immédiatement que le crédit que l'on peut accorder à ce que l'on a appelé l'institution historique - par exemple à une série historique où sont interviewés certains historiens - se distingue nettement de la démarche qui consiste à se référer à des ouvrages historiques (livres, articles ou plus rarement réalisations audio-visuelles) portant sur les mêmes thèmes que le film envisagé. Ainsi, la Liste de Schindler de Steven Spielberg a été accompagnée à sa sortie par plusieurs interviews dans la presse française de l'historien Raul Hilberg[57], dont l'ouvrage La Destruction des Juifs d'Europe est unanimement reconnu comme un ouvrage majeur sur la question, et qui attestait de façon globale de la véracité des événements mis en scène dans le film ; mais il y a évidemment une grande différence entre la lecture rapide de ces interviews et celle de l'ouvrage de Hilberg qui fait plus de mille pages et compte trois volumes (deux dans une édition antérieure)...
Or la lecture d'un tel ouvrage apportera sans aucun doute d'autres informations que la vision du film de Spielberg puisqu'il décrit non seulement le processus d'exclusion, d'enfermement et d'extermination en Pologne mais également dans les autres pays européens occupés ; il rend également compte de l'ensemble du processus politique, policier et bureaucratique qui s'est mis en place dans l'Allemagne nazie à partir de 1933 et qui conduira à la destruction de la plus grande partie des communautés juives d'Europe. Cette remarque ne vise pas à dévaloriser la Liste de Schindler mais seulement à faire percevoir la différence entre les deux démarches et à prendre la mesure d'une réalité - le génocide juif perpétré par les nazis - qui est évidemment beaucoup plus vaste que les faits mis en scène par Spielberg. Bien entendu, la somme de Raul Hilberg, aussi dense et fouillée soit-elle, ne peut pas non plus prétendre représenter totalement et complètement une telle réalité qui continue à faire l'objet de nombreuses recherches et études qui complètent un tableau jamais achevé. Il ne s'agit pas non plus de dire que l'ouvrage de l'historien est par principe plus vrai ou plus authentique que le film du cinéaste hollywoodien, mais de mettre l'accent sur les spécificités de l'un et de l'autre.
Si l'on reprend les caractéristiques essentielles de toute représentation du passé - à savoir son caractère partiel mais également partial ainsi que sa dimension de reconstruction nécessairement hypothétique -, l'on comprend facilement qu'aucun film, qu'aucun documentaire ne peut prétendre nous donner un accès direct à la réalité, aussi efficaces et impressionnantes soient éventuellement les images présentées. Or une telle illusion est sans doute fréquente chez beaucoup de spectateurs : pour s'en défaire, il faut nécessairement recourir à d'autres sources d'information - puisque la réalité nous est définitivement inaccessible -, qu'il s'agisse d'ouvrages ou d'articles historiques ou... d'autres films.
C'est bien par la comparaison et par la confrontation des sources (même si elles sont secondaires[58]), qu'il est possible d'améliorer notre connaissance historique. Sans doute, toutes les sources ne sont pas fiables au même degré (voir l'encadré ci-dessous), mais c'est la fréquentation de ces différentes sources qui permet de prendre progressivement la mesure de leur pertinence plus ou moins grande.
C'est également la confrontation des sources qui révélera la différence des points de vue. En effet, si nous considérons un film isolément, nous pouvons percevoir plus ou moins bien le point de vue de l'auteur, mais cela restera néanmoins le plus souvent sommaire, et nous serons surtout incapables de savoir concrètement ce que pourraient être d'autres points de vue. Si, au début de la série The War de Ken Burns et Lynn Novick, la voix off précise qu'il s'agit du point de vue américain sur la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons imaginer de façon très vague le point de vue des ennemis de l'Amérique, le Japon et l'Allemagne, mais nous serons incapables de donner un contenu précis à ce point de vue : seules d'autres sources d'information pourront nous permettre de comprendre (ce qui ne signifie pas justifier) l'impact de l'idéologie nazie sur l'opinion publique allemande[59] ou les raisons politiques et militaires des responsables japonais qui ont pris la décision d'attaquer Pearl Harbor en décembre 1941. Même certains points de vue proprement américains n'apparaissent pas dans The War, et ce sont d'autres travaux historiques qui seuls nous permettront de comprendre par exemple la situation des rares objecteurs de conscience[60] ou bien les objectifs et stratégies des responsables politiques et militaires du pays[61].
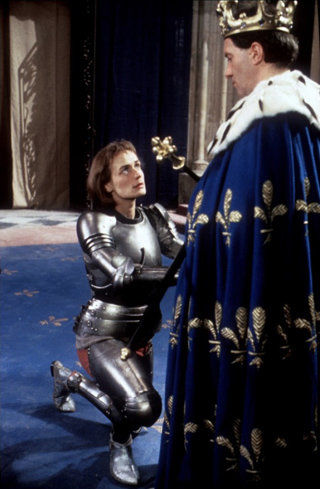
Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette

Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood
Le point de vue de l'auteur d'un documentaire ou d'un film de fiction ne se confond cependant pas nécessairement avec celui des personnes interviewées ou des personnages mis en scène. Jacques Rivette (Jeanne la Pucelle, 1994) ne croit sans doute pas que Jeanne d'Arc obéissait aux ordres de l'archange saint Michel, et Stanley Kubrick filme avec beaucoup de distance les marines fanatisés de Full Metal Jacket (1987). Il ne s'agit pas seulement de montrer les choses sous un certain angle ou de sélectionner les événements à montrer mais plus largement de les interpréter (ou de suggérer des interprétations), c'est-à-dire de construire, comme on l'a vu, des relations de sens, plus ou moins cohérentes, entre ces événements ou à partir de ces événements, alors que de telles interprétations échappent le plus souvent aux individus pris dans l'Histoire. Mais, à nouveau, voir un film de manière isolée nous amène presque immanquablement à partager le regard de son auteur sur les événements, et il est difficile, par un effort intellectuel individuel, de prendre de la distance par rapport à son point de vue et surtout d'imaginer une autre interprétation basée notamment sur des éléments non retenus par ce film : un film comme Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick nous impose de façon tellement évidente l'absurdité de la guerre, l'indifférence cruelle des officiers supérieurs, l'iniquité des tribunaux militaires, la violence démesurée subie par les soldats de la troupe, que l'on ne peut guère que partager la leçon pacifiste du film. L'on se souvient pourtant que, sur la question d'un éventuel « consentement » à la guerre de la majorité des soldats, il y a un débat entre historiens. Il ne s'agit évidemment pas de prétendre que l'interprétation de Kubrick est « fausse », mais seulement de prendre conscience qu'il existe des interprétations « concurrentes » ou différentes des mêmes événements, relativement solides d'un point de vue historique[62].
Bien entendu, seuls les jeunes enfants regardent les films de façon naïve, complètement isolée, sans aucune référence historique susceptible de nuancer ou de contrebalancer la vision qui leur est proposée, et notre culture personnelle, surtout lorsqu'elle est faite de nombreuses lectures accumulées, nous permet généralement de prendre une première distance critique par rapport à un film de fiction ou un documentaire. Il n'est pas nécessaire de connaître le détail de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique pour comprendre que le film de Clint Eastwood, Mémoires de nos pères (Flags of Our Fathers, 2006), est un hommage appuyé au courage des soldats américains de cette époque et aux sacrifices qu'ils ont consentis, même si l'image générale qu'il en donne est nuancée et profondément humaine ; en outre, le cinéaste semble contrebalancer son point de vue unilatéral par le deuxième volet de son diptyque, Lettres d'Iwo Jima (Letters from Iwo Jima, 2006) qui raconte la même bataille vue par les soldats japonais montrés quant à eux comme les victimes inutilement sacrifiées par leur hiérarchie militaire ; mais, toute culture a ses limites, et aucun critique de cinéma francophone n'a semble-t-il relevé un fait beaucoup plus gênant, passé sous silence par Clint Eastwood (et ses scénaristes), à savoir la violence des préjugés racistes, aussi bien du côté américain que japonais, qui décrivaient l'ennemi de façon souvent abjecte et qui expliquent, au moins en partie, la cruauté d'une « guerre sans merci »[63] où notamment l'on ne faisait pas de prisonniers. Mettre de tels propos clairement racistes dans la bouche des personnages aurait certainement suscité aujourd'hui des réactions de rejet par rapport à des individus dont le cinéaste voulait au contraire montrer la profonde humanité. Dans le domaine historique, on le voit, le simple « esprit critique » ne suffit sans doute pas, et il est nécessaire de recourir à d'autres sources d'information pour pouvoir construire un point de vue différent et réellement argumenté.
Des sources fiables ?Il n'y a pas de « méthode » infaillible pour juger de la vérité d'un travail historique. On est donc obligé de se fier à des critères généraux de vraisemblance qui sont évidemment imparfaits et ne donnent aucune certitude absolue. Parmi ces critères, on peut néanmoins relever ceux-ci : En histoire, les universités fournissent des travaux de grande qualité dont le sérieux est en principe garanti par le contrôle des pairs. Les travaux universitaires citent généralement des sources primaires, c'est-à-dire des documents de première main non retravaillés par l'historien (les sources primaires sont en principe contemporaines de l'événement décrit). Ils s'appuient également sur d'autres travaux historiques reconnus, cités en bibliographie. Ces travaux sont normalement publiés dans des revues scientifiques (au sens large) qui sont soumises à des comités de lecture d'experts. Les différentes maisons d'édition qui publient des travaux historiques sont par ailleurs plus ou moins réputées pour la qualité de leurs publications (ainsi Gallimard, Le Seuil, Payot, La Découverte... en France). Si à présent beaucoup de travaux historiques sont également accessibles via le réseau Internet, les revues de niveau universitaire sont facilement repérables, bénéficiant notamment de labels prestigieux (comme celui du CNRS en France, le Centre National de la Recherche Scientifique). On peut citer en français des sites regroupant plusieurs revues scientifiques comme : (Tous les articles ne sont pas en libre accès, certains étant payants.) Ces articles et publications sont parfois d'un abord aride et ne sont pas nécessairement exempts de partis pris (comme d'ailleurs toutes les autres sources d'information, aussi fiables soient-elles). Ces travaux universitaires se distinguent des ouvrages et revues de vulgarisation qui synthétisent, reprennent, réécrivent, simplifient, résument les résultats de travaux originaux. Certaines de ces revues sont de grande qualité (comme L'Histoire en français), d'autres contiennent des articles plus sommaires, moins référencés, parfois plus partisans (même si aucune revue même scientifique ne peut prétendre à une totale impartialité). Parmi les grands médias d'information, beaucoup traitent de questions historiques : certains sont réputés pour le sérieux de leurs investigations ou de leurs comptes-rendus - on peut penser à des journaux comme Le Monde, Le Monde diplomatique en France, Le Soir ou La Libre Belgique en Belgique, à des chaînes de télévision comme Arte -, même s'ils expriment aussi des partis pris idéologiques. Qu'il s'agisse de revues spécialisées ou médias généralistes, on peut estimer qu'une source d'information abondamment lue et commentée est en général plus fiable qu'un informateur isolé qui n'est pas un témoin direct des faits et qui s'appuie donc sur des sources de seconde main. Un journal largement diffusé doit vérifier les informations qu'il diffuse, sous peine d'être l'objet de multiples critiques. Ce qui n'empêche pas, dans certains cas, erreurs, méprises ou, plus rarement, mensonges. Cette remarque vaut également pour le web. De manière générale, les sites les plus fréquentés sont également les plus commentés et doivent donc vérifier la validité de leurs informations. Ils font d'ailleurs appel à de nombreux collaborateurs, plus ou moins spécialisés. Un blog tenu par une seule personne est évidemment moins fiable, parce qu'il est moins lu, moins vérifié, moins discuté que des sites régulièrement exposés à la critique des lecteurs, notamment ceux qui ont une formation historique. De façon générale, quelle que soit la source d'information, on remarquera que les faits bruts (« il y a eu un déplacement de population ») prêtent généralement moins à discussion que leur interprétation (« qui est responsable de ce déplacement ? »). On soulignera également que, s'il est possible de montrer que certaines interprétations sont fausses (si l'on trouve des faits qui les contredisent), la plupart des interprétations peuvent seulement être qualifiées de plus ou moins vraisemblables : on peut supposer que la révolte nobiliaire de la Fronde a fortement marqué le jeune Louis XIV (qui n'était pas encore roi), ce qui pourrait expliquer toute la « domestication » ultérieure de la noblesse à la cour de Versailles, mais une telle explication, même partagée par de nombreux historiens, reste pour une part hypothétique. Par ailleurs, un fait isolé est moins significatif qu'un ensemble de faits, organisés de manière cohérente. S'il y a un principe de cohérence, l'on peut plus facilement remarquer les faits manquants et compléter le tableau proposé. De tels tableaux peuvent se présenter sous forme de cartes géographiques, de chronologies historiques, de données statistiques, de listes de toutes sortes mais homogènes. * Aucun de ces critères n'est absolument décisif, ni aucune de ces sources totalement fiable : des journaux réputés ont pu colporter de fausses rumeurs, des universitaires sérieux publier des résultats falsifiés, des institutions prestigieuses accréditer des mensonges d'État... Mais c'est bien par la confrontation et la multiplication des sources d'information aux opinons souvent divergentes qu'il est possible d'approcher au mieux une réalité historique. |

Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures
de Claude Lanzmann
Yehuda Lerner témoigne de la révolte des détenus à Sobibor: « J'avais le manteau qui recouvrait mes mains et la hache. Je me suis levé, j'ai laissé tomber le manteau, j'ai pris la hache, j'ai fait un tout petit pas vers lui, et tout a duré peut-être un millième de seconde [?...] J'ai pris la hache et il a laissé échapper un grand cri. Et il est tombé. »
Encore une fois, il ne s'agit pas de dévaloriser le cinéma en soi, ni de prétendre qu'il ne faut faire confiance qu'aux historiens reconnus par l'institution universitaire. Le cinéma lui-même (documentaire ou de fiction) peut offrir des contrepoints pertinents à la vision d'un film, et l'on ne peut que conseiller aux spectateurs de la Liste de Schindler de voir le film de Claude Lanzmann, Shoah, pour percevoir ce que fut concrètement le processus d'extermination, son ampleur, sa « machinerie », et approcher, même indirectement, même imparfaitement, le point de vue des victimes absentes du film de Spielberg. Mais il reste que la réalité est toujours plus vaste et plus complexe que l'image que peuvent en donner le cinéma, la télévision ou les livres, et que l'Histoire comme représentation écrite ou filmée n'est jamais achevée.
Il faut d'ailleurs souligner que certains films documentaires peuvent faire ¦uvre historique originale aussi bien que des ouvrages universitaires et faire connaître des faits et événements jusque-là largement ignorés. On pensera notamment au film de Claude Lanzmann, cité à l'instant, qui a indéniablement contribué à notre connaissance de la destruction des Juifs d'Europe, aussi documentée ait-elle été notamment par l'ouvrage de Raul Hilberg[64] (on signalera également un autre film de Claude Lanzmann, Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures qui évoque, grâce au témoignage d'un rare survivant, la révolte d'un petit groupe de déportés juifs du camp d'extermination de Sobibor, un événement exceptionnel dans l'histoire du génocide mais peu connu).

Les Invisibles de Sébastien Lifshitz

Tous au Larzac de Christian Rouaud
Mais d'autres réalisations moins célèbres méritent d'être relevées dans la même perspective. Ainsi, le documentaire très justement nommé Les Invisibles de Sébastien Lifshitz (2012)[65] évoque le parcours de personnes âgées, homosexuelles ou bisexuelles, qui ont dû vivre à une époque sans aucun doute moins tolérante que la nôtre et qui ont été effacées d'une certaine manière de toute forme d'Histoire : basé essentiellement sur des témoignages, le film permet d'approcher un grand nombre de situations très différentes, et il donne la parole à des personnes dont les vies, les sentiments, les points de vue ont été largement occultés pendant des décennies. Comme tout autre travail historique, celui-ci donne sans aucun doute une représentation partielle de la réalité, peut-être avec certains biais dus notamment à l'utilisation presque exclusive de témoignages individuels, mais il serait absurde de ne pas reconnaître l'originalité de la démarche et la richesse des informations recueillies.
Dans une perspective similaire, on peut citer Mémoires d'immigrés de Yamina Benguigui (1997) ou Tous au Larzac de Christian Rouaud (2011) qui marquent, par leur démarche même, le passage de l'actualité sociale, politique ou simplement humaine, à l'Histoire qui retrace, retravaille, reconstitue, réorganise, réinterprète les faits vécus de manière essentiellement différente : beaucoup d'immigrés de la première génération rêvaient de rentrer au pays alors que la cinéaste montre leur installation souvent définitive en France, et les militants du Larzac ont dû vivre pendant une dizaine d'années dans une incertitude complète sur l'issue de leur combat contre l'extension du camp militaire alors que l'on sait aujourd'hui que ce combat fut victorieux et a même valeur d'exemple pour des luttes actuelles. Comme on l'a déjà dit, il serait absurde de reprocher à ces documentaires comme à tout autre travail historique de réinterpréter le passé, et « l'écriture de l'Histoire »[66] implique nécessairement une recherche d'intelligibilité qui va relier les événements discontinus mais également le passé et le présent : c'est une différence de perspective entre générations que révèle notamment Yamina Benguigui (et que son film vise d'ailleurs à surmonter), et les militants du Larzac ont sans doute plus retenu aujourd'hui la solidarité nouvelle entre les habitants du plateau, née de la lutte, que les détails des combats effectivement menés ou même que l'objet de cette lutte[67].
Le cinéma peut donc faire ¦uvre historique originale. Sans doute, le recours privilégié au témoignage peut induire des biais dus au travail de la mémoire qui modifie parfois très profondément les événements relatés. La multiplicité des témoignages notammment est alors une manière de corriger de tels biais, comme d'ailleurs la sélection des « bons » témoins[68]. En outre, les événements représentés s'inscrivent dans un contexte plus large sur lequel l'on dispose généralement d'autres sources d'information qui permettent de confirmer (ou parfois d'infirmer) - au moins indirectement - ces événements : Shoah de Lanzmann, loin d'apparaître de façon isolée, est apparu au milieu des recherches historiques multiples sur le IIIe Reich et a évidemment apporté une contribution essentielle à la connaissance générale de cette période. Toutes les remarques déjà faites sur les limites de la représentation historique s'appliquent également ici, et si l'on ne possède pas ou peu de points de comparaison sur les questions abordées par ces documentaires (puisqu'ils abordent des sujets originaux), il faut au moins garder à l'esprit que l'histoire reste toujours ouverte, que ce soit à la recherche, au questionnement ou même à la remise en cause.
Mais le cinéma de fiction quant à lui peut-il prétendre, comme certains documentaires, apporter une information historique originale alors qu'il semble que cinéastes et scénaristes s'appuient généralement pour réaliser de telles reconstitutions sur les travaux d'historiens plus ou moins réputés ?
On remarquera d'abord que la recherche historique ne se limite pas à la découverte de documents originaux : tous les travaux s'appuient en principe sur ce qu'on appelle l'état de la science, c'est-à-dire des publications antérieures, reprises en principe dans une bibliographie aussi complète que possible et qui font l'objet d'une relecture plus ou moins importante. Les recherches antérieures seront ainsi, confirmées complétées, modifiées ou infirmées en fonction - mais pas uniquement - des nouvelles découvertes documentaires. En outre, certains ouvrages dont la valeur est pourtant largement reconnue constituent essentiellement des réinterprétations de faits et d'événements, déjà largement commentés mais que leur auteur estime mal ou peu compris par les travaux antérieurs[69]. Autrement dit, utiliser les données établies par d'autres pour produire un nouveau travail historique est une démarche tout à fait normale et légitime dans ce champ de recherche.
En principe, la réalisation d'un film de fiction pourrait faire appel à des historiens compétents susceptibles de découvrir des ressources documentaires nouvelles, mais l'on comprend facilement qu'il ne s'agit pas là de l'objectif premier de tout le système de production cinématographique... La plupart des réalisations vont donc recourir aux données documentaires déjà existantes dont elles vont néanmoins donner une « image » nouvelle, c'est-à-dire une interprétation plus ou moins originale. Et il n'est pas interdit de reconnaître une véritable valeur historique à une telle réinterprétation, même si elle prend les chemins de la fiction.


The Magdalene Sisters de Peter Mullan
Ainsi, Peter Mullan dans The Magdalene Sisters (2002), dénonçait l'enfermement dans l'Irlande catholique de jeunes filles « pécheresses » au sein d'institutions religieuses où régnaient des conditions de travail et de vie que l'on peut qualifier de « totalitaires »[70]. Pour ce film, il s'est appuyé notamment sur un documentaire télévisuel (Witness: Sex in a Cold Climate, 1998) reprenant le témoignage de quatre de ces jeunes filles, ainsi que sur d'autres documents d'archive comme des photographies des laveries où elles étaient contraintes de travailler (de façon symbolique, ces jeunes filles « impures » étaient censées laver le « linge sale » de la communauté environnante). Deux éléments doivent alors être mis au crédit du réalisateur.
D'abord, en recourant à toute la puissance du cinéma de fiction, il donne une large audience à une histoire qui ne semblait concerner qu'un petit nombre de personnes et appartenir déjà au « passé » : d'aucuns lui reprocheront d'ailleurs de recourir aux « ficelles » de la dramatisation, opposant notamment des prisonnières innocentes à des geôlières souvent sadiques, mais ce travail de mise en scène, accentuant sans doute certains traits de la réalité, s'inscrivait aussi dans un mouvement plus large visant à faire reconnaître les souffrances endurées par ces jeunes filles pendant des décennies et qui, au moment de la sortie du film, étaient encore largement méconnues sinon déniées en Irlande. Le cinéma comme l'Histoire peuvent aussi avoir des visées politiques (au sens le plus fort du terme), et, dans une telle perspective, la « dramatisation » cherchait bien à susciter l'indignation du public : mais qui pourrait prétendre qu'au final, ce travail de reconstitution, aussi dramatisée soit-elle, masque ou déforme le caractère scandaleux des faits dénoncés ?[71]
Par ailleurs, d'un point de vue plus proprement historique, le film de Peter Mullan met en scène des faits qui commençaient à être connus (bien qu'ils n'avaient encore fait l'objet d'aucune recherche universitaire), mais il les inscrit surtout dans un contexte beaucoup plus large : il montre notamment que les laveries, ces institutions « totalitaires », n'avaient pu fonctionner que dans un pays qui, après son indépendance (1921), a construit son identité nationale autour de l'Église catholique et de son modèle familial patriarcal « comme une société transparente et homogène, masquant ses aspérités et contradictions, se représentant elle-même comme pure et maintenue à l'abri de la corruption extérieure ». C'est bien la collusion de l'Église, de l'État et des familles qui est analysée par Peter Mullan, ainsi que la domination patriarcale et l'inégalité entre les sexes régnant dans toute la société irlandaise : « le film souligne combien la société et en particulier les hommes tiraient bénéfice de ces institutions » ; et il montre aussi, à travers la mise en scène de plusieurs infractions à l'ordre sexuel, « comment le discours irlandais sur l'immoralité gommait la culpabilité masculine, tout en punissant doublement les femmes, premières victimes de l'ordre moral »[72].
Il se peut que d'autres recherches, d'autres ouvrages, d'autres films, d'autres documentaires modifient, complexifient, nuancent, infirment même sur certains points le film de Peter Mullan, mais cela n'implique pas qu'on ne doive pas considérer qu'il s'agit là d'un travail proprement historique (même si, par ailleurs, il s'agit aussi d'un film de fiction, d'une ¦uvre esthétique, d'une forme aussi de divertissement, aussi dures soient les réalités évoquées). D'autres travaux plus complets, collationnant plus de données, proposant de nouvelles pistes d'analyse, pourront même faire « vieillir » le film de Peter Mullan (d'un point de vue strictement historique), mais c'est le cas de tous les ouvrages historiques soumis à un renouvellement constant de la recherche. Enfin, et on l'a suffisamment répété, The Magdalene Sisters comme toute représentation ne donne qu'une image partielle de la société irlandaise, n'en analyse et n'en souligne que certains aspects, négligeant sans doute d'autres éléments que seuls des travaux complémentaires pourraient éventuellement éclairer.
Le cinéma n'est pas l'histoire, même s'il y a indéniablement des zones de recouvrement. Pour terminer, il faut encore souligner que l'Histoire comme institution et le cinéma comme système de production médiatique poursuivent des objectifs très différents. On a déjà remarqué que les films historiques ne s'adressent pas aux historiens de profession mais à un large public qu'il ne s'agit pas seulement d'informer mais aussi de distraire, d'émouvoir, de conscientiser, d'éduquer... (Les livres d'histoire peuvent sans doute poursuivre les mêmes objectifs mais l'ordre des priorités est certainement différent.) Par ailleurs, si les historiens utilisent de plus en plus les sources audiovisuelles (avec néanmoins une grande prudence), leurs travaux prennent au final majoritairement la forme du texte écrit. On relèvera donc deux grandes caractéristiques du cinéma qui semblent essentielles lorsqu'il aborde des faits historiques.


Daens de Stijn Coninx
Ces deux images successives de la séquence d'ouverture montrent le travail des enfants dans une usine textile en Flandre à la fin du XIXe siècle. Le premier de ces plans est en noir et blanc comme s'il s'agissait d'un film ancien (ce qui historiquement est bien sûr impossible puisque le cinéma n'a pas encore été inventé, mais qui nous donne une impression d'image du passé); puis le réalisateur opère un passage rapide à la couleur: nous sommes alors plongés dans le présent de l'action, le «présent» du cinéma, la misère et l'exploitation des plus faibles...
L'image (même si l'on devrait plutôt parler de représentation audiovisuelle) privilégie, on l'a dit, une approche concrète, particulière, singulière des événements : c'est sa « richesse » qui a été maintes fois soulignée et qui explique une grande part de la fascination qu'elle exerce (notamment par rapport au récit oral ou écrit). On voit les choses telles qu'elles se sont passées, concrètement, dans leur déroulement exact, même si ces images peuvent être reconstituées (comme dans un film de fiction), mensongères peut-être (mais les livres mentent aussi), insérées dans un montage qui leur donne un autre sens, souvent trop brèves et peu « lisibles » lorsqu'il s'agit d'images prises sur le « vif ». Aussi illusoire soit cette impression, nous pouvons avoir l'impression de revivre les événements tels qu'ils ont été vécus par les protagonistes eux-mêmes ou par certains d'entre eux : voir brutalement un homme mourir devant la caméra produit une tout autre impression que de savoir abstraitement qu'une bataille a fait des milliers de victimes.
Mais il y a sans doute une autre dimension du cinéma, tout aussi essentielle, mais sans doute moins souvent signalée, qui apparaît notamment à travers l'utilisation privilégiée dans les documentaires à vocation historique[73] des témoignages de personnes ayant vécu les événements évoqués : on sait que la mémoire est faillible, et les historiens insistent à juste titre sur la nécessité de vérifier par d'autres sources les informations ainsi recueillies ; mais si la mémoire est un filtre et parfois un filtre déformant, elle a aussi sa propre vérité, elle est vérité subjective. Or la vérité subjective n'est pas factuelle, elle est d'abord et avant tout émotionnelle : il ne s'agit pas nécessairement d'émotions larmoyantes (même si l'évocation du passé favorise sans doute toutes les formes de mélancolie et de nostalgie), et de nombreux témoignages se signalent au contraire par leur retenue, par leur dignité, par leur distance, par leur humour ou leur ironie parfois. Mais ce dont rend compte le témoin, ce n'est pas seulement de l'événement, c'est surtout de l'impact subjectif qu'il a eu sur son existence : l'émotion est peut-être celle du présent de la mémoire, elle n'a sans doute pas été vécue de cette manière-là, elle a souvent été privée de mots dans le présent de l'action, mais elle est le plus souvent au c¦ur du témoignage documentaire.
Et si l'on considère le cinéma de fiction avec ses reconstitutions plus ou moins spectaculaires, l'on voit bien qu'au-delà des événements, c'est à une forme de partage des émotions que le spectateur est convié. Bien entendu, l'émotion peut être mensongère - le cinéma est aussi de propagande -, mais elle est aussi authentique et mérite de rester dans nos mémoires.
Une carte de la population d'esclaves aux États-Unis en 1860
(Source: Wikipedia. Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Cette carte, présente sur la version allemande du site Wikipedia (en décembre 2013) et qui mélange comme on le voit des indications en allemand et anglais, ne cite malheureusement pas ses sources. Elle permet néanmoins de mesurer l'importance numérique de l'esclavage tout en éclairant son importance économique pour les États du Sud où les esclaves représentaient souvent plus de 50% de la population totale.

12 Years A Slave de Steve McQueen (2013)
Cinéma et géographie historique : deux manières de faire et de présenter l'histoire.
Le film de Steve McQueen, basé sur sur le récit véridique de Solomon Northup (1853), privilégie l'histoire individuelle d'un Noir libre du nord des États-Unis capturé et emmené des force dans un État esclavagiste du sud où il sera réduit en servitude pendant douze ans : il montre et fait ainsi partager aux spectateurs la violence et l'injustice subies par les esclaves noirs.
La carte montre quant à elle l'ampleur de l'esclavage dans les différents États du sud.
Ces deux manières de faire l'Histoire sont sans doute différentes, mais l'on ne peut pas décréter a priori que l'une serait plus «vraie» ou plus « authentique » que l'autre.
L'esprit humain, on l'a dit, tend à privilégier un exemple-type au lieu d'analyser la diversité d'une classe ou d'une collection. Nous n'échappons sans doute pas à ce travers dans cette étude sur le film historique. L'on a essayé cependant de multiplier et de diversifier les exemples dont on trouvera la liste ci-dessous. Ce choix s'est basé notamment sur un accès facile à ces films.
1 Citons entre autres l'ouvrage désormais classique de Marc Ferro, Cinéma et histoire, Paris, Gallimard, celui didactique d'Antoine de Baecque, Histoire et cinéma. Paris, Cahiers du Cinéma, 2008, ou de Jean-Loup Bourget, L'Histoire au cinéma. Le passé retrouvé. Paris, Gallimard, 1992, ou encore celui de Christian Delage et Vincent Guigeno, L'historien et le film, Paris, Gallimard, 2004. Beaucoup de ces études portent cependant sur des périodes plus précises comme l'ouvrage de Patrick Brion, Le cinéma et la guerre de 14-18, Paris, Riveneuve, 2013, ou Jacques Walter, La Shoah à l'épreuve de l'image, Paris, Presses Universitaires de France, 2005, ou encore Vincent Lowy, L'Histoire infilmable : les camps d'extermination nazis à l'écran, Paris, L'Harmattan, 2001.
2 De telles enquêtes sur le public de cinéma existent bien sûr mais ne s'inscrivent pas dans la perspective développée ici (voir par exemple Emmanuel Ethis, Sociologie du cinéma et de ses publics. Paris, Armand Colin, 2009).
3 On peut poser la question d'une autre manière et se demander comment les responsables d'un site web sur le cinéma (par exemple www.allocine.fr, www.wikipedia.org...) ou d'un festival du film historique (www.cinema-histoire-pessac.com/) classent certains films comme historiques. Quels sont les critères généralement implicites qu'ils utilisent pour opérer une telle catégorisation ? Et dans quelle mesure, ces critères sont-ils plus ou moins largement partagés par les spectateurs de cinéma ? (Allocine utilise explicitement la catégorie « historique » pour classer certains films)
4 Françoise Cordier, Les Représentations cognitives privilégiées : typicalité et niveau de base. Lille, Presses Universitaires de Lille, 1993.
5 Le coup d'État suivi de la dictature des Colonels n'interviendra qu'en 1967, trois ans après la mort du député Grigoris Lambrakis, mais, pour tous les spectateurs du film, ce meurtre n'était qu'une première étape dans un processus plus large de radicalisation et de violence politiques des forces d'extrême-droite conduisant rapidement à la dictature.
6 Le film se réfère au massacre de Sand Creek dans le Colorado : en novembre 1864, une colonne de l'armée américaine attaqua un village cheyenne et arapaho pacifique dont le chef Black Kettle avait peu auparavant négocié un traité de paix, et les soldats massacrèrent environ 150 personnes (les chiffres exacts ne sont pas fixés et oscillent entre 69, 129, 200, 300 et même 450), dont beaucoup de femmes et d'enfants. Beaucoup de cadavres furent en outre mutilés, et des morceaux emportés comme trophées.
7 Finkenauer, C., Luminet, O., Gisle, L., van der Linden, M., El-Ahmadi, A., & Philippot, P., « Flashbulb memories and the underlying mechanisms of their formation: Towards an Emotional-Integrative Model ». Memory and Cognition, 26, 1998, p. 516-531.
8 Notre perspective est, on le voit, différente de celle des milieux historiques qui opposent grosso modo l'histoire, entendue comme reconstitution aussi objective que possible faite par des spécialistes, et mémoire des témoins encore vivants, marquée par une nécessaire subjectivité, même si les historiens actuels prennent également en compte cette mémoire biaisée et fragmentaire (cfr. par exemple Henry Rousso, Le syndrome de Vichy, de 1944 à nos jours. Paris, Seuil, 1987, p.10-11 et Tzvetan Todorov, 1995, « La mémoire devant l'histoire », Terrain, n° 25, pp. 101-112). Ici, l'on s'attache plutôt à la manière dont les individus catégorisent certains faits comme historiques, comme appartenant définitivement au passé, et d'autres comme « vivants », (relativement) actuels parce que précisément ils ont gardé la mémoire de les avoir vécus au présent.
9 On peut penser que la désaffection à l'égard du western est due ? plus d'ailleurs dans le chef des cinéastes eux-mêmes que des spectateurs ? en partie à la distance historique qui fait que les événements de cette époque appartiennent à partir des années 1960 environ à un passé définitivement révolu, sinon même mythique et mythifié. Ainsi, John Ford a raconté à Peter Bogdanovich avoir rencontré personnellement dans sa jeunesse Wyatt Earp, le principal protagoniste de la Poursuite infernale (My Darling Clementine, 1946) : on peut supposer que la prédilection du cinéaste américain pour le western (dont il a réalisé de nombreux chefs-d'¦uvre) s'explique au moins en partie par le fait qu'il s'agissait pour lui d'événements proches, portés par une mémoire encore vivante, celle en particulier des « pionniers » dont il a toujours privilégié le point de vue. En revanche, les réalisateurs qui ont ultérieurement abordé les mêmes événements (par exemple Lawrence Kasdan, avec Wyatt Earp en1994, ou George Pan Cosmatos avec Tombstone en 1993, ou encore les auteurs de la série télévisuelle Deadwood, 2004-2006) ont plutôt fait, et un peu paradoxalement, ¦uvre d'« historiens » (même si leur version de l'histoire peut également être très partiale)... Quant aux spectateurs, notamment européens, beaucoup imaginent sans doute que ces événements sont purement fictionnels et ne relèvent même pas de l'histoire.
10 De façon dialectique, les films historiques jouent tout autant sur le savoir des spectateurs qui ont entendu parler de Cléopâtre et de son nez, que de leur manque de connaissance qui est sans doute indispensable pour maintenir leur intérêt au cours de la projection : les spectateurs trop bien informés risquent de s'ennuyer ou plus sûrement de critiquer une représentation dont ils verront plus facilement les erreurs ou les approximations. Les films historiques ne s'adressent pas aux professeurs d'histoire...
11 On sait que l'école des Annales (revue fondée en 1929) puis la Nouvelle Histoire (qui s'est développée dès les années 1960) ont mis en avant les phénomènes collectifs, la longue durée, la masse des individus anonymes, les fluctuations lentes, mais peu de films semblent se référer à ce type d'approche même si l'on peut penser que le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne par exemple (1982), qui évoque un fait divers survenu au XVIe siècle, met un accent inédit sur les mentalités, les phénomènes de groupe et de croyances collectives, l'état des m¦urs de l'époque dans une perspective plus ou moins inspirée de cette Nouvelle Histoire.
12 Si l'on considère que tout événement passé fait en principe partie de l'Histoire, on voit que le Savoir historique, quant à lui, sélectionne les événements qu'il juge dignes d'intérêt et qu'il n'en retient en fait qu'une toute petite partie (en fonction de multiples critères qu'il n'est pas possible d'expliciter ici). Même si ces critères évoluent au cours du temps (parfois en fonction de simples modes à l'¦uvre dans le champ universitaire), le Savoir historique s'intéresse certainement plus aux événements politiques qu'aux faits divers, privilégie l'histoire globale plutôt que les événements locaux, et préfère retracer la biographie d'hommes de pouvoir plutôt que de « stars » ou de champions sportifs, aussi célèbres fussent-ils de leur temps, ravalés ensuite à la « petite histoire ».
13 Notamment par le critique du Monde.
14 Cet exemple peut bien sûr être discuté dans la mesure où le Savoir historique intègre constamment de nouveaux objets et qu'il est rare qu'il en rejette certains de son champ d'investigation (cela est néanmoins arrivé par exemple avec l'histoire des miracles religieux ou des monstres fabuleux). La hiérarchie des objets historiques (les uns étant plus dignes que d'autres d'investigation) est néanmoins très différente de celle régnant dans l'espace public actuel (telle qu'on peut le percevoir à travers les grands médias par exemple) : les gloires sportives ou télévisuelles, les faits divers plus ou moins sensationnels, les célébrités de la presse people ont peu de chances de devenir de grands sujets d'analyse historique (ou alors dans une tout autre perspective que celle dans laquelle ils sont à présent considérés).
15 L'ouvrage présenté par Michel Foucault est en fait accompagné de sept notes rédigées par différents historiens (dont Foucault lui-même) qui proposent des interprétations relativement différentes de ce fait divers mais qui consistent toutes à dépasser le cadre du crime sensationnel pour en faire le révélateur d'un sens plus général. Le film de René Allio suivant fidèlement les documents historiques relatant le crime est en revanche dépourvu de cet apparat critique essentiel pourtant pour transformer le fait divers en objet d'un savoir savant (sinon très savant...). La plupart des spectateurs ont sans doute vu le film d'abord et avant tout comme « une peinture des m¦urs paysannes » de l'époque, ce que René Allio (qui voulait certainement se situer dans la perspective de Foucault) disait pourtant refuser dans sa propre note d'intention sur son scénario...
16 Le cas le plus célèbre est cependant celui d'un personnage de roman, Manon Lescaut héroïne malheureuse du célèbre ouvrage de l'abbé Prévost Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut (1731)...
17 Les décors du film semblent être d'époque (ou en tout cas reconstitués) mais il faut sans doute être spécialiste pour juger des éventuelles libertés prises avec la vérité historique en ce domaine.
18 Comme ces connaissances doivent nécessairement faire l'objet d'un apprentissage plus ou moins long, la notion de film historique ne peut elle-même s'acquérir que progressivement : les jeunes enfants ne peuvent pas faire la distinction dans un film comme le Bossu de Philippe de Broca entre les références historiques et les éléments proprement fictionnels. Aucun indice proprement filmique ne permet en effet d'opérer une telle distinction qui nécessite une information extérieure, très variable selon les individus.
19 Il est également difficile de considérer le film de Roberto Benigni, La Vita è bella (1997) comme un film historique, tant l'univers concentrationnaire y est montré de façon édulcorée : on parlera plutôt d'un conte ou d'un film pour enfants.
20 L'approche proposée ici est à l'opposé d'une démarche de type « philosophique » qui cherche à « clarifier » les concepts en posant la question de l'essence des choses (« Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que la langue ? Qu'est-ce que le cinéma ? Qu'est-ce que l'Histoire ?... »). Il s'agit au contraire de comprendre comment fonctionnent les catégories du langage ordinaire avec leur caractère imprécis, approximatif, flou, indéterminé... mais suffisamment souple pour fonder l'intercompréhension (une telle approche est sans doute apparentée à celle du « second » Wittgenstein (Recherches philosophiques. Paris, Gallimard, 2005, éd. or. : 1953).
21 Pour rappel, le « biopic » (pour biographical motion picture), parfois appelé biographie filmée en français, est un film de fiction retraçant la vie d'une personne célèbre (et très généralement décédée). Si certaines de ces réalisations appartiennent sans doute au genre historique comme la Dame de fer de Phyllida Lloyd (2011), d'autres comme Diana d'Oliver Hirschbiegel (2013) seront plus difficilement considérés comme des films historiques (la princesse Diana appartenant sans doute plus au monde des people qu'au domaine de l'Histoire). Semblablement, le Nixon d'Oliver Stone (1995) peut être défini à la fois comme un film historique et un biopic, alors que The Doors du même Oliver Stone (1991) sera seulement vu comme un biopic, parce que la carrière des groupes musicaux populaires et de leurs idoles ne semblent pas relever de l'histoire canonique.
22 La critique vire facilement à l'hyper-critique qui est parfois aussi inexacte que le film dénoncé : ainsi, on a pu reprocher au film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, de ne pas montrer de soldats noirs lors du débarquement (signe du supposé racisme du réalisateur) ; or en 1944, l'armée américaine était soumise à une ségrégation raciale stricte, les officiers supérieurs américains estimant en outre que les soldats noirs étaient de moindre valeur et peu aptes au combat, et aucun soldat afro-américain n'était donc présent sur les plages de Normandie le 6 juin. De la même manière, il est absurde de reprocher à Spielberg de ne montrer que des soldats américains dans le même film alors que les troupes britanniques et canadiennes ont débarqué sur d'autres plages distantes de plusieurs kilomètres d'Omaha Beach. (Plusieurs films ont par ailleurs abordé la situation des soldats noirs dans l'armée américaine sous le règne de la ségrégation raciale notamment The Tuskegee Airmen de Robert Markowitz (1995, avec Laurence Fishburne) consacré à un escadron d'aviateurs afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale.)
23 On signalera que les images d'archives de la Seconde Guerre mondiale (et a fortiori celles de la Première Guerre mondiale) sont dans leur très grande majorité sans bande sonore : les bruitages (explosions, moteurs, sirènes, bruits de foule...) sont rajoutés par les documentaristes qui puisent dans des « banques sonores » sans rapport avec les images en cause. Le procédé est donc aussi artificiel que la colorisation mais est très rarement critiqué. (Pour une approche des sons de la Première Guerre mondiale à travers notamment la littérature, on peut se reporter à Édouard Launet, « 14-18, la guerre fait grands bruits », dans Libération, 9/4/2014, p. 28-29.)
24 Vincent Artuso, « Les dangereuses approximations d'"Apocalypse", docu de France 2 », Rue89, 17/9/2009 ( onsulté le 4/4/2014).
25 La formule est en réalité d'Alfred Korzybski (1879-1950), fondateur d'une discipline appelée la sémantique générale.
26 Voir entre autres Bérénice Reynaud, « Mississippi Burning : fièvre à New York », Les Cahiers du Cinéma, mars 1989.
27 Pour une synthèse des différentes critiques adressées au film de Spielberg, on peut se reporter à Walter Jacques, « La liste de Schindler au miroir de la presse » dans Mots, septembre 1998, n°56. La Shoah : silence...et voix. p. 69-89 (consulté le 06 avril 2014).
28 Même falsifié, un document historique a une valeur de témoignage, ne serait-ce que de la manipulation dont il a été l'objet, pour autant que cette manipulation soit perçue par l'historien. (On se souvient bien sûr des photos de la Révolution russe où les figures de Trotski et d'autres responsables bolcheviques ont été effacées par la censure stalinienne.)
29 Les théoriciens de l'image photographique disent que l'image photographique est une « empreinte » : en effet, à la différence de l'image picturale, elle résulte d'un processus physique de sensibilisation d'un support chimique par la lumière, et ce processus purement matériel s'effectue en dehors de toute intervention humaine et donc de toute instance codique ou idéologique, même si la mise en ¦uvre du processus reste elle entièrement soumise à l'individu et aux instances de toutes sortes qui constituent celui-ci. Pour de plus amples développements, l'on se reportera aux ouvrages de Philippe Dubois, L'acte photographique. Bruxelles, Labor, 1983 et de Jean-Marie Schaeffer, L'image précaire. Paris, Seuil, 1987.
30 On peut dire que l'appareil photo ou la caméra transforment la réalité en une image ? en deux dimensions, en noir et blanc, avec une balance des couleurs nécessairement différente... ? mais cette transformation ne peut pas se réduire à une simple interprétation : l'image garde une trace du réel (qui a impressionné la pellicule ou les capteurs photosensibles), trace distincte du sens que peut avoir ce réel pour le photographe ou le spectateur (comme c'est le cas d'ailleurs pour une ruine archéologique). Si la contre-plongée magnifie le dictateur (ou le ridiculise sous la caméra de Chaplin...), elle nous montre aussi à quoi ressemblaient exactement son visage et sa moustache...
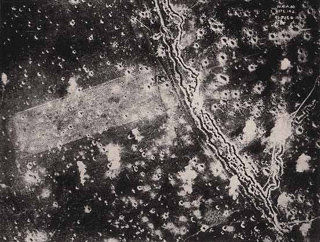
Photographie aérienne pendant la Première Guerre mondiale
31 Comme pour le point précédent, il faut distinguer ici entre la subjectivité du cinéaste (ou du cameraman) et le point de vue de la caméra. Le choix de ce point de vue peut révéler une certaine subjectivité (comme dans l'exemple classique du dictateur filmé en contre-plongée pour le magnifier), mais, de manière générale, le point de vue en lui-même désigne d'abord et avant tout une position objective, celle de la caméra (qui peut d'ailleurs fonctionner sans aucune intervention humaine comme une caméra de surveillance). Une photographie aérienne est prise d'avion (ou d'un satellite ou d'un ballon...), mais elle ne nous révèle rien de la subjectivité de celui qui l'a prise ou de celui qui a simplement installé la caméra dans cet avion. C'est un contexte beaucoup plus large qui nous permettra éventuellement d'interpréter la subjectivité de l'opérateur qui a manipulé cette caméra.
32 Personne n'a jamais nié que deux avions se sont bien encastrés dans les tours jumelles du World Trade Center en septembre 2001, sans aucun doute parce que les images filmées paraissaient incontestables : en revanche, l'absence de telles images lors de l'attaque du Pentagone par un autre avion détourné a très rapidement permis aux théories du complot de se développer et de nier l'existence même d'une attaque par avion (ces « théories » ont ensuite mis en cause les causes supposées de l'effondrement des tours, c'est-à-dire l'interprétation des faits, mais non les faits eux-mêmes, trop évidemment visibles).
33 On parlera de façon générale d'image photographique sans faire de distinction avec l'image animée, cinématographique ou télévisuelle.
34 On vient de dire que la caméra transforme la réalité en image mais ne l'interprète pas. Mais le spectateur lui va devoir interpréter cette image en fonction notamment du savoir historique dont il dispose : ce qu'il voit en deux dimensions, il va par exemple le transformer imaginairement en espace en trois dimensions. Il faut donc bien distinguer entre l'image comme trace objective, le regard que le spectateur porte sur cette image et qui implique une interprétation et le point de vue subjectif de l'auteur des images qui n'est plus appréhendable directement et doit être reconstruit. On remarquera à ce propos que le photographe ou le cinéaste peut par exemple avoir filmé des choses qu'il n'a pas vues ou qui pour lui étaient d'un intérêt secondaire : comme l'image est trace, l'on peut donc y découvrir des éléments dont l'auteur de l'image n'avait pas nécessairement conscience.
35 La chaîne télévisuelle d'information Euronews s'est fait une spécialité de diffuser pendant quelques minutes de courtes séquences sous l'étiquette « No comment ». Ces images sont pourtant toujours accompagnées d'un texte qui précise le lieu et la date du tournage. En outre, elles sont le plus souvent reprises (parfois de façon abrégée) dans le journal qui suit et qui en précise les circonstances et le sens.
36 Lors de la Première Guerre mondiale, « de nombreux films documentaires tentent d'illustrer le combat des "poilus" ? le film de guerre, malaisé encore aujourd'hui, l'étant évidemment bien davantage encore à l'époque en raison des contraintes techniques : les caméras sont encombrantes, dotées d'un trépied, et l'opérateur doit être capable de maîtriser ses émotions, car il lui revient de tourner régulièrement la manivelle qui alimente l'appareil en pellicule. Autant dire que la quasi-totalité des scènes prétendument de guerre sont en fait des reconstitutions. Filmées avec de vrais soldats, parfois sur des lieux de combats ou le plus souvent encore sur des terrains d'entraînement, elles sont la pour "rendre l'ambiance" en évacuant le vrai danger » (François Cochet, Préface à Patrick Brion, Le cinéma et la guerre de 14-18. Paris, Riveneuve éditions, 2013).

Verdun, visions d'histoire de Léon Poirier
37 Une photo de soldats français en plein assaut des lignes ennemies est souvent reprise comme illustration de la bataille de Verdun alors qu'il s'agit en fait d'une image tirée d'un film de Léon Poirier, Verdun, visions d'histoire, tourné sur les lieux mêmes de la bataille en 1928.
38 La multiplication récente des caméras portatives (placées notamment sur les casques des soldats) a permis à de nombreux militaires (surtout occidentaux) de publier sur le web des vidéos de scènes de combat prises sur le vif. Aussi impressionnantes que soient ces images, on remarque qu'elles sont extrêmement chahutées et qu'elles ne donnent ainsi qu'une vision très fragmentaire d'une situation qui est perçue de façon beaucoup plus globale et intuitive par les protagonistes. Et bien entendu, ces images ne nous disent rien sur les adversaires qui restent pratiquement invisibles ni sur les civils pris malgré eux dans ces combats...
39 On n'en donnera qu'un seul exemple, celui des victimes de catastrophes humanitaires ou de violences extrêmes ou injustifiées comme les prisonniers à la libération des camps de concentration nazis : de telles images suscitent certainement l'horreur et soulèvent notre indignation, mais un peu de réflexion suffit à faire comprendre que ces survivants ont pu quant à eux éprouver une gêne importante sinon même une forme de honte à être filmés dans un tel état de délabrement physique, même s'ils n'en étaient absolument pas responsables (de la même manière sans doute que nous n'aimerions pas être filmés nus, malades et affaiblis sur un lit d'hôpital).
40 Bien entendu, un documentaire est tout aussi orienté qu'un film de fiction, mais, à moins d'une manipulation, les images d'archives (utilisées dans un documentaire) ont, comme on l'a dit, une valeur de document, une valeur d'empreinte, que n'ont pas des images de fiction. Sans doute, un film de fiction, si toute autre image documentaire était détruite (comme l'ont été la plupart des photos de Robert Capa prises à Omaha Beach à cause d'une erreur du labo de développement), pourrait devenir un document historique comme l'est L'Iliade d'Homère sur la guerre de Troie ; mais l'on sait aussi avec quelle prudence les historiens interprètent un tel document. Si, dans un futur lointain, les historiens n'avaient plus que Le Jour le plus long comme document sur le débarquement en Normandie, ils ne pourraient pas s'apercevoir que les coiffures des quelques jeunes femmes qui apparaissent à l'écran dans ce film d'hommes ne reflètent absolument pas le style des années 40 mais bien celui du début des années 60, moment du tournage du film (même si ce détail capillaire peut sembler très secondaire aux yeux de l'historien...).
41 L'interprétation de Gérard Corbiau est sans doute relativement proche de celle d'un Jean-Marie Apostolidès, Le roi-machine, Spectacle et politique au temps de Louis XIV (Paris, Minuit, 1981), alors qu'on devine l'influence des lectures marxistes (ou marxiennes) visant à désacraliser le pouvoir chez Rossellini.
42 Fernand Braudel, Ernest Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, Tome II, Presses Universitaires de France, 1970.
43 Tout le monde connaît aujourd'hui la date du 14 juillet 1789, non pas tellement parce que c'est le jour de la prise de la Bastille mais surtout parce qu'elle marque le début de la Révolution française : si celle-ci avait été étouffée dans l'¦uf par une réaction brutale de la monarchie, cette date serait évidemment beaucoup moins significative. On sait que Louis XVI a écrit dans son journal un « Rien » à côté de la date du 14 juillet, même s'il n'y notait habituellement que ses prises de chasse et ses participations à des cérémonies officielles. Ce sont les historiens qui, en définitive, fixent l'importance des dates, plus que les contemporains eux-mêmes.
44 On comprend comment dans ce cas l'image et le son se renforcent mutuellement : une voix off énonce les propos d'un personnage historique dont on voit le texte imprimé à l'écran. L'image ? même si le spectateur n'a pas réellement le temps de lire le texte visible ? est supposée attester de la véracité des propos entendus.
45 Voir par exemple l'article du Washington Post, « Hispanics still Unhappy With Burns Film », 12 avril 2007.
46 Beaucoup de civils apparaissent dans le film mais ils témoignent tous de l'impact que la guerre a eu sur leur vie personnelle. Bien entendu, de nombreux moments de leur vie durant cette période n'ont pas été marqués (du moins directement) par la guerre mais ils n'avaient alors que peu d'intérêt pour le documentaire.
47 « La comptabilité des pertes reste très incertaine, quelquefois globalement, souvent dans le détail. Pour prendre ce seul exemple, d'année en année, à la suite de nouveaux travaux, le nombre des morts de la bataille de Verdun, tant du côté français que du côté allemand, ne cesse de fluctuer. Grâce au travail entrepris pour la France, aussitôt après la fin de la guerre, par le député de Nancy, Louis Marin, et grâce au recueil établi tout au long de la guerre pour l'Allemagne et intitulé L'état sanitaire de l'armée allemande, on connaît, malgré tout, assez bien pour ces deux pays, le bilan et le détail des pertes de guerres. Cette connaissance est déjà beaucoup plus floue pour l'armée britannique en raison des habitudes d'une historiographie qui ne fait pas la différence entre morts et blessés qu'elle regroupe sous le terme unique de "casualties", se moulant en quelque sorte sur l'attitude des chefs militaires à qui ce qu'il importe de savoir est de combien d'hommes il dispose, mais ce n'est pas le point de vue de l'histoire. L'incertitude est encore plus grande pour les États alors dépourvus de moyens statistiques et surtout pour ceux dont les frontières ont changé après la guerre ou qui sont nés alors. Ainsi pour les États balkaniques, les chiffres d'un auteur à un autre restent extrêmement variables. » (Jean-Jacques Becker, « L'évolution de l'historiographie de la Première Guerre mondiale », Revue historique des armées, 242, 2006, p. 4-15).
48 Une forme de rigorisme moral condamne facilement ce type de musique (mais aussi toute manipulation d'images) et privilégie une attitude distanciée (sinon distante) par rapports aux événements rapportés. Il s'agit cependant là d'une attitude morale, caractérisée par le rejet du pathos et qui est sans aucun doute respectable, mais qui ne doit pas être confondue avec la question de la vérité : un documentaire peut être pathétique et larmoyant, et l'on peut juger cela détestable et de mauvais goût, mais cela ne signifie pas qu'il soit faux ou inexact. Tout au plus peut-on lui reprocher de privilégier les sentiments actuels (ceux de l'auteur comme des spectateurs) plutôt que ceux effectivement éprouvés par les individus historiques, vraisemblablement plus ambivalents et contrastés (Paul Fussell, ancien combattant américain de la Seconde Guerre mondiale, remarque que le simple fantassin souffrait avant tout du « mépris et des ravages infligés à sa personnalité [par la hiérarchie militaire], de l'absurdité, de l'ennui et de la chickensit [la « merde de poulet » symbolisant tous les côtés mesquins et vexatoires de la discipline militaire] », des sentiments peu présents dans le documentaire de Ken Burns et Lynn Novick. (Paul Fussell, À la guerre. Psychologie et comportements pendant la seconde Guerre mondiale. Paris, Seuil, 1992, p. 135).) On remarquera encore que, si l'histoire scientifique privilégie généralement la neutralité axiologique et la froideur objective, il est néanmoins facile de repérer dans la majorité des ouvrages historiques des procédés rhétoriques qui visent à provoquer différentes formes d'émotion et d'empathie (ou d'antipathie) chez le lecteur. (Citons un seul exemple dans l'ouvrage de Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d'Europe (volume II, Paris, Gallimard, 1991, p. 871), dont la dernière phrase est empreinte d'une ironie froide qui traduit néanmoins clairement l'indignation de l'auteur : « Jamais une machine administrative n'avait eu à supporter le poids d'une tâche aussi impitoyable. En un sens, la destruction des Juifs soumettait la bureaucratie allemande à une ultime épreuve. Les technocrates allemands résolurent aussi ce problème, et réussirent aussi cet examen. »)
49 C'est le cas par exemple d'Iwo Jima d'Allan Dwan (Sands of Iwo Jima,1949) qui mélange des scènes de fiction tournées en 35mm (en haute définition) et des films d'archives en 16mm (en basse définition).


(Cliquez sur les images pour obtenir une version agrandie.)
Sur la première image tournée en 35mm, la définition (le rendu des détails) est meilleure ainsi que le contraste. La seconde en 16mm est granuleuse et peu contrastée : ellle est extraite d'un film tourné par le Signal Corps de l'armée américaine pendant la guerre du Pacifique. Le film mélange donc images authentiques et images reconstituées sinon complètement fictives.
50 Cette compétence est évidemment très variable selon les individus et suppose un processus d'apprentissage plus ou moins long. Pour un enfant, les exploits d'un cascadeur ou des trucages numériques peuvent sembler réalistes tout simplement parce qu'il ne connaît pas ou seulement approximativement les limites du corps humain.
51 Différentes formes de cuirasses ont effectivement été utilisées de façon apparemment très limitée (à cause de leur poids) par les belligérants lors de Première Guerre mondiale, mais le casque d'allure médiévale montré dans le film de Rosi ne semble pas attesté. Pour rappel, les Hommes contre est basé sur l'ouvrage Un Anno Sull'Altipiano (1938) d'Emilio Lusso qui y témoignait de son expérience de combattant sur le front italien.
52 Jean Bottéro, Mésopotamie, L'écriture, la raison et les dieux. Paris, Gallimard (Folio histoire), 1987, p. 124. Les dates sont bien sûr avant Jésus-Christ.
53 L'établissement d'un fait comporte nécessairement une part d'interprétation : ainsi, comme on l'a vu du nombre de morts causés par la Première Guerre mondiale. Tout fait historique peut donc être contesté, réinterprété, réévalué, et il ne faut pas opposer de manière absolue faits et interprétations. Mais on constate qu'au moment présent de la recherche historique, les historiens doivent nécessairement s'accorder sur un certain nombre de faits ? qu'il s'agisse de documents existants ou d'événements passés ? pour élaborer de nouvelles connaissances, forger de nouvelles interprétations et éventuellement polémiquer entre eux : personne ne conteste aujourd'hui que l'Allemagne a envahi la Belgique le 4 août 1914, même s'il y a discussion sur, par exemple, les raisons de cette invasion. En outre, les faits ainsi établis se caractérisent généralement par leur dimension objective dont attestent en particulier des documents directs que tous les historiens comprennent de la même manière : des actes officiels permettent ainsi de dater de façon certaine la naissance de personnages célèbres, même si une possibilité de falsification peut toujours être envisagée. En revanche, dans le domaine historique (comme dans celui des sciences humaines en général), l'interprétation va porter notamment sur les relations entre les événements, sur des généralisations à partir de faits limités, ainsi que sur la signification subjective qui a éventuellement accompagné ces événements, autant d'éléments qui ne peuvent donc être reconstruits que de façon indirecte et hypothétique. Bien entendu, le travail historique ne se limite pas à de telles interprétations, et l'établissement des faits constitue une part essentielle de ce travail.
54 Comme illustration de ces points de vue opposés présentés ici de façon sommaire sinon caricaturale, on peut se reporter à Frédéric Rousseau, La Guerre censurée. Une histoire des combattants européens de 14-18. Paris, Seuil, 1999 et à Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker, 14-18. Retrouver la Guerre. Paris, Gallimard, 2000. À l'heure actuelle (2013), le débat reste vif entre historiens (Élise Julien, « À propos de l'historiographie française de la première guerre mondiale », Labyrinthe [En ligne], 18 | 2004 (2), mis en ligne le 07 février 2005, consulté le 26 avril 2014.).
55 Comme pour l'ensemble des sciences humaines, la prétention à la vérité historique est facilement mise à mal par une accusation de partialité, cette prétention à l'objectivité étant dénoncée comme le masque d'intérêts partisans. Mais cette critique, lorsqu'elle se veut radicale, débouche sur une forme extrême de relativisme qui est facilement séduisante d'un point de vue philosophique ? « il n'y a pas de vérité, seulement des points de vue subjectifs » ? mais qui n'est guère tenable dans la réalité pratique du travail historique : celui-ci suppose notamment la croyance au passé comme réalité (et non comme pure illusion) ainsi que la possibilité de communiquer à autrui les vérités éventuellement découvertes. Le champ des études historiques reste ainsi fondé sur le partage de procédures communes de recherche de documents, d'administration des preuves et d'exposition des résultats.
56 L'on constate cependant que ce type de critiques a pu déboucher sur la création de départements universitaires spécifiques, comme les études féministes ou coloniales dont sont exclus les chercheurs supposés ne pas partager les valeurs féministes ou anti-colonialistes de leurs promoteurs. (Pour une mise au point récente sur le renouveau imposé aux historiens par les études coloniales, l'on peut se reporter à Frédérick Cooper, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire. Paris, Payot, 2010 [éd. or. américaine : 2005].)
57 Walter Jacques. « La liste de Schindler au miroir de la presse ». In: Mots, septembre 1998, N°56. pp. 69-89.
58 L'on se situe ici dans la perspective de spectateurs qui ne sont pas historiens et qui n'ont donc pas accès aux sources primaires, c'est-à-dire aux documents divers sur lesquels s'appuient les historiens pour construire leur savoir. Par sources secondaires, l'on entend donc les ouvrages écrits par des historiens, professionnels mais aussi amateurs, ainsi que des réalisations audiovisuelles (films, documentaires, sites Internet... ) qui abordent des sujets historiques.
59 Voir par exemple Ian Kershaw. L'opinion allemande sous le nazisme. Bavière, 1933-1945. Paris, Éditions du CNRS, 2010.
60 Voir par exemple Studs Terkel, « La bonne guerre »: Histoires orales de la Seconde Guerre Mondiale. Paris, Éditions Amsterdam, 2006, p. 103-113.
61 Pour rappel, la majorité des Américains était isolationniste avant l'attaque contre Pearl Harbor alors que le président Roosevelt envisageait depuis plusieurs mois l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne nazie, soutenant indirectement l'effort de guerre britannique (loi du prêt-bail de mars 1941). Après l'attaque japonaise, il a par ailleurs dû équilibrer l'effort de guerre américain, de nombreux responsables militaires voulant privilégier le théâtre d'opérations du Pacifique au détriment de la guerre en Europe.
62 Pour donner un autre exemple, le film de Francesco Rosi, Les Hommes contre, traduit un message pacifiste très proche de celui de Kubrick dans Les Sentiers de la gloire. Mais, dans le cas de Rosi, il y a également la prise en compte du contexte national italien et notamment de l'après-guerre qui a vu la montée puis la prise de pouvoir du fascisme alimenté notamment par la frustration des anciens combattants : pour le cinéaste, la guerre dans son principe même était mauvaise, et « il privilégie le point de vue du révolutionnaire partisan du défaitisme ». Or si on lit l'ouvrage dont il s'inspire, Un Anno Sull'Altipiano d'Emilio Lussu (1938), un écrivain antifasciste mais qui avait milité dès 1914 pour l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés avant d'être engagé lui-même comme officier de réserve dans l'armée, on constate que le roman est plus ambivalent, dénonçant effectivement la manière dont la guerre a été menée par les autorités militaires mais ne remettant pas en cause les motifs de cette guerre. Cette différence de points de vue s'explique notamment par une différence de générations, la Première Guerre mondiale devenant pour les générations ultérieures l'exemple même du conflit absurde et inutilement sanglant. (Sur les transformations que Francesco Rosi a fait subir au témoignage de Lussu, on peut se reporter à Anne Boulé, « La Première Guerre mondiale dans la littérature et le cinéma italiens : Un Anno Sull'Altipiano. Du texte à l'image » dans Chroniques italiennes, Presses Sorbonne nouvelle, 1996, n° 46.)
63 On se reportera à l'ouvrage (non traduit) de John W. Dower, War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War. New York, Pantheon Books, 1986. Du côté américain, les Japonais étaient assimilés à des singes ou de la vermine, tandis que les Japonais décrivaient leurs ennemis comme des monstres, des diables ou des démons.
64 L'historien Pierre Vidal-Naquet a déclaré que : « La seule grande ¦uvre historique française sur le massacre, ¦uvre assurée de durer et, comme on dit, de rester, n'est pas un livre, mais un film, Shoah, de Claude Lanzmann. » (Cette citation n'est malheureusement pas référencée par le journal Le Monde )
65 On peut notamment se reporter au dossier pédagogique réalisé par Les Grignoux et consacré à ce film.
66 L'expression est reprise de l'ouvrage de Michel de Certeau, L'écriture de l'histoire. Paris, Gallimard, 1975. Cet ouvrage, aussi intéressant soit-il, décrit surtout la manière de faire de son auteur, et il faut bien reconnaître que l'épistémologie de l'histoire est elle-même soumise à l'histoire et varie grandement selon les points de vue : on peut citer à titres d'exemples deux ouvrages éloignés dans le temps comme Léon-E. Halkin, Initiation à la critique historique. Paris, Armand Colin, 1951, et Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire. Paris, Seuil, 1971.
67 Ce point est analysé dans l'étude que les Grignoux ont consacrée à ce film.
68 Cette sélection appartient à la « cuisine interne » du documentariste comme de l'historien : certains témoins sont meilleurs que d'autres, certains documents sont plus « parlants » que d'autres... La sélection est nécessaire mais elle peut également être biaisée et dans certains cas critiquée.
69 On ne citera qu'un seul exemple, celui de François Furet et de son ouvrage Penser la Révolution française (Paris, Gallimard, 1978) dont le titre suffit à comprendre l'ambition.
70 Au sens que le sociologue Erving Goffman donne à ce mot dans Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux. Paris, Minuit, 1968 : « On peut définir une institution totalitaire (total institution) comme un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Les prisons constituent un bon exemple de ce type d'institutions, mais nombre de leurs traits caractéristiques se retrouvent dans des collectivités dont les membres n'ont pas contrevenu aux lois » (p. 41).
71 Bien entendu, une hypothétique recherche historique pourrait montrer que ces faits scandaleux ne concernaient qu'une toute petite minorité des jeunes filles enfermées dans ces institutions ? sinon seulement les quatre héroïnes du film... ?, mais tous les témoignages ultérieurs et toutes les enquêtes qui ont suivi ont confirmé l'ampleur de ces pratiques.
72 James M. Smith, « The Magdalene Sisters: Evidence, Testimony ... Action? » dans Signs: A Journal of Women in Culture and Society 32, 2 (Winter, 2007), p. 431-458 (traduction personnelle).
73 C'est cependant une tendance récente, favorisée sans doute par l'éloignement progressif du cinéma documentaire du reportage et du cinéma d'actualités.