





Une étude réalisée par les Grignoux sur le thème
Comment parler d'un film ?
le cinéma comme lieu de réflexion, d'échange et de discussion
Le texte ci-dessous propose différentes pistes pour animer un débat ou une discussion autour d'un film. Ces propositions portent plus particulièrement sur la manière d'interpréter et d'analyser un film et non sur les réalités éventuellement évoquées par ce film. Ce texte se présente par ailleurs comme un document de travail en évolution : deux chapitres consacrés l'un au rôle de la critique et l'autre à la relation esthétique ont été ajoutés en juin 2010.
Cliquez ici pour obtenir une version pdf facilement imprimable de ce document![]()
La vision d’un film ne s’achève sans doute pas avec la fin de la projection : très souvent en effet, les spectateurs éprouvent le besoin ou l’envie d’en parler avec d’autres, que ce soit d’ailleurs de façon positive ou négative. À première vue passive, la réception filmique suscite de nombreuses réactions qui sont généralement ignorées dans les analyses classiques du cinéma mais qui apparaissent comme le contrecoup « dynamique » de cette phase de passivité. Loin de se contenter de sa propre appréciation subjective, le spectateur souhaite manifestement échanger avec d’autres spectateurs ses avis et impressions, confronter son opinion avec celle d’autrui, partager son enthousiasme ou au contraire son dégoût avec d’autres personnes, qu’elles aient vu ou non le film en cause. Ce processus d’échange peut se faire oralement, mais il passe également par des voies écrites, quand on lit ou relit après la vision des critiques dans la presse, ou bien aujourd’hui par la participation à des forums de discussion sur Internet consacrés au cinéma.

L'Enfant sauvage de François Truffaut
François Truffaut a plusieurs fois cité cette formule entendue selon lui à Hollywood « chacun a deux métiers : le sien et critique de cinéma », tout en ajoutant « C’est vrai et l’on peut, à volonté, s’en réjouir ou s’en plaindre. J’ai choisi depuis longtemps de m’en réjouir, préférant cet état de chose à l’isolement et l’indifférence dans lesquels vivent et travaillent les musiciens et surtout les peintres » (« À quoi rêvent les critiques ? » dans Les Films de ma vie, Flammarion, 1975, p. 19). Depuis lors, la formule a été souvent citée pour dévaloriser ces appréciations spontanées du tout un chacun et défendre une approche critique mieux informée qui serait le fait de « spécialistes », aspirant souvent à devenir à leur tour des professionnels du cinéma. Mais cet apophtegme méconnaît sans doute l’importance psychologique et sociale de cette phase de partage avec autrui qui semble indispensable au processus de réception filmique (et sans doute plus largement artistique). Psychologiquement, nous éprouvons vraisemblablement le besoin de maîtriser, par l’échange ou la communication, les émotions ressenties pendant la projection, et, socialement, le cinéma est perçu — au moins pour une part — comme une injonction ou une prescription d’opinion qui implique une réaction implicite ou explicite de notre part : c’est évident pour des films dont le propos est clairement politique ou idéologique (par exemples les films de Ken Loach ou de Michael Moore), mais l’expérience montre que la plupart des films suscitent chez les spectateurs des prises de position, souvent polémiques, qu’elles soient de nature politique, morale, esthétique ou simplement humaine (comme quand on condamne le comportement de tel ou tel personnage mis en scène) [1].
Dans ce contexte, l’on comprend facilement que la séance de cinéma donne souvent lieu à des débats, des rencontres ou des animations de nature très diverse mais qui vont s’appuyer naturellement sur ce besoin ou ce désir de réaction présent chez beaucoup de spectateurs. L’objet des réflexions proposées ici est précisément de fournir aux animateurs quelques pistes pour mener un tel débat à propos d’un film vu de façon collective. On précisera cependant immédiatement que ces réflexions porteront sur les différentes dimensions du film et non sur l’exploitation éventuelle des thèmes dont traite tel ou tel film. Le cinéma est en effet un art de la représentation, et, dans une discussion, l’on passe très facilement du film à la réalité qu’il évoque plus ou moins directement ; mais il ne saurait être question d’aborder ces réalités nécessairement diverses, exigeant sans doute de multiples compétences qui ne peuvent être le fait d’un seul animateur.
On insistera précisément ici sur les différents aspects d’un film qui, dans les débats, est facilement réduit à n’être qu’un prétexte à la discussion. Rarement en effet, le film est considéré comme un véritable interlocuteur, et son propos est souvent considéré comme évident et immédiatement compréhensible par tous. Or, comme on essayera de le montrer, les choses ne sont sans doute pas aussi simples, et l’intérêt du cinéma (ou plus exactement un des intérêts du meilleur cinéma) est de nous proposer une représentation souvent problématique, complexe, nuancée et parfois ambivalente de la réalité. En outre, un film se réduit rarement à un propos, à des idées ou à des thèmes explicites et encore moins à un discours plus ou moins démonstratif : d’autres aspects — esthétiques, émotionnels, affectifs, imaginaires… — méritent d’être pris en compte et discutés avec les différents spectateurs. Ce sont ces aspects proprement filmiques qui retiendront ici notre attention.

Citizen Kane d'Orson Welles
Enfin, on se limitera ici au domaine du cinéma de fiction qui n’obéit pas aux mêmes conventions que le documentaire soumis à une exigence de vérité, de sincérité et d’authenticité, inconnue de la fiction : même s’il ne faut pas négliger la part de mise en scène et de subjectivité que comprend tout documentaire (qui ne se résume jamais à un simple enregistrement de la réalité) [2], le spectateur qui regarde un film de fiction sait qu’il s’agit là du résultat d’un important travail de mise en scène (même si ce travail est en tant que tel invisible), que les acteurs apparaissant à l’image interprètent en fait un rôle et que les événements racontés sont pour une part essentielle le fruit de l’imagination créatrice de leur auteur. Si l’on peut ainsi accuser un documentariste de mentir ou de falsifier la réalité, personne ne reprochera à Orson Welles d’avoir interprété et mis en scène le personnage de Citizen Kane qui n’a jamais existé en tant que tel. La fiction (cinématographique ou autre) entretient un rapport indirect à la réalité — contrairement au documentaire qui prétend représenter la réalité ou au moins une part de la réalité —, et tout rapprochement entre une fiction et la réalité est le fait du spectateur et comporte dès lors une part irréductible d’hypothèse : si tout le monde sait que le personnage de Kane est inspiré du magnat de la presse William Randolph Hearst, les deux ne sont évidemment pas réductibles l’un à l’autre, et le film d’Orson Welles peut être vu, compris et apprécié aujourd’hui encore, sans même connaître le nom et la personnalité de Hearst.

Rosetta de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Parler d’un film, c’est nécessairement l’interpréter, c’est expliciter un propos qui n’est jamais dit en tant que tel dans le film, c’est mettre des mots sur des images et des sons qui, pour une large part, ne sont pas en soi porteurs de significations. Cela vaut pour le sens supposé du film — ce que l’auteur a « voulu dire » mais qui n’est jamais explicitement dit — mais également pour sa « forme » ou son « esthétique » : quand on met en évidence telle ou telle caractéristique formelle (par exemple la profondeur de champ chez Orson Welles, les plans-séquences dans Elephant de Gus Van Sant, la caméra portée dans Rosetta des frères Dardenne…), on suppose en fait que ce trait est important, significatif, et qu’il traduit un choix plus ou moins conscient de son auteur (il n’est pas le fruit du hasard ni d’un simple enregistrement mécanique comme le ferait une caméra de surveillance). Même si une telle appréciation esthétique est sommaire (par exemple lorsqu’on affirme qu’un acteur joue bien ou mal), elle dépasse la simple observation et comporte une part implicite d’analyse, ce qui explique d’ailleurs qu’un tel jugement puisse être rejeté par d’autres spectateurs.
Existe-t-il alors des règles qui permettent de déterminer de façon précise le sens d’un film (ou au moins de certains de ses éléments), de suggérer certaines interprétations ou d’en rejeter d’autres ? En pratique, l’expérience montre en effet facilement que, même dans un public relativement homogène (par exemple celui d’un cinéma d’art et essai), les avis sont généralement contrastés mais que les manières de voir un film sont également très diverses : on est souvent étonné par certaines interprétations de spectateurs, qui peuvent paraître fausses ou unilatérales mais qui sont pourtant énoncées comme évidentes ou indubitables. La lecture des critiques dans la presse spécialisée peut également susciter des interrogations dans la mesure où elles parviennent souvent à dégager des significations complexes, peu évidentes et élaborées, sans que ne soient réellement expliquées les voies par lesquelles elles ont été construites.
Dès lors, pour l’animateur comme d’ailleurs pour les spectateurs, se pose la question des modes mais aussi des limites de l’interprétation filmique. Comment peut-on interpréter ou analyser un film ? Toutes les interprétations sont-elles valides ? Y a-t-il des règles ou des procédures d’interprétation mais également des limites à l’interprétation ?
Si les spécialistes du cinéma insistent sur la spécificité de ce média, il faut cependant bien voir que les procédures d’interprétation d’un film n’ont rien de spécifiquement cinématographique. Ainsi, lorsque nous regardons les images d’un film (à l’exception des images non-figuratives), nous les interprétons immédiatement comme représentant un monde en trois dimensions, mais les mécanismes perceptuels que nous mettons alors en œuvre (d’une façon qui est largement automatique et inconsciente) sont ceux-là mêmes qui nous permettent de « voir » le monde qui nous entoure. Nous n’avons pas besoin de schèmes sensoriels spécifiques pour interpréter une image plane en volume et en profondeur, même si nous devons légèrement adapter ces schèmes par exemple pour tenir compte de l’absence d’information binoculaire (face à l’image, nos deux yeux « voient » la même chose, alors que, face à un objet réel relativement proche, la différence d’information reçue par les deux yeux nous permet de percevoir le relief de cet objet) [3].
Contrairement à ce que prétendent de nombreux théoriciens, il n’y a sans doute pas de codes spécifiquement cinématographiques, ni même de « langage » cinématographique, comme il existe en revanche un code de la route (qui précise notamment le sens des panneaux de signalisation) ou des langues dont nous devons maîtriser (par un apprentissage explicite ou implicite) la grammaire et le vocabulaire pour les comprendre ou les parler. Historiquement en effet, les techniques de représentation cinématographique ont été élaborées en tenant compte des procédures ou des capacités interprétatives dont disposaient déjà les spectateurs, sans exiger qu’ils en acquièrent de nouvelles. C’est ce qui explique d’ailleurs le succès universel du cinéma qui a conquis facilement les publics du monde entier à qui il n’était demandé aucun effort (ou en tout cas aucun effort important) d’apprentissage ou d’adaptation pour entrer dans une salle de cinéma et voir un film[4].
Le cinéma utilise sans aucun doute des moyens d’expression ou de représentation spécifiques — l’image animée, la bande-son — mais ne s’appuie pas pour communiquer avec les spectateurs sur des structures, des codes ou des procédures qui lui seraient propres. Ainsi, le montage cinématographique permet de créer des effets de sens tout à fait originaux : par exemple, si la caméra nous montre d’abord un personnage regardant par la fenêtre puis, au plan suivant, un paysage à l’horizon duquel s’amoncellent de lourds nuages, nous comprenons immédiatement que le paysage est vu par le personnage au premier plan, bien qu’il n’y ait pas de lien explicite entre les images si ce n’est leur immédiate succession ; certains spectateurs pourront en outre percevoir dans les nuages le signe annonciateur d’un avenir sombre ou menaçant… Mais, pour interpréter ce montage d’images, le spectateur recourt à des procédures d’inférence qui n’ont rien de spécifiquement cinématographique et qui peuvent être mises en œuvre par exemple dans la lecture d’un texte écrit comme : « Il regarda par la fenêtre. De lourds nuages s’amoncelaient à l’horizon ». Ici aussi, nous établissons un lien immédiat entre ces deux phrases de la même manière que nous relions les deux plans cinématographiques qui se succèdent comme les deux membres d’une même phrase qui n’est pourtant nullement explicitée (« il regarde le paysage par la fenêtre »). Il s’agit là d’inférences qu’on peut qualifier de semi-logiques, largement spontanées, qui sont mises en œuvre pour la compréhension de toutes sortes de « textes », qu’ils soient écrits, oraux ou en images.

Elephant de Gus Van Sant
Cela signifie également qu’un « spécialiste » du cinéma ne dispose d’aucune autorité particulière, ni d’un savoir spécifique, pour interpréter un film ou même ses traits spécifiquement cinématographiques : face à des caractéristiques esthétiques remarquables — par exemple l’utilisation du plan-séquence dans Elephant de Gus Van Sant ou la caméra portée dans Rosetta des frères Dardenne —, l’analyste du cinéma ne dispose pas d’outils propres qui lui permettraient de déterminer le sens, la valeur ou l’effet de ces différents traits, et il recourra en réalité à des hypothèses de sens commun ou bien encore à différents savoirs (psychanalyse, philosophie, esthétique…) extérieurs au cinéma pour en donner une interprétation. Ainsi, quand André Bazin a analysé dans des textes devenus des classiques l’utilisation du plan-séquence et de la profondeur de champ chez Orson Welles comme les signes d’un réalisme foncier chez ce cinéaste, il a largement recouru à la philosophie dominante à l’époque (l’ontologie d’inspiration phénoménologique) pour expliquer le sens de ces caractéristiques esthétiques.
Cela ne signifie évidemment pas que les spécialistes du cinéma (notamment universitaires) n’aient aucune compétence particulière, et ils possèdent certainement une connaissance plus ou moins approfondie de l’histoire du cinéma et de l’art en général qui leur permet d’être sensibles à certaines caractéristiques filmiques moins évidentes (en particulier celles qui relèvent de ce qu’on appelle habituellement le « langage cinématographique »), de mieux apprécier l’originalité de chaque œuvre ou encore d’opérer des rapprochements plus ou moins inattendus avec d’autres films ou d’autres productions artistiques, surtout si elles sont moins connues. Mais ils n’ont pas une méthode d’analyse ni de guide d’interprétation qui leur permettrait de déterminer le sens et la valeur des éléments filmiques mis en évidence.
Doit-on alors conclure à un relativisme général et répéter, comme un lieu commun, que, tous, nous voyons les films différemment et que nous avons chacun notre point de vue sur les films ? La réponse est sans doute moins simple, plus complexe mais aussi plus incertaine.
Les différentes interprétations d’un même film peuvent être décrites comme formant un « spectre » ou un « éventail » depuis les interprétations les plus certaines ou les plus facilement admises jusqu’aux interprétations les plus hypothétiques et au-delà carrément fausses. Considérons d’abord ces dernières.
De manière générale, une interprétation consiste à relier (par des relations de sens) un nombre limité d’éléments filmiques ou textuels : dans le cas d’un film en particulier, il y a nécessairement un choix dans la mesure où l’image (visuelle ou sonore) est continue et que le nombre d’éléments observables est de ce fait potentiellement infini[5]. Mais, quand on analyse un texte (linguistique) d’une certaine ampleur comme un roman, on procède également à des choix en privilégiant certains éléments qui sont destinés à « soutenir » l’interprétation. Ainsi, il est toujours possible sinon facile de trouver des éléments qui confirment l’une ou l’autre interprétation, mais cette confirmation ne vaut pas validation puisque d’autres éléments peuvent être évoqués pour soutenir une interprétation concurrente : en revanche, certains éléments peuvent infirmer une analyse, c’est-à-dire démontrer qu’elle est fausse [6].
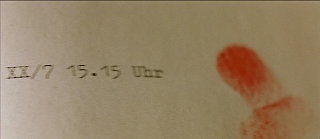
La Vie des Autres de Florian Henckel von Donnersmarck
Un exemple permettra de concrétiser ces réflexions un peu abstraites. Dans la Vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck (Das Leben der Anderen, 2006), un agent de la STASI (la police politique de l’ex-RDA), particulièrement mutique, trahit la mission qui lui a été confiée par ses supérieurs mais masque les preuves éventuelles de sa trahison : quelques années plus tard (après la chute du mur de Berlin), la victime de cet espionnage découvre dans les archives de la STASI une empreinte rouge sur le dernier rapport rendu par cet officier avant sa rétrogradation. Pour les spectateurs comme pour le personnage qui consulte ces archives, il s’agit d’un indice visible (il est filmé en très gros plan) du véritable rôle joué par cet officier, mais une discussion avec les spectateurs révèle très souvent une différence d’interprétation à ce propos : pour les uns, cette trace rouge est laissée par le doigt de l’officier qui aurait baigné dans le sang de la femme du personnage espionné, victime à la fin de ce long espionnage d’un dramatique accident ; pour d’autres en revanche, il faut remonter plus loin dans le film et se souvenir que la machine à écrire de l’espionné était dotée d’un ruban rouge et qu’elle a été subtilisée par l’officier qui a ainsi laissé cette marque rouge sur le document en cause. La première de ces interprétations est fausse en réalité, car, lorsqu’on revoit le film, on constate que l’officier s’approche de la femme accidentée mais ne la touche pas ; en outre, l’expérience nous apprend que le sang brunit au cours du temps et perd donc sa couleur rouge. Un élément objectif du film, facilement observable par tous à une seconde vision, infirme donc de façon décisive cette interprétation. Lorsqu’on fait ces différentes remarques aux spectateurs en cause, ils admettent d’ailleurs facilement s’être trompés et se rallient alors à la seconde interprétation.

La Vie des Autres de Florian Henckel von Donnersmarck
Celle-ci doit-elle être alors considérée comme vraie et exacte ? De manière absolue, non, car on pourrait encore faire l’hypothèse hautement improbable que cette marque rouge pourrait avoir été laissée ultérieurement par un protagoniste n’apparaissant même pas dans le film… Bien entendu, une telle hypothèse est extrêmement fragile et implique de faire des suppositions dont on ne trouve aucune confirmation dans le film lui-même. De nombreux arguments raisonnables —l’espion a bien manipulé la machine à écrire en question, cette trace rouge est montrée par le cinéaste pour nous rappeler celles visibles sur les doigts du personnage espionné, le film est une fiction construite sur ce genre d’indices destinés aux spectateurs pour orienter leur compréhension [7], etc. — jouent ainsi en faveur de l’autre interprétation que tous les spectateurs reconnaissent comme vraie même si, d’un point de vue strictement logique, on doit admettre qu’elle est seulement hautement vraisemblable.
Mais qu’est-ce que tout cela implique en situation de débat ou d’animation ? Dans une telle situation, on se trouve face à un groupe qui a sans doute des avis différents et qui a conservé également des souvenirs différents de la projection. Et c’est la confrontation des souvenirs qui va servir de « moteur » à la discussion. A priori, comme on vient de le montrer, aucun avis ne peut être déclaré plus pertinent qu’un autre, ni aucun point de vue meilleur ou plus juste ou plus éclairé qu’un autre. Mais la confrontation révélera sans doute aux participants une diversité d’opinions et d’interprétations : spontanément en effet, nous croyons facilement que notre point de vue est partagé par tous, alors que l’expérience révèle des divergences d’interprétation ou d’analyse plus ou moins importantes. Le rôle de l’animateur devrait être alors de favoriser l’expression des différentes opinions, notamment de celles qui seraient minoritaires : celles-ci peuvent en effet mettre en évidence des éléments qui auraient été ignorés par les autres spectateurs, tout en révélant des approches ou des points de vue différents. Il s’agira notamment de questionner les interprétations les plus unilatérales qui peuvent éventuellement être contredites (« falsifiées » comme on l’a vu) par des éléments qui obligent à nuancer de telles interprétations.
Exprimer une opinion ne suffit cependant pas, et toutes devraient être étayées par des argumentations plus ou moins élaborées. Bien entendu, il ne saurait être question dans un débat de construire une analyse critique du niveau de celles qu’on trouve dans les magazines spécialisés, mais la pertinence d’une interprétation se juge notamment à son pouvoir de conviction, même si ce pouvoir ne résulte sans doute pas uniquement d’arguments rationnels (le « charisme », la « séduction » ou le caractère intimidant d’un débatteur peuvent également emporter la conviction). L’objectif d’une telle discussion n’est cependant pas d’aboutir à un consensus, ni encore moins à une unanimité, et le caractère nécessairement hypothétique de toute interprétation implique que des divergences d’opinions puissent subsister à ce propos : une interprétation qui emporte un large « suffrage » ne peut pas être dite plus « vraie » qu’une autre, mais seulement mieux « acceptée », et une interprétation minoritaire (à l’exception de celles dont des éléments objectifs suffisent à montrer la fausseté [8]) ne doit pas « disparaître » parce qu’elle n’est pas partagée par tous.
Il n’est évidemment pas possible pour l’animateur (comme d’ailleurs pour n’importe quel analyste ou théoricien) d’anticiper l’éventail des interprétations possibles d’un même film, dans la mesure où les points de vue que l’on peut adopter sur un objet complexe comme un film sont en principe infinis [9], mais également où les procédures et les « systèmes » d’interprétation auxquels on peut faire appel ne peuvent pas être déterminés ni limités a priori (c’est le cas par exemple des analogies que des spectateurs peuvent percevoir entre un film et d’autres œuvres artistiques, qui sont innombrables). L’intérêt d’un échange avec les spectateurs est d’ailleurs de mieux mesurer les différences de points de vue qui peuvent se révéler très éloignés de ce que l’on aurait pu prévoir.
En même temps cependant, la discussion peut parfois sembler stérile dans la mesure où chacun reste enfermé dans ses premières convictions et que les différentes opinions s’expriment sans réellement se modifier. On suggérera à présent l’une ou l’autre voie qui permet, en matière de cinéma, une certaine progression dans la réflexion collective. Comme on le verra, ces approches, sans être totalement originales, rompent néanmoins avec la perception spontanée de la plupart des spectateurs.
Face à un film, nous portons spontanément des jugements de valeur sur les personnages, l’histoire racontée, la prestation des acteurs, le propos du cinéaste, l’esthétique filmique, le réalisme ou l’absence de réalisme de la fiction… Très généralement, nous prononçons de tels jugements comme s’ils étaient objectifs et devaient donc être reconnus de ce fait par tous : quand je dis par exemple que « ce film est mauvais », il n’y a aucune restriction dans mon propos alors que sa portée serait beaucoup moindre si j’affirmais seulement que « je pense ou j’estime que ce film est mauvais ».
Or, tout jugement de valeur repose sur une base nécessairement subjective : le beau, le laid, le bien, le mal, le juste, l’injuste, ne peuvent pas être définis de façon objective et varient grandement, on le sait bien, selon les individus, les cultures, les époques, les sociétés, les civilisations… Cela ne signifie cependant pas que toute discussion ou tout raisonnement soit impossible à propos des jugements de valeur : si les individus partagent les mêmes critères ou les mêmes échelles d’évaluation, ils peuvent alors analyser à quel « niveau » se situe l’objet en cause — œuvre d’art, comportement —par rapport à l’échelle envisagée. Ainsi, l’originalité est un critère souvent retenu dans l’appréciation cinématographique, et il est donc possible de discuter et d’argumenter pour décider si un film comme Pierrot le fou de Jean-Luc Godard (1965) est plus original que la Grande Vadrouille de Gérard Oury (1966).

The Wind that Shakes the Barley de Ken Loach
Mais, dans leurs jugements, les spectateurs se réfèrent à bien d’autres critères, même si c’est le plus souvent sur un mode implicite : ainsi, la complexité humaine des personnages permet souvent d’évaluer positivement certaines réalisations, et la plupart des critiques reconnaissent par exemple que les films de la maturité de Clint Eastwood (au moins depuis Honkytonk Man réalisé en 1983) se signalent par une ambivalence et une densité des personnages qu’on n’attendait pas de la part de l’acteur ayant interprété l’Inspecteur Harry (Don Siegel, 1972) ; morale et/ou politique sont également couramment utilisés pour juger les films, et l’évaluation des réalisations d’un cinéaste comme Ken Loach, dont l’engagement politique à gauche sinon à l’extrême-gauche est bien connu, ne peut pas faire l’impasse sur ses partis pris dénonciateurs de la politique libérale en Grande-Bretagne (les uns applaudissant cette dénonciation, les autres la trouvant simpliste ou démagogique) ; enfin, le « réalisme » (ou l’absence de réalisme) est un critère très fréquemment utilisé pour juger un film, en particulier depuis qu'André Bazin a défini le cinéma comme étant (ou devant être ?) un art essentiellement réaliste, et la plupart des spectateurs qui apprécient les films des frères Dardenne par exemple défendent la dimension profondément réaliste de leurs réalisations (la Promesse en 1996, Rosetta en 1999, L’Enfant en 2005 ou encore le Silence de Lorna en 2008).
L’utilisation de tels critères ou échelles d’évaluation pose néanmoins certains problèmes.
Ainsi, un critère comme le « réalisme » peut être entendu de manière extrêmement diverse, et il est bien difficile de définir quels sont les traits précis d’un film qui justifient éventuellement ce caractère « réaliste » ; en outre, comme nous avons généralement des conceptions différentes de la « réalité », ce qui apparaîtra aux uns comme authentique ou véridique pourra sembler aux autres conventionnel et artificiel. Autrement dit, le rapport entre une échelle d’évaluation et son application à un film précis, loin de reposer sur une argumentation purement rationnelle, se fait souvent de manière floue et distendue, ce qui aboutit alors à des opinions opposées, même si elles se réfèrent apparemment à des principes similaires.
Par ailleurs, certains critères — l’originalité, le « naturel », la « complexité », la « sobriété », « l’authenticité », « l’audace », « l’épure »… ou au contraire la « facilité », le « conformisme », le « moralisme », « l’académisme »…— sont fréquemment utilisés comme de simples qualificatifs de style qui décrivent et évaluent de manière globale le film sans véritable argumentation [10] : rien n’explique pourquoi ces traits doivent être considérés comme remarquables (ou au contraire dépréciatifs), et le jugement critique repose en fait sur une connivence implicite avec le lecteur ou l’interlocuteur dont on suppose qu’il perçoit immédiatement la valeur positive ou négative de ces qualificatifs.
Ceux-ci en outre sont utilisés le plus souvent de façon absolue — « c’est un film réaliste » — alors que de telles caractérisations sont très relatives et devraient donc être nuancées. L’originalité d’un film par exemple ne peut guère être définie que par comparaison avec d’autres réalisations et sera appréciée très différemment selon les œuvres auxquelles on fera référence : ainsi, la construction narrative dans Citizen Kane (Orson Welles, 1941) basée sur de nombreux retours en arrière a été considérée à la sortie du film comme très originale dans le champ cinématographique mais a sans doute moins étonné les amateurs de littérature qui connaissaient déjà les œuvres de Proust, Joyce ou Faulkner ; ainsi encore, le cinéma hollywoodien (en dehors de quelques grands noms prestigieux) est en général réputé peu inventif car reprenant toujours les mêmes schémas et les mêmes techniques, mais il suffit de comparer les réalisations récentes (aux alentours des années 2000) avec celles des années 1950 pour constater une formidable évolution stylistique due en fait à une série de glissements progressifs et souvent peu perceptibles (bien entendu, certains pourront également considérer que cette évolution s’est faite dans le sens d’une certaine médiocrité et non pas d’un quelconque « progrès »). En outre, la grande majorité des films constituent un mélange d’éléments plus convenus (« clichés », ficelles, lieux communs, conventions, traditions artistiques ou autres) avec d’autres plus inventifs ou plus singuliers, et il est dès lors bien difficile, en dehors d’exemples extrêmes, de prendre la mesure exacte de l’originalité nécessairement relative d’une réalisation [11].
Dans certains cas, la référence à des critères d’évaluation est d’ailleurs purement négative, les spectateurs (ou les critiques) définissant le film par ce qu’il n’est pas : on valorisera par exemple un film parce qu’il « refuse le sentimentalisme », qu’il « rejette toute idéalisation » ou tout « moralisme », qu’il évite « le piège du didactisme » ou qu’il se tient éloigné de toute forme d’analyse « sociologique » ou « psychologique ». Mais une telle caractérisation négative débouche en fait sur une indéfinition du film dont les « vertus » ou les « qualités » restent floues et peuvent alors faire difficilement l’objet d’un débat.
Les qualificatifs utilisés, que ce soit positivement ou négativement, ne constituent donc pas de véritables échelles d’évaluation et relèvent plus d’un usage rhétorique du discours que d’une réflexion argumentée. C’est ainsi que les traits dont ils sont censés rendre compte peuvent facilement être évalués de façon tout à fait inverse en recourant à d’autres qualificatifs de valeur opposée : le « réalisme » des uns deviendra le « misérabilisme » des autres, « l’originalité » défendue par certains sera rejetée comme « snobisme » ou « hermétisme » par d’autres, et la « rigueur » ou la « sobriété » seront raillées par ailleurs comme « ennui » et « pesanteur » sans intérêt…

Slumdog Millionaire de Danny Boyle
Dans les débats, on constate ainsi souvent que les mêmes caractéristiques font l’objet de qualifications mais aussi d’argumentations opposées : là où certains dénoncent par exemple les « clichés » répétés d’un film (par exemple Slumdog Millionaire de Danny Boyle, 2009), d’autres y voient au contraire un « jeu », un « second degré », une distance plus ou moins ironique par rapport à ces mêmes clichés. Les uns et les autres peuvent argumenter, citer des exemples, analyser certains éléments précis du film en cause, sans qu’il soit le plus souvent possible de les départager « rationnellement ».
Enfin, la référence à tel ou tel critère (ou échelle d’évaluation) reste nécessairement arbitraire (même si un grand nombre de personnes, un groupe social ou même une société entière peuvent le partager) et entraîne de ce fait des divergences d’opinion irréductibles. Ainsi, d’aucuns ont pu dénoncer le film King Kong (de Merian G. Cooper, 1933) comme une production imprégnée d’« impérialisme, colonialisme, racisme, puissance militaire, big business… et bons sentiments » [12], mais ceux qui admirent ce film, sans nier nécessairement cette dimension idéologique, sont en général sensibles à l’aspect esthétique de ce film fantastique, profondément original à son époque de ce point de vue. Dans ce cas, il est difficile sinon impossible de décider quel critère doit prendre le pas sur l’autre, ni de démontrer qu’une échelle d’évaluation doit être préférée à une autre.
Si ces considérations peuvent paraître abstraites, elles sont néanmoins confirmées par l’expérience pratique des débats où l’on constate facilement qu’aucune argumentation ne peut modifier certaines appréciations et que les opinions évoluent en général relativement peu à leur issue. Des raisons d’ordre sociologique et/ou psychologique expliquent sans doute ce fait, car les appréciations des spectateurs résultent certainement de motifs qui sont largement inconscients et sur lesquelles aucun discours ne peut réellement agir : ainsi, quand quelqu’un dit apprécier ou au contraire détester tel acteur ou actrice, et par conséquent le film dans lequel il ou elle apparaît, il est pratiquement impossible pour un autre individu de changer une telle opinion dont les raisons sont et resteront complètement enfouies. En outre, le plaisir ou le déplaisir qu’on éprouve à la vision d’un film ne résulte sans doute pas d’un seul aspect (par exemple son « réalisme », son « originalité » ou son « humanité ») mais d’un ensemble d’éléments qui influencent le spectateur de manière syncrétique, et qui sont difficilement analysables de façon discursive (c’est le cas par exemple de la musique qu’on apprécie de façon globale et intuitive mais qui sera très difficilement analysée par des personnes non musiciennes [13]).
S’il est pratiquement impossible d’éviter les jugements de valeur, ainsi que les débats qu’ils ne manqueront pas de susciter, on voit qu’ils risquent également de mener rapidement la discussion dans des impasses, chacun se repliant sur ses certitudes subjectives. Quelques pistes, déjà évoquées, devraient permettre néanmoins à l’animateur d’éviter certains blocages et de progresser dans la réflexion collective.
La première consiste à demander aux participants de ne pas se contenter de jugements généraux et d’essayer de préciser sur quels éléments précis du film portent leurs appréciations. S’agit-il des personnages, des acteurs, de l’histoire mise en scène, de l’esthétique cinématographique, de l’ambiance ou du climat dégagé (par exemple optimiste ou au contraire sombre ou négatif), de l’idéologie éventuellement véhiculée par l’auteur, du genre du film ou encore de la manière de représenter la réalité (authentique, fausse, biaisée, partielle…) ? En déterminant ainsi quels sont les éléments exacts qui suscitent leur adhésion ou au contraire leur rejet, les participants pourront prendre une première distance par rapport à leurs jugements spontanés, notamment si d’autres participants évaluent ou interprètent ces éléments différemment. Alors que la première appréciation est le plus souvent énoncée de façon absolue, la confrontation des opinions en se faisant plus précise amène généralement les interlocuteurs à nuancer leur propos en tenant compte de l’aspect nécessairement subjectif de leur avis. Ce sera le cas en particulier des caractéristiques du film sur lesquelles les jugements sont largement intuitifs comme le jeu des acteurs, l’ambiance, la photographie ou encore la musique qu’il est difficile de décrire de façon fine et détaillée : dans ce cas, il est difficile d’argumenter, et l’on doit presque nécessairement reconnaître la subjectivité de ses appréciations.

Le Silence de Lorna de Jean-Pierre et Luc Dardenne
© Christine Plenus
Une deuxième démarche consiste à mettre en évidence les différents points de vue sur le film et donc à souligner ses différentes dimensions ainsi que les multiples éléments qui le constituent : un film ne se réduit pas (en général…) ni à l’histoire racontée, ni à l’un ou l’autre épisode, ni au portrait d’un personnage (ou à la performance d’un acteur), ni même au « style » de la réalisation ou à un propos résumé en quelques mots. Ici aussi, la confrontation des opinions devrait permettre aux participants de prendre en considération des aspects qui pourraient être négligés dans un premier temps. Les souvenirs de la projection se focalisent en général chez chaque spectateur sur quelques éléments marquants, et la discussion permet alors de raviver d’autres séquences ou d’autres détails négligés ou oubliés. L’animateur pourra alors demander à chaque participant d’expliquer pourquoi tel ou tel élément lui paraît significatif pour que les autres prennent mieux conscience de la différence possible des points de vue : si, par exemple, l’ambiance misérabiliste ou désespérée d’un film déplaît aux uns, d’autres seront peut-être sensibles à l’énergie du personnage principal ou à la leçon de vie qui se dégage au terme de son parcours. Il ne s’agira pas d’opposer les points de vue mais de faire prendre conscience à tous des différentes manières de voir un film en mettant l’accent sur telle ou telle dimension.
Une troisième manière de faire consiste à suggérer des interprétations nouvelles ou différentes du film : l’animateur peut pour cela soit s’appuyer sur les réactions de certains spectateurs, soit élaborer lui-même de telles interprétations par une vision préalable du film et la lecture des critiques éventuellement publiées. Comme on l’a vu, il ne saurait être question d’imposer (contrairement à ce que font généralement les critiques… ) l’une ou l’autre interprétation qui comportera nécessairement une part d’hypothèse, mais il est légitime de suggérer une interprétation différente en soulignant son caractère plus ou moins fragile (« Moi, je trouve que…, J’ai lu que…, Un tel pensait que… ») et en demandant aux participants d’y réagir positivement ou négativement. Comme il n’y a pas de méthode d’analyse des films, ni de point de vue légitime dans leur abord, il n’est évidemment pas possible de prévoir les manières dont un film sera éventuellement compris ni de déterminer de façon certaine l’interprétation la plus pertinente (par exemple au sein de la critique). Proposer l’une ou l’autre analyse, même sommaire mais qui ne soit pas « évidente », a cependant comme avantage d’amener les participants à réfléchir de façon plus approfondie sur leur propre vision et à dépasser le niveau des jugements de valeur qui resteront irréductiblement subjectifs. L’analyse, qui pourra être discutée et même rejetée, va quant à elle s’appuyer (pour une part) sur des éléments objectifs et prendre en compte la complexité du film : cette complexité ne signifie pas difficulté — la plupart des films sont immédiatement accessibles à la majorité des spectateurs — mais renvoie aux différentes dimensions d’un film (qui résulte d’un travail de mise en scène, mais qui est aussi représentation d’une réalité, qui mélange vie des personnages et décors, paysages, objets matériels, qui montre des choses et en énonce d’autres parfois différentes ou contradictoires…) et à ses différents niveaux (par exemple celui des personnages ou celui de l’auteur du film).
Si les chercheurs en sciences humaines sont tenus à une « neutralité axiologique » (c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas porter de jugement normatif et doivent considérer les jugements de valeur émis en société comme des faits à décrire et à expliquer, sans y adhérer d’une manière ou d’une autre), une telle attitude de réserve n’est pas possible, ni n’a même de sens dans le cadre d’un débat ou plus largement de la vie courante. Néanmoins, une certaine mise en suspens temporaire est sans doute bénéfique pour une réflexion un peu approfondie sur un film : alors que les spectateurs, à l’issue de la projection, ont généralement l’impression immédiate d’avoir « tout compris » (ou plus rarement de « n’avoir rien compris »), il convient sans doute de mettre en cause cette certitude immédiate en mettant notamment l’accent sur la complexité (au sens entendu ci-dessus) du film. La réflexion, en se faisant plus objective, en prenant en compte différents points de vue, en analysant les différents éléments du film, devrait progresser dans le sens notamment d’un meilleur dialogue entre les différents participants, même si, encore une fois, à l’issue de la discussion, chacun restera libre de ses convictions et de ses préférences.

Élève libre de Joachim Lafosse
La question de la complexité filmique se pose en particulier quand il s’agit de ce qu’on peut appeler la représentation du mal, c’est-à-dire de la représentation au cinéma d’actions moralement mauvaises. Ce genre de représentations est, comme on le constate facilement, plus susceptible qu’une autre de susciter des débats et des réactions négatives. Citons simplement, pour éclairer le propos, des films comme Salo de Pier Paolo Pasolini (Italie, 1975), une adaptation des 120 journées de Sodome de Sade dans l’Italie fasciste de la fin de la guerre, Taxi Driver de Martin Scorsese (USA, 1976), mettant en scène un vétéran du Viêt-nam qui va se transformer en justicier solitaire, massacrant notamment au cours d’une scène particulièrement violente le souteneur d’une prostituée mineure, Élève libre de Joachim Lafosse (Belgique, 2008) qui évoque le viol d’un adolescent par son éducateur, Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi (France, 2000) qui met notamment en scène de façon explicite un viol, ou encore Henry, portrait of a serial killer de John McNaughton (USA, 1986), évocation sans commentaire, comme son titre l’indique, de l’itinéraire sanglant d’un tueur en série, bien que beaucoup d’autres titres, très différents, puissent ici être évoqués.
Pour un certain nombre de spectateurs, la représentation d’actions mauvaises est moralement mauvaise, notamment si elle n’est pas accompagnée d’une condamnation explicite. Mais, même dans ce cas, une telle représentation, notamment lorsqu’elle comporte une part évidente de violence (et/ou de sexualité), peut être jugée négativement parce qu’elle « n’apporte rien » qu’on ne sait déjà, parce qu’en elle-même, elle traduirait une complaisance à l’égard du mal. La condamnation porte en particulier sur l’effet supposé d’une telle représentation qui porterait les spectateurs (ou certains spectateurs psychologiquement plus faibles ou plus fragiles) à imiter les comportements mis en scène ou, en tout cas, à ne pas en percevoir le caractère moralement malsain.
L’accusation se porte cependant rapidement à un autre niveau, « supérieur », celui de l’auteur du film à qui l’on reprochera de se complaire dans la représentation du mal et de la violence (plus rarement de la sexualité seule) et dont les intentions seront jugées plus ou moins perverses : les justifications éventuellement avancées, par exemple « montrer la réalité telle qu’elle est », risquent alors souvent d’être rejetées comme le masque hypocrite d’un plaisir secret à forte composante sadique ou voyeuriste. Et là où les uns applaudiront au « questionnement » de la « réalité », les autres souligneront en revanche l’ambiguïté d’un propos qui ne semble pas vraiment capable de justifier ou d’expliquer la nécessité de représenter le mal, parfois sous des formes extrêmes.
Même s’il est peu probable que l’on puisse mettre fin à ce genre de polémiques, on remarquera cependant qu’il y a une nécessaire distinction entre la « réalité » (qui peut d’ailleurs être mêlée de fiction) et sa représentation, entre ce qui est montré et l’intention de celui (cinéaste, scénariste…) qui montre ces faits : si le spectateur est choqué par ce qu’il voit ou ce qu’il entend, il doit en effet reconnaître que l’auteur du film partage très vraisemblablement la même indignation [14], mais que d’autres motifs l’ont néanmoins poussé à vouloir représenter ces faits par ailleurs condamnables. Ces raisons peuvent être très diverses, par exemple dénoncer un état de choses mais également interroger une situation, chercher à comprendre l’enchaînement des événements, en démêler certaines causes ou certains mécanismes sous-jacents, montrer l’ambiguïté d’une réalité même si elle est moralement condamnable… Et l’on peut donc parler d’une forme de « complexité » filmique puisque les deux niveaux distingués — les faits représentés, les motivations de l’auteur — ne sont pas réductibles l’un à l’autre et que l’on ne peut pas comprendre immédiatement ces motivations à partir des événements représentés.
D’ailleurs, dans un certain nombre de cas (tous les films en cause ne relèvent pas d’une telle analyse), on peut penser que la « monstration », le questionnement, la recherche interprétative, la volonté de saisir la « complexité » des choses exigent sinon une indifférence éthique du moins une certaine distance par rapport à nos jugements moraux spontanés (ceux qu’on adopterait spontanément si l’on était réellement confronté aux événements mis en scène). Il ne s’agit pas d’une distance esthétique [15] mais plutôt d’une espèce de « neutralité axiologique » (proche de celle observée dans les sciences humaines) même si, au cinéma, une grande part du travail interprétatif et explicatif est alors laissé aux spectateurs : dans ce type de films (comme ceux cités précédemment), l’auteur du film privilégie « l’objectivité » des faits (même s’ils sont mêlés à la fiction) par rapport à leur interprétation et au jugement moral qu’on peut porter dessus. Mais cette « posture », qui donne une grande liberté aux spectateurs, risque aussi d’être interprétée comme une espèce d’acquiescement à une réalité par ailleurs intolérable.
Ce type de films pose ainsi la question des intentions supposées de l’auteur du film, qui vont à présent retenir notre attention.
Souvent nous voyons des films (mais également des séries télévisées) sans même nous interroger sur leur auteur : nous suivons l’histoire, nous partageons plus ou moins intensément la vie des personnages, nous éprouvons des émotions parfois très vives devant certaines séquences, mais nous ne nous demandons pas ce que l’auteur du film a voulu « dire » ou faire ni comment il a réalisé son film. Ainsi, nous apprenons quelquefois avec surprise que le film est le fruit d’une adaptation d’un roman peu connu alors que nous croyions qu’il s’agissait d’un scénario original. Ou il nous arrive de découvrir que le cinéaste présumé était en fait une femme alors que spontanément, nous pensions qu’il s’agissait d’un homme (regrettant peut-être alors d’avoir été victimes ou complices d’un stéréotype sexiste) [16]. Ou bien encore, une interview nous révèle que le réalisateur d’un film que nous aimons ne partage pas du tout nos opinions philosophiques, politiques ou religieuses…
Quel rôle faut-il alors attribuer au cinéaste ? Peut-on analyser un film sans s’interroger sur les intentions de son réalisateur ? Peut-on même comprendre un film sans recourir à des interviews où son auteur explique son travail ou son projet, sans connaître le contexte où il travaille et où il s’exprime ? En effet, il arrive aussi qu’une réalisation cinématographique nous échappe et nous laisse perplexes (on peut penser à des films volontairement hermétiques comme ceux de Peter Greenaway), et nous sommes alors tentés de recourir aux explications éventuellement fournies par son réalisateur. Mais celui-ci est-il réellement le mieux placé pour éclairer le sens de son film et a-t-il même la volonté d’expliquer ce qu’il fait [17] ? Dans certains cas enfin, lorsqu’un film nous choque ou nous scandalise, nous nous en prenons — au moins verbalement — à son auteur que l’on accusera par exemple de se complaire dans la représentation de la violence, ou de donner une représentation biaisée de la réalité, ou encore de propager des idées malsaines ou détestables, ou tout simplement d’avoir fait un film stupide, laid ou vulgaire… Mais un film se confond-il avec son auteur ? Et qui est vraiment l’auteur d’un film ? le réalisateur, le scénariste, toute l’équipe de tournage, le producteur… ?

Bowling for Columbine de Michael Moore
Lors d’un débat, il est pratiquement impossible de ne pas poser à un moment ou l’autre de telles questions sur l’auteur du film, ses intentions, sa manière de faire, sa responsabilité ou le sens qu’il est censé avoir donné à son film. Pourtant, l’auteur n’apparaît jamais en tant que tel à l’écran (sauf rares exceptions comme celles du réalisateur Michael Moore se mettant lui-même en scène dans ses films comme Bowling for Columbine ou Fahrenheit 9/11) et fait tout aussi rarement entendre sa voix (les voix off de narrateur sont souvent celles d’un acteur ou d’un interprète). Comment dès lors peut-on discuter de cette « figure » le plus souvent invisible et inaudible ? Et comment peut-on lui prêter des intentions ou des propos qui sont nécessairement extérieurs au film lui-même ?
Il n’est pas possible de répondre de façon simple à toutes ces questions et il faut se méfier des réponses trop évidentes à ce propos. En situation d’animation, il conviendra sans doute de susciter plutôt le doute, tout en favorisant le dialogue entre les participants. On indiquera à présent quelques pistes de réflexion pour éclairer ces différents points.
Très rapidement après son invention (1895), le cinéma a été considéré non pas seulement comme une curiosité technique ou comme un divertissement mais comme un art, un art nouveau à l’esthétique singulière, différente de celle des arts qui l’avaient précédé [18]. Mais, si cette dimension artistique a été rapidement reconnue, la définition ou la détermination de son auteur — donc de l’artiste — a été plus longue et plus conflictuelle. Sans vouloir résumer cette histoire complexe de façon sommaire, on signalera néanmoins quelques lignes de partage essentielles dans un processus qui n’est d’ailleurs pas totalement achevé.
Bien que les différences entre ces deux arts aient tout de suite été perçues, la comparaison avec le théâtre et plus largement la littérature a longtemps pesé sur la réflexion sur le cinéma, surtout quand celui-ci s’est mis à adapter des textes d’origine littéraire (l’un des films les plus célèbres de Méliès, Le Voyage dans la lune, est déjà tiré en 1902 d’un roman tout aussi célèbre de Jules Verne, comme l’un des premiers grands films italiens Les derniers jours de Pompéi - Gli ultimi giorni di Pompei de Luigi Maggi l’est en 1908 d’un roman homonyme d’Edward George Earl Bulwer-Lytton, et bien d’autres adaptations suivront comme La Reine Margot en 1909, La Dame aux camélias ou Les Trois Mousquetaires en 1912, ou la série des Fantomas à partir de 1913). Or au théâtre, jusqu’à la fin du 19e siècle au moins [19], la mise en scène a été considérée comme secondaire par rapport au texte où s’exprimait le génie créateur des grands écrivains, Racine, Molière ou Hugo. Conscients de la spécificité et de la nouveauté du cinéma, beaucoup vont alors refuser cette position subordonnée du travail de mise en scène et affirmer que c’est le réalisateur le véritable artiste en ce domaine : le terme même de « metteur en scène » sera d’ailleurs rejeté à certaines époques au profit de celui de « cinéaste » (inventé par Louis Delluc en 1920) ou de « réalisateur » (jugé néanmoins trop vague par d’autres). La question n’est d’ailleurs pas purement intellectuelle, et elle met en jeu la reconnaissance juridique du droit des auteurs dans le domaine cinématographique : dès 1928, à une époque où beaucoup considèrent encore le cinéma comme une distraction sans grande valeur, Abel Gance intente un procès à la société de distribution qui a modifié ou « mutilé » sans son autorisation son film Napoléon, affirmant ainsi sa position d’auteur du film au sens fort du terme.
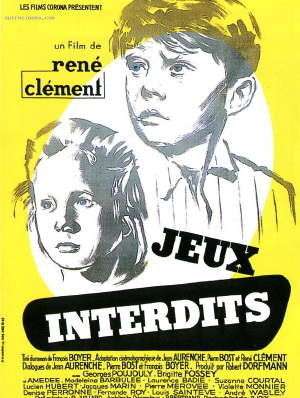
Jeux interdits de René Clément
sur un scénario de Jean Aurenche et Pierre Bost
La tendance à attribuer le rôle essentiel au cinéaste (ou metteur en scène) culminera en France avec la « politique des auteurs » promue par les Cahiers du Cinéma et la « Nouvelle Vague » : celle-ci s’opposera en particulier (à travers notamment un article célèbre de François Truffaut) au cinéma « de qualité française » qui se signalait notamment par une collaboration étroite entre réalisateurs et scénaristes (dont le « couple » célèbre d’Aurenche et Bost) avec une prédilection pour les adaptations d’œuvres littéraires. Si la « politique des auteurs » a rapidement triomphé (notamment au niveau critique), le débat sur l’importance relative du scénariste et du metteur en scène est encore aujourd’hui régulièrement relancée (souvent sous une forme renouvelée ou détournée) dans la mesure où le film est effectivement le fruit d’un travail collectif, et où il est impossible de décider a priori et de façon nécessairement arbitraire de la responsabilité exacte des uns et des autres.
On remarquera d’ailleurs, que, si, en France, le travail de mise en scène du cinéaste a été privilégié par rapport à l’écriture du scénario, aux États-Unis en revanche, un rôle essentiel a été pris et longtemps assumé par des producteurs qui ont souvent réussi à imposer leur marque de fabrique à l’ensemble des films qu’ils ont produits (ce fut le cas entre autres de RKO Pictures dont un certain nombre de films ont encore été récemment réédités sous forme de collection de DVD avec l’étiquette RKO, signe supposé d’un style caractéristique) [20]. Si là aussi, les cinéastes ont réussi à faire reconnaître l’importance de leur rôle (même si cette reconnaissance est moins nette qu’en Europe), il est dans les faits difficile de distinguer la part prise par les producteurs dans la conception, la définition et la réalisation des films notamment américains.
Enfin, et ce n’est pas du tout anecdotique, beaucoup d’acteurs interviennent parfois de manière décisive dans la réalisation d’un film, que ce soit par leur simple travail d’interprète, ou par des interventions au niveau du scénario ou de la mise en scène. Si le rôle des acteurs, surtout s’ils sont célèbres, est souvent surestimé par un large public qui peut même croire que c’est eux qui « font le film », il peut également être négligé de façon outrancière par exemple dans les analyses universitaires centrées essentiellement sur le point de vue du cinéaste (certaines analyses font bien sûr exception).
Que peut-on conclure de tout cela, notamment en situation d’animation ? Spontanément, la plupart des spectateurs attribuent la responsabilité du film à un seul auteur qui agirait de façon libre et indépendante dans ses choix, ce qui est sans doute légitime et qui correspond à la situation effective de réalisation d’un grand nombre de films aujourd’hui. Néanmoins, il convient aussi de s’interroger sur ce contexte de réalisation qui peut se révéler plus complexe ou plus contradictoire qu’il n’y paraît à première vue. Interviews, articles de presse, analyses diverses peuvent apporter un éclairage pertinent à ce propos.

Oliver Twist de Roman Polanski
Ainsi, un cinéaste peut adapter un scénario (par exemple littéraire) en gardant une distance critique par rapport à ce scénario (parce qu’il est daté, simpliste, unilatéral…). Lorsque Roman Polanski par exemple met en scène les aventures d’Oliver Twist (en 2005), il réalise un film à destination d’un jeune public (enfants ou préadolescents) tout en racontant une histoire sans doute célèbre mais écrite au 19e siècle dans une Grande-Bretagne extrêmement conservatrice ; si l’on connaît un peu la filmographie de ce cinéaste (auteur entre autres du Bal des vampires ou Rosemary’s Baby en 1968), l’on comprend assez facilement qu’il est capable de s’adapter aux contraintes d’une superproduction tout en portant un regard ironique sur le roman de Dickens (qui n’est d’ailleurs pas dépourvu d’humour) et en particulier sur son moralisme aujourd’hui dépassé. Mais cette distance ironique n’est pas toujours perçue par les spectateurs qui sont surtout sensibles à cet aspect moralisateur qu’ils attribuent de façon unilatérale (et sans doute fausse) au cinéaste.
Très souvent, les films résultent ainsi d’exigences diverses sinon contradictoires — celles d’un producteur, d’un scénariste, d’un cinéaste… — qui peuvent donner lieu à un conflit mais qui aboutissent le plus souvent à un compromis : certains films peuvent alors susciter des jugements opposés du public parce qu’ils paraissent aux uns reproduire les « codes » ou les conventions d’un genre populaire alors que les autres sont sensibles à l’originalité (nécessairement relative) dont a fait preuve le cinéaste dans son travail de mise en scène et/ou d’adaptation par rapport à un genre fortement « codifié » [21]. La « touche personnelle » du cinéaste ne se manifeste donc pas nécessairement dans un scénario mais plutôt dans un travail de mise en scène plus ou moins original mais qui peut également passer facilement inaperçu.

Le Cercle de Jafar Panahi
De manière générale, il est évident que le contexte de réalisation d’un film, les conditions dans lesquelles travaillent un cinéaste et ses collaborateurs, ont une influence plus ou moins directe sur ce travail et doivent être pris en considération pour porter un jugement pertinent sur ce film. L’on comprend facilement par exemple que des questions comme l’avortement ou la peine de mort sont abordées différemment aux États-Unis où ces questions sont fortement polémiques, et en Europe où les opinions publiques sont nettement moins divisées à ce propos [22]. De façon encore plus évidente, dans des pays comme l’Iran où s’exercent un fort contrôle des opinions ou une réelle censure, les cinéastes mais aussi les scénaristes et producteurs vont exprimer leurs opinions de façon plus ou moins détournée (surtout si elles ne sont pas conformes aux normes du pouvoir en place) [23]. Des informations complémentaires sur les conditions de réalisation permettront certainement à l’animateur et aux spectateurs de mieux appréhender la responsabilité de chacun (cinéaste, scénariste, producteur, acteurs…) ainsi que les contraintes éventuelles auxquelles les différents intervenants ont été confrontés, et de porter (peut-être… ) des jugements plus éclairés, même si ce contexte n’explique certainement pas à lui seul un film dont la forme et le sens ne peuvent pas être réduits à ses conditions de réalisation.
On soulignera en effet à ce propos que le contexte de réalisation doit lui-même être interprété et ne donne certainement pas la « vérité » du film. Ainsi, l’on peut facilement être tenté de recourir à des interviews de cinéastes pour mieux comprendre le sens ou la portée de leurs films ainsi que leurs choix esthétiques. Néanmoins, si ces interviews sont souvent éclairantes, elles peuvent aussi se révéler partielles sinon partiales ou superficielles. Un cinéaste n’est pas toujours capable d’expliquer des choix qui ont souvent été faits de manière intuitive et dans une certaine urgence ; il n’a pas nécessairement non plus la volonté de commenter, ni de traduire en mots une œuvre qui, à son estime, se suffit à elle-même ; la manière de mener l’interview peut également mettre en avant des éléments ou des aspects du film qui sont en fait secondaires aux yeux du cinéaste, ou bien induire des interprétations unilatérales auxquelles le cinéaste peut acquiescer mais qui en masquent d’autres possibles [24] ; enfin, il n’est pas sûr que l’analyse qu’un cinéaste donnera de son propre film soit nécessairement exacte ni fiable, dans la mesure où lui-même interprète le résultat d’un long processus créatif, dont les raisons premières sont pour une part enfouies et disparues. Tout cela justifie que l’on fasse une distinction entre le cinéaste, personne réelle, et l’auteur comme figure filmique que le spectateur reconstruit à travers sa vision du film, même s’il y a évidemment un recouvrement entre ces deux instances : pour chaque film, seule une recherche historique approfondie permettrait cependant de déterminer avec une relative certitude comment et dans quelles limites opérer un tel recouvrement [25].
Il faut en effet bien distinguer entre le responsable réel du film (qui peut être multiple ou qui, comme individu, peut être soumis à des exigences contradictoires) et l’auteur du film tel que le spectateur peut le reconstituer à travers sa vision du film : si le cinéaste n’apparaît pas en effet en tant que tel dans son film (sauf rares exceptions), on peut néanmoins déceler sa présence à travers de multiples indices parsemés dans le film. Qu’il s’agisse de la position de la caméra, du cadrage, du montage, de la musique d’accompagnement, tous ces éléments et bien d’autres, dès qu’ils sont pris en compte par le spectateur, ne peuvent être expliqués ou simplement compris sans se référer à l’auteur du film comme responsable de leur choix : par exemple, même si le cinéaste n’a pas personnellement composé la musique de son film, c’est lui qui l’a choisie, qui a déterminé les moments où elle devait apparaître et qui l’a intégrée de façon plus ou moins réussie à l’ensemble du film.
De nombreux éléments filmiques peuvent ainsi être interprétés à un double niveau, celui de l’histoire mise en scène ou bien celui de l’auteur, responsable « en dernière instance » de cette mise en scène. Par exemple, le costume des personnages pourra être vu comme le reflet de leur caractère, de leur appartenance historique ou sociale ou encore de leur état psychologique présent (des vêtements désordonnés exprimant un « désordre » de l’esprit), mais il résulte en définitive d’un choix du cinéaste, visant sans doute à traduire le caractère, l’appartenance historique ou sociale ou l’état psychologique des personnages, mais dépassant également cette seule dimension : ainsi, le choix de vêtements très colorés dans de nombreux films d’Almodóvar ne s’explique pas uniquement par le caractère supposé des personnages et sera facilement mis en relation avec le choix d’autres éléments filmiques comme les décors et les lumières dans une mise en scène que l’on qualifiera de « baroque » de« kitsch » ou encore de « flamboyante » ou d’« outrancière ».

La Mauvaise Éducation de Pedro Almódovar
Semblablement, qualifier les intrigues de beaucoup de films d’Almodóvar ou de Douglas Sirk de mélodramatiques amène à dépasser le point de vue des personnages (qui vivent peut-être dans le malheur mais ne le considèrent pas comme « mélodramatique ») pour se situer au niveau de l’auteur supposé d’une telle intrigue. On remarquera d’ailleurs que le changement de niveau entraîne dans ce cas un changement important de perspective : si le spectateur s’identifie aux personnages, il aura tendance à être fortement ému par les malheurs qu’ils rencontrent, alors que la prise en compte du caractère mélodramatique de l’intrigue suscitera une prise de distance réflexive par rapport notamment aux émotions éventuellement ressenties [26].
Comment s’opère alors ce passage d’un niveau à l’autre, du point de vue des personnages à celui de l’auteur ? Et de façon plus large, comment peut-on reconstituer le point de vue de l’auteur à partir des différents indices présents dans le film ?
On a déjà relevé qu’il existait dans un film des indices plus ou moins visibles de l’intervention de l’auteur, indices que les théoriciens du cinéma appellent des traces de l’énonciation [27] : on peut reconnaître de tels indices, qui sont extrêmement nombreux et divers, au fait qu’ils ne peuvent pas s’interpréter dans le seul cadre de la fiction mise en scène, ni en particulier du point de vue des personnages qui y apparaissent. Quand un spectateur remarque par exemple un grand nombre de cadrages obliques [28] dans un film comme Slumdog Millionaire de Danny Boyle (Grande-Bretagne, 2008), cette caractéristique ne peut s’expliquer que comme un choix (esthétique, expressif…) du cinéaste, qui ne concerne en rien les personnages du film. La sensibilité des spectateurs à de tels indices est évidemment très variable et dépend notamment de leur culture cinématographique : ainsi, l’utilisation du plan-séquence [29], qui est valorisée par de nombreux critiques et réalisateurs, passe inaperçue aux yeux d’un grand nombre de spectateurs « non avertis » qui n’en mesurent pas la difficulté technique ni l’originalité artistique. Semblablement, si nous ne sommes pas musiciens, nous ignorons facilement les musiques d’accompagnement que nous entendons mais que nous n’écoutons pas réellement parce que notre attention est largement concentrée sur les événements mis en scène ; mais, si le choix de cette musique nous paraît inadéquat (vieillot, bizarre, bruyant…), nous nous interrogerons sur la pertinence de ce choix et critiquerons éventuellement son auteur.

4 mois, 3 semaines & 2 jours de Cristian Mungiu
Il faut donc rappeler que tous les éléments filmiques relèvent de la responsabilité du cinéaste et peuvent donc être interprétés en fonction d’une intention supposée de celui-ci. Mais, lors de la projection et même dans une analyse critique, seul un nombre limité de ces éléments seront effectivement interprétés dans une telle perspective : ainsi, on s’interrogera plus facilement sur un cadrage oblique, qui est relativement inhabituel, que sur un plan « droit » [30] tout à fait banal, bien que celui-ci résulte lui aussi d’un choix du cinéaste et puisse également traduire un parti pris par exemple stylistique. Dans certains films d’ailleurs (par exemple, dans beaucoup de films de Bresson ou dans 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Cristian Mungiu), le refus de tout cadrage inhabituel, « spectaculaire », de tout mouvement de caméra inutile, peut être vu comme un trait remarquable, esthétiquement significatif. Autrement dit, les indices de l’intervention de l’auteur, les « marques de l’énonciation » ne peuvent pas être déterminés de façon absolue, « formelle », et varient grandement en fonction des films envisagés, de la sensibilité et de la culture des différents spectateurs ainsi que du contexte historique et cinématographique dans lequel ces films ont été produits. Ainsi, filmer une scène à une distance importante en continu en un long plan fixe (comme une scène de théâtre vue à partir du siège d’un spectateur) était la pratique courante aux débuts du cinéma (qui s’inspirait alors précisément du dispositif théâtral) mais apparaîtrait comme remarquable (ou incongru…) dans un film contemporain (on peut citer un documentaire comme Délits flagrants de Raymond Depardon (France,1984) qui a filmé les premières confrontations entre des personnes arrêtées en flagrant délit et les substituts du procureur ou leurs avocats : ces entretiens sont toujours cadrés en plans fixes, en continu et à distance « respectueuse » des personnes pour des raisons de confidentialité mais sans doute aussi avec la volonté esthétique de montrer les faits de façon « brute » avec un minimum de partis pris — ceux-ci s’exprimant sans doute plus au niveau du choix des entretiens effectivement retenus et de leur découpage).
Traditionnellement donc, les analystes du cinéma prêtent notamment attention aux « regards caméras », aux « cadres dans le cadre », aux « voix off », aux « mises en abyme » du film dans le film, aux points de vue inhabituels, « non neutres », ou encore aux effets de montage et aux mouvements de caméra remarquables, dans lesquels il est relativement facile de reconnaître l’intervention de l’auteur du film.
Les « regards caméras » constituent une infraction à une convention importante du cinéma de fiction qui veut que les acteurs fassent semblant d’ignorer la présence de la caméra — censément inexistante dans l’univers des personnages — et qu’ils évitent en particulier de regarder la caméra : le regard à la caméra donnerait en effet au spectateur l’impression d’une transgression révélant le caractère illusoire, artificiel, de la fiction cinématographique. Mais certains cinéastes peuvent recourir à ce procédé précisément pour amener les spectateurs à prendre une distance réflexive par rapport à l’univers imaginaire dans lequel ils sont plongés. Dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard (France, 1960), Jean-Paul Belmondo s’adresse même au spectateur (« Si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la campagne... allez vous faire foutre ! ») en regardant la caméra, ce qui peut apparaître à la fois comme une provocation ironique mais aussi comme une distanciation critique par rapport en particulier à la fiction policière et à toutes les conventions de ce genre auquel se réfère par ailleurs ce film. En revanche, dans le célèbre plan qui termine Les 400 Coups de François Truffaut (France, 1959) et qui se fige sur le regard à la caméra du jeune Antoine Doinel, la fiction semble se confondre avec la réalité en nous faisant voir non plus le personnage mais l’acteur Jean-Pierre Léaud, adolescent qui semble alors incarner toutes les adolescences.
Le « cadre dans le cadre », c’est-à-dire le redoublement du cadre rectangulaire de l’écran par un cadre intérieur, souvent une fenêtre, est également une figure régulièrement mise en évidence par la critique cinématographique. Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (Rear Window, USA, 1955) est l’exemple emblématique de cette figure puisque le personnage principal, temporairement immobilisé par une jambe dans le plâtre, observe à travers la fenêtre de son appartement la vie de ses voisins dans l’arrière-cour de son immeuble : pour le spectateur, cette situation rappelle évidemment sa propre situation d’observateur immobilisé sur son siège dans une salle obscure en train d’observer sans être vu la vie des êtres qui s’agitent à l’écran… Le cadre dans le cadre et, plus largement, l’ensemble du dispositif imaginé par Hitchcock peuvent donc facilement être vus comme une manière (plus ou moins ironique) pour le cinéaste de faire prendre conscience aux spectateurs de la dimension fictive des événements mis en scène et indirectement du rôle de montreur d’ombre qui est le sien.

la "mise en abyme" du cinéma dans
La Mala Educación de Pedro Almódovar
Un tel dispositif peut par ailleurs être rapproché du procédé de la « mise en abyme » qui consiste à évoquer dans le film le tournage d’un autre film en montrant notamment les manipulations, trucs et trucages qui accompagnent n’importe quel tournage. Parmi bien d’autres titres, on peut citer La Nuit américaine de François Truffaut (France, 1973) ou Étreintes brisées de Pedro Almódovar (Los abrazos rotos, Espagne, 2009), qui mettent en scène des personnages (fictifs) de cinéastes, et qui incitent facilement les spectateurs à s’interroger sur les rapports éventuels entre ces personnages et l’auteur même du film : ces rapports ne relèvent pas nécessairement de l’autobiographie (même voilée), et Étreintes brisées par exemple peut être vu comme une leçon de montage cinématographique, deux films, l’un raté, l’autre réussi, pouvant être réalisés à partir des prises — bonnes ou mauvaises — du même tournage.
Le montage est effectivement un lieu d’intervention privilégié du cinéaste, et certains effets peuvent être facilement perçus par le spectateur, l’amenant alors à s’interroger sur le sens de cette intervention. Au niveau du montage son, l’utilisation de la voix off [31] induit par exemple une distance immédiate par rapport à l’histoire mise en scène en créant un « point de vue » extérieur ou, plus exactement, une présence sonore, étrangère, réflexive, qui brise l’illusion de l’immédiateté ou de la « transparence » des événements : même quand cette voix est celle d’un personnage (par exemple revenant sur les événements passés) et non pas d’un narrateur extérieur ni de l’auteur du film (comme dans le célèbre Fellini Roma, Italie, 1972), elle suffit souvent à souligner la manipulation (sans nuance péjorative) dont les événements de la fiction font l’objet, en attirant par exemple l’attention du spectateur sur l’écart temporel, mais également sur les ellipses, sur la dimension de reconstitution qu’implique tout travail de mémoire (par exemple dans la Comtesse aux pieds nus - The Barefoot Contessa de Joseph Mankiewicz, USA, 1954) et parfois sur certaines invraisemblances du récit (comme dans le célèbre Sunset Boulevard de Billy Wilder, USA, 1950, où la voix off se révèle être celle d’un personnage mort, ce qui est également le cas dans American Beauty de Sam Mendes, USA, 2000).
Le montage de la bande image passe souvent inaperçu (et il sera alors réputé « transparent »), mais de nombreux procédés peuvent être suffisamment visibles pour que les spectateurs prennent conscience du travail du cinéaste et s’interrogent éventuellement sur les intentions qui ont pu le guider dans ses choix. C’est le cas des bouleversements de la chronologie des événements qui, même s’ils sont expliqués par les souvenirs de l’un ou l’autre personnage (comme dans le célébrissime Citizen Kane d’Orson Welles, USA, 1941), impliquent (comme la voix off) une manipulation sensible et une mise à distance réflexive des événements représentés. L’intervention du cinéaste est bien sûr encore beaucoup plus visible quand de tels bouleversements ne sont pas motivés par des éléments du récit (comme les supposés souvenirs d’un personnage) : Pulp Fiction de Quentin Tarantino (USA, 1994), qui se présente sous les dehors d’un film policier de série B (les « pulp fictions » du titre), est ainsi construit comme un véritable puzzle dramatique passant sans prévenir d’une époque à l’autre, obligeant le spectateur à reconstituer la chronologie complexe des événements mais également à s’interroger sur le sens de ces bouleversements. La manière d’entamer une séquence ou au contraire de la couper peut également être suffisamment inattendue pour être remarquée et nous faire percevoir le travail de montage du cinéaste : tous les spectateurs de Rosetta des frères Dardenne (Belgique, 1999) se souviennent de la scène d’ouverture où une caméra en mouvement se colle littéralement aux basques de la jeune héroïne déboulant dans les escaliers à la recherche d’une collègue qui a déclenché sa colère ; de manière similaire mais inversée, la dernière scène du film ne manque pas de nous surprendre quand la séquence se coupe sur un geste à peine achevé, à peine visible de Riquet, son ancien ami devenu son « ennemi », qui après l’avoir longuement harcelée avec sa mobylette lui vient enfin en aide, l’écran devenant aussitôt noir. Les admirateurs des deux cinéastes wallons se rappelleront également l’ellipse centrale du Silence de Lorna (Belgique, 2008) où l’on voit en début de journée Lorna quitter joyeusement Claudy qui s’éloigne à vélo, la séquence immédiatement suivante commençant avec le visage grave de la jeune femme prenant des vêtements pour l’enterrement du jeune homme (assassiné en fait par un complice). Tous ces exemples de montage (et bien d’autres [32]), dont les effets sont facilement perçus par les spectateurs même peu avertis en la matière, révèlent l’intervention de l’auteur (ou des auteurs) du film et doivent donc être compris de manière intentionnelle, même si, dans de nombreux cas, cette « intentionnalité » ne se confond pas avec un propos explicite ni avec un discours plus ou moins conceptualisé : « comprendre » l’ellipse centrale du Silence de Lorna consiste sans doute moins à mettre des mots sur cet effet de montage, qu'à en éprouver la violence et le caractère inattendu.
La réflexion vaut sans doute également pour le dernier type d’indices, mentionné ici, de l’intervention de l’auteur à savoir les cadrages et mouvements de caméra, plus ou moins remarquables et remarqués, et qui sont évidemment voulus et dirigés par le cinéaste. Ici aussi, l’interprétation sera généralement plutôt de nature « esthétique » que « conceptuelle » ou « philosophique », et dépendra largement de la culture, de la sensibilité et des références cinématographiques des différents spectateurs : tous perçoivent sans aucun doute la caméra portée à l’épaule dans Rosetta comme les mouvements souples et sinueux de la caméra (sur steadicam [33]) dans Elephant (Gus Van Sant, USA, 2003) qui suit ou parfois précède plusieurs adolescents dans leurs longues déambulations à travers les couloirs de leur école, mais ces manières de faire, outre qu’elles peuvent être appréciées très différemment (remarquables pour les uns, irritantes pour les autres), susciteront sans doute autant d’interrogations que d’interprétations différentes.
Les indices de la présence de l’auteur ou, si l’on veut, les « marques de l’énonciation » [34], qu’on a évoqués jusqu’à présent, sont généralement localisés, visibles ou audibles à des endroits précis du film, mais sont en fait difficiles à interpréter en eux-mêmes, indépendamment du contexte où ils apparaissent : ce sont des traits « remarquables », qu’on perçoit (assez) facilement (notamment si on a appris à les repérer) mais pour lesquels il n’existe pas de « règles » d’interprétation univoque (c’est d’ailleurs le cas, on l’a vu, de pratiquement tous les éléments filmiques). Ainsi, les cadrages obliques dans Slumdog Millionaire peuvent être vus aussi bien comme une manière d’insister sur la dimension de souvenir subjectif des événements mis en scène (puisque le personnage principal se souvient de son enfance et adolescence), que comme une façon de dynamiser la narration ou au contraire une forme d’esthétisme ou de maniérisme gratuit et superficiel (comme l’affirment les détracteurs du film). Ici non plus, aucun spécialiste du cinéma ne peut déterminer de manière univoque ou certaine le sens de ces « marques » qui peuvent effectivement être interprétées très différemment par les uns et les autres.

Raining Stones de Ken Loach
De façon plus essentielle, on peut même penser qu’il y a un hiatus entre la mise en évidence de ces indices et l’interprétation plus générale des intentions de l’auteur du film, car ces indices, très localisés, ne « fonctionnent » pas seuls et, pour être interprétés, doivent être reliés à l’ensemble du film et notamment aux différents éléments du récit (événements, personnages, informations diverses données par l’image et la bande-son). Ainsi, il est pratiquement impossible de passer du point de vue de la caméra (sur lequel insistent la plupart des analystes) au « point de vue » (au sens le plus large) de l’auteur qui ne se réduit pas au seul choix du cadrage et dont les « intentions » sont lisibles à travers bien d’autres éléments filmiques : on remarque par exemple facilement qu’il n’est pas nécessaire d’analyser en détail les positions de la caméra dans des films comme Riff Raff ou Raining Stones de Ken Loach (Grande-Bretagne, 1991 et 1993) pour comprendre que ce sont là des critiques acerbes de la politique thatchérienne. On remarquera qu’il s’agit bien dans ce cas du propos (au sens le plus large) de l’auteur du film et non pas des personnages qui n’expriment aucune opinion politique explicite.
Mais comment passons-nous alors du niveau des personnages, seuls présents dans le film, à celui de l’auteur dont nous reconstituons sans grande difficulté le point de vue supposé sans recourir apparemment à ces « marques de l’énonciation » (plus ou moins) explicites mais relativement localisées ? Un tel changement de niveau implique nécessairement une mise à distance des personnages et de l’intrigue dans laquelle ils sont pris, mise à distance qui suppose la prise en considération d’informations ou d’éléments extérieurs au récit et au point de vue des personnages. Cette distanciation peut être par exemple de nature historique, l’écart temporel nous permettant de comprendre un contexte dont les personnages ne sont pas conscients : lorsque, dans la Liste de Schindler de Steven Spielberg (Schindler's List,USA, 1993), des Juifs du ghetto de Cracovie, dépouillés de tous leurs biens et affamés par les nazis, déclarent que « la situation ne pourrait pas être pire », nous savons comme spectateurs que ces pauvres gens se font malheureusement encore des illusions et que le pire est effectivement à venir : bien entendu, nous faisons l’hypothèse immédiate que l’auteur du film, qui partage un point de vue similaire au nôtre, a voulu à travers cette réplique révéler l’illusion dans laquelle sont pris les personnages. Dans ce cas, c’est donc un savoir historique qui nous permet facilement de prendre une distance par rapport au point de vue des personnages et de « remonter » au niveau de l’auteur du film.

Mon Oncle de Jacques Tati
L’humour nous permet aussi de nous distancier facilement des personnages qui, le plus souvent, ne sont pas conscients de se trouver dans une situation comique ou d’être un objet de ridicule. Dans Mon oncle de Jacques Tati (France, 1958) par exemple, c’est la comparaison implicite entre l’attitude des Arpel et un comportement considéré comme « normal » qui nous fait prendre conscience de l’aspect satirique du film : quand madame Arpel, au lieu de se diriger directement vers l’amie qui lui rend visite, suit le chemin dallé en S dans le jardin, ce trajet bizarre, qu’accentue encore la gestuelle — bras levés — des deux personnages, ne paraît pas « anormal » à leurs yeux, mais bien aux nôtres et à ceux de l’auteur du film. La mise en scène (direction des acteurs, cadrage, travail sur la bande-son [35]…) souligne sans doute le comique implicite de la situation, mais c’est bien la référence à une norme de comportement, extérieure au film lui-même, qui nous permet de nous distancier de façon critique et ironique de la situation.
Une telle mise à distance n’est pas nécessairement contradictoire avec le processus d’identification aux personnages dont nous pouvons nous sentir très proches par ailleurs. Dans les films de Ken Loach qu’on vient d’évoquer, notre sympathie va (en général) aux personnages principaux qui sont montrés comme les victimes d’un système économique particulièrement injuste et cruel (alors que les profiteurs du système comme les usuriers sont des êtres abjects et sans scrupules) ; mais, par rapport aux personnages enfoncés dans les ennuis jusqu’au cou, le film nous permet à la fois d’appréhender une situation sociale sans issue et de porter un jugement politique (au sens large) sur les responsables (supposés) d’une telle situation. Peut-être le personnage serait-il capable lui aussi de formuler un tel jugement, mais, pris dans l’urgence de l’action, il n’en a guère le loisir, contrairement au spectateur qui, à travers le destin singulier mis en scène, est invité à réfléchir sur les conditions sociales qui rendent de telles situations possibles. On voit d’ailleurs que la distanciation s’accompagne ici d’une généralisation sur base d’un cas jugé sans doute exemplaire (même s’il comporte une part fictive) : l’histoire de Bob dans Raining Stones n’a pas de valeur en elle-même [36], et nous l’interprétons comme significative d’une situation beaucoup plus large, commune à tous les laissés-pour-compte de l’ère thatchérienne en Grande-Bretagne (et ailleurs ?).
La comparaison entre un film et la « réalité » (que, le plus souvent, nous ne connaissons pas directement mais à travers d’autres sources d’informations comme les journaux ou la télévision) implique nécessairement une prise en considération du point de vue de l’auteur qui est le responsable de la mise en scène de cette réalité et des éventuelles transformations (que celles-ci soient jugées positivement ou négativement) que cette représentation impose au réel. Ainsi, certains critiques ont pu estimer que le personnage volontaire et énergique de Rosetta dans le film des Dardenne, bien décidée par tous les moyens à trouver du travail, était peu représentatif des personnes sans emploi qui, dans notre société, apparaissent plutôt démotivées et résignées à leur sort, se contentant des maigres ressources qu’on leur octroie. Contrairement au cinéma de Ken Loach qui décrit à travers ses personnages le sort de tout un groupe social, celui des Dardenne se concentre, si l’on suit une telle analyse, sur le destin singulier d’un individu qui, d’une manière ou d’une autre, se « raidit » contre les conditions qui sont les siennes. Ici aussi, comprendre le point de vue de l’auteur implique une certaine mise à distance du personnage dont nous pouvons partager les émotions (même si le personnage n’est pas nécessairement « aimable », notamment au début du film), mais dont nous sommes amenés à questionner le comportement par exemple en le comparant à nos propres réactions (supposées) dans une situation similaire : la violence des premières réactions de Rosetta dans la première séquence est ainsi suffisamment interpellante pour nous amener à nous interroger sur le sens d’un tel comportement.
Certains procédés de mise en scène comme la répétition des mêmes gestes anodins — Rosetta enfile des bottes pour rentrer dans le camping sordide où elle séjourne — contribuent bien sûr à cette distanciation (le geste est « naturel » pour la jeune fille mais souligné par les cinéastes), mais c’est l’ensemble du comportement (perçu comme problématique) du personnage qui permettra (éventuellement) au spectateur de reconstituer le point de vue des auteurs du film : l’interprétation de la mise en scène ne se fait donc pas uniquement en termes esthétiques (comme si on la qualifiait par exemple de « distanciée », de « froide » ou au contraire d’« énergique » ou de « dynamique ») mais en la reliant à l’ensemble du parcours du personnage principal. De manière générale, on constate que la majorité des spectateurs interprètent effectivement le point de vue de l’auteur du film à travers l’histoire et les personnages mis en scène ou, si l’on veut, comme un regard sur le monde, et ce n’est qu’exceptionnellement qu’une telle interprétation se fait en termes purement esthétiques ou cinématographiques : la représentation ne s’analyse pas indépendamment de l’objet de la représentation, et la « forme » n’est pas comprise indépendamment du « contenu ». Dans Rosetta, le choix du personnage — une jeune fille pauvre, isolée, en marge de la société, sans soutien familial —, loin d’être indifférent, est évidemment perçu comme pleinement significatif, révélateur du regard que les cinéastes portent sur le monde, et l’on imagine mal les Dardenne posant un jour leur caméra dans l’univers de la haute bourgeoisie pour réaliser une comédie sentimentale…

Pas un de moins de Zhang Yimou
Si l’interprétation du point de vue de l’auteur du film implique nécessairement une certaine distanciation par rapport aux personnages de la fiction, cette interprétation n’est cependant pas toujours évidente. Certaines procédures, comme la généralisation déjà évoquée, sont aisées à mettre en œuvre ; c’est également le cas de l’explicitation des jugements de valeurs véhiculés par un film (explicitation qui s’accompagne d’ailleurs souvent d’une forme de généralisation), et il n’est pas difficile de comprendre que des films comme Z de Costa-Gavras (France/Algérie, 1969) ou la Vie des autres de Florian Henckel von Donnersmarck (Das Leben der Anderen, Allemagne, 2006) constituent des critiques virulentes des régimes policiers évoqués ; semblablement, la découverte d’une réalité mal connue semble être la mission naturelle du documentaire mais apparaît également comme le propos essentiel de nombreux films de fiction, même si cela implique une large part de reconstitution (par exemple, Danse avec les loups – Dances with Wolves de Kevin Costner, USA, 1980, qui évoque la vie et les mœurs des Indiens des plaines, Qiu Ju, une femme chinoise ou Pas un de moins de Zhang Yimou, Chine, 1992 et 1999, qui décrivent la vie dans les campagnes chinoises complètement ignorées des villes en pleine modernisation). Mais ces procédures (ou d’autres) ne sont pas toujours utilisées à bon escient [37] ou ne suffisent pas à comprendre les intentions supposées de l’auteur du film.
Beaucoup de films — notamment ceux qu’on considère comme les plus « riches » — se caractérisent précisément par leur caractère (relativement) énigmatique, une difficulté d’accès et d’interprétation pour le spectateur, ou encore par différentes formes d’ambiguïté ou d’hermétisme. Même des films dont le propos semble évident peuvent d’ailleurs faire l’objet d’interprétations différentes, parfois polémiques : ce fut le cas par exemple de Mississippi Burning d’Alan Parker (USA, 1988), claire dénonciation d’un crime raciste commis par des membres du Ku Klux Klan en 1964 pendant le combat pour les droits civiques, mais qui fut pourtant dénoncé par un certain nombre d’activistes noirs comme véhiculant des stéréotypes négatifs et dévalorisants pour leur communauté, ou encore de La Liste de Schindler (Schindler’s List, USA, 1993) dont le réalisateur Steven Spielberg fut notamment accusé de se complaire dans une représentation compassionnelle, souvent « obscène » et finalement édulcorée du génocide perpétré par les nazis (en ayant notamment choisi de se concentrer sur un groupe de survivants).
Mais, dans nombre de cas, les différences d’interprétation résultent moins de divergences d’opinions que du caractère volontairement énigmatique ou ambigu du film en question. Un film peut en effet montrer des événements — comme un roman raconter une histoire — sans que le spectateur n’en comprenne le sens ou du moins ne puisse en tirer une signification qui lui paraisse satisfaisante. Plusieurs facteurs peuvent expliquer de telles difficultés.
Des spectateurs peuvent s’étonner du comportement de certains personnages dont les motivations leur paraissent étranges ou incompréhensibles : très souvent en effet, nous jugeons du comportement d’autrui de façon étroitement normative en fonction de nos propres réactions, et nous admettons difficilement des attitudes qui s’éloignent de ces attentes spontanées. Ainsi, un personnage comme Rosetta, qui se signale par sa détermination et sa volonté de « sortir du trou », peut apparaître à certains comme « excessive » ou « hystérique ». Et quand, dans Disgrace de Steve Jacobs (Australie, 2009) adapté d’un roman de l’écrivain sud-africain John Coetzee, une jeune femme renonce à porter plainte contre ses violeurs et semble même pactiser avec le groupe dont ils font partie, d’aucuns peuvent manifester leur totale incompréhension même si le film décrit par ailleurs tout le poids laissé par l’apartheid sur les différents membres de cette société profondément divisée. On peut également se souvenir des films qui ont rendu célèbre Antonioni (notamment de sa trilogie L’Avventura, La Notte et L’Eclisse, mais également d’Il Deserto Rosso), rapidement qualifié de cinéaste de « l’incommunicabilité », ce qui était sans doute une manière facile de mettre un mot sur des personnages dont le malaise ou le mal-être semblait particulièrement énigmatique à de nombreux spectateurs.

L'enfant de Jean-Pierre et Luc Dardenne
© Christine Plenus
Un film peut également poser des questions sans y donner de réponses satisfaisantes pour certains spectateurs. Ici aussi, viennent à l’esprit certains films d’Antonioni comme l’Avventura qui évoque la disparition mystérieuse d’une jeune femme sur une île en Méditerranée, mais semble rapidement abandonner cette intrigue pour se concentrer sur la relation amoureuse entre deux compagnons de la disparue, ou comme Blow Up, où un photographe croit voir, sur une photo qu’il a faite dans un parc, les indices d’un crime dont il découvrira un peu plus tard la victime mais dont l’énigme, loin d’être résolue, s’épaissira progressivement. La manière brutale dont les frères Dardenne terminent plusieurs de leurs films (Rosetta, 1999, L’Enfant, 2005, Le Silence de Lorna, 2008,…) surprend également nombre de spectateurs qui s’attendent à un épilogue plus explicite sur le sort des différents personnages.
Par ailleurs, la pertinence du récit mis en scène peut dans certains films apparaître comme problématique : pourquoi raconter cette histoire ? quel en est le sens ou la portée ? quelle est la logique ou la cohérence du récit ? quel intérêt (psychologique, philosophique ou simplement humain) peut-on trouver à cette histoire ou à certains de ses éléments ? On peut bien sûr évoquer le film culte de Stanley Kubrick 2001 : l’odyssée de l’espace (2001 : A Space Odyssey, USA, 1968) dont le succès planétaire ne doit pas masquer l’incompréhension qu’il a également suscitée (et suscite encore) chez de nombreux spectateurs. Et les films récents de David Lynch (Lost Highway, 1997, Mulholland Drive, 2001, Inland Empire, 2007), dont le récit semble incohérent, mélangeant volontairement l’imaginaire et le « réel », ont également suscité des critiques parfois virulentes à l’encontre de leur auteur accusé par certains spectateurs aussi bien de snobisme que de vouloir se moquer du public [38]…
Enfin, certains choix de mise en scène, parfois très visibles, seront difficiles à interpréter pour de nombreux spectateurs : ainsi, tout le monde remarque dans Elephant de Gus Van Sant (USA, 2003) les longs plans-séquences où la caméra suit avec obstination un même personnage de dos, ou bien la répétition des mêmes scènes vues sous des angles différents en suivant des personnages qui se croisent un bref instant, mais ces procédés apparaissent à beaucoup comme artificiels, sans réelle pertinence ni intérêt. Ils semblent « gratuits », c’est-à-dire qu’on ne parvient pas à leur donner un sens en rapport avec les événements représentés ni avec les intentions supposées du cinéaste (sinon encore une fois en l’accusant de snobisme ou de prétention). D’autres en revanche seront sensibles à la maîtrise technique du cinéaste ou au rythme lancinant qu’il parvient à donner aux incidents de cette journée qui débute de la plus banale des façons, ou encore à la retenue d’une caméra qui se refuse à tout commentaire et laisse à chacun la responsabilité de trouver un sens à l’inexplicable (une tuerie dans une école américaine). On remarque d’ailleurs que les interprétations des choix de mise en scène ne sont pas nécessairement très élaborées et font moins appel à des « significations » explicites, verbalisables, qu’à une « sensibilité » générale qu’on suppose être en accord avec celle de l’auteur du film : ainsi, la « lenteur » du film n’a pas besoin d’être longuement commentée ni justifiée pour être appréciée comme un choix stylistique évidemment intentionnel qui est simplement ressenti comme juste ou pertinent dans le contexte du film. Dans ce cas, le spectateur se réfère néanmoins implicitement à une « sensibilité commune », qui résulte soit d’un choix plus ou moins conscient (« j’aime ou je supporte la lenteur parce que ça convient au propos du film »), soit d’une habituation plus ou moins longue (« j’aime ce genre de films au rythme ralenti, différents des films d’action spectaculaire »), soit d’une combinaison des deux [39].

4 mois, 3 semaines, 2 jours de Cristian Mungiu
Dans les différents cas évoqués, trouver un sens à un film (ou au contraire ne pas en trouver) consiste, d’abord à s’interroger sur les intentions de l’auteur, puis à relier ces intentions supposées à un contexte plus général, extérieur au film, de nature philosophique, politique, morale, esthétique ou simplement humaine… et l’incompréhension survient précisément lorsqu’une telle liaison paraît impossible à établir. Un dernier exemple, un peu plus détaillé, permettra d’éclairer ce processus. Le film de Christian Mungiu, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, Palme d’or au festival de Cannes 2007, a reçu généralement un accueil très positif de la critique, mais beaucoup ont relevé une séquence « choc », dérangeante, qui semblait ne pas « cadrer » avec l’ensemble de l’histoire mise en scène : alors que le film évoque la situation de deux jeunes femmes contraintes dans la Roumanie dictatoriale de Ceausescu de recourir à un avortement clandestin dans des conditions dramatiques, la caméra montre pendant quelques longues secondes le fœtus mort, expulsé mais largement formé, sur les carreaux de la salle de bains. Cette scène semble en effet en contradiction avec une « première » lecture du film qui se présente comme une dénonciation évidente du régime de Ceausescu et de sa répression brutale de tout avortement : l’image violente du fœtus mort apparaît comme particulièrement cruelle et peut être vue comme une condamnation implicite de l’avortement (les groupes anti-avortement utilisent d’ailleurs ce genre d’images pour émouvoir le public qu’ils visent). Les spectateurs qui admirent le film et qui sont en faveur d’une libéralisation de l’avortement sont alors obligés de recourir à une explication de type cinématographique ou esthétique : on pensera par exemple que le cinéaste n’a pas voulu « édulcorer » la réalité, qu’il a voulu en montrer toutes les facettes, toute l’ambiguïté, toute l’ambivalence… On suppose ainsi que le propos du cinéaste est moins « idéologique » (dénoncer la dictature de Ceausescu) qu’esthétique et que toute sa mise en scène est guidée par un souci de réalisme au sens le plus fort du terme ; de façon plus large, on peut alors relier cette démarche à une certaine conception de la « réalité » (défendue notamment dans le champ cinématographique) comme se situant toujours au-delà (ou en deçà) de la signification (perçue comme idéologie ou stéréotype) qu’on peut lui attribuer (ce qu’on peut énoncer de façon plus prosaïque en affirmant que la réalité est toujours « brute », « complexe », « ambiguë », « ambivalente », « contradictoire », « tragique » même) [40].
Bien entendu, la capacité à relier les intentions (supposées) de l’auteur à un contexte plus large et donc à trouver un sens au film varie fortement selon les spectateurs [41] et leurs connaissances cinématographiques mais aussi sociales, culturelles, historiques ou autres. Ainsi, reconstituer le point de vue de l’auteur du film comporte nécessairement, on l’a suffisamment montré, une part d’hypothèse qui dépend de la diversité des contextes auxquels on peut faire référence mais également de la « complexité » d’un film comportant plusieurs dimensions et de multiples éléments qui peuvent être faiblement reliés entre eux (notamment dans le cas d’œuvres volontairement hermétiques).
En situation de débat se pose nécessairement à un moment ou l’autre la question des intentions de l’auteur. Néanmoins, comme on a essayé de le montrer, cette question est souvent plus complexe et plus hypothétique qu’il n’y paraît à première vue.
Ainsi, de nombreux spectateurs confondent facilement le point de vue des personnages et celui de l’auteur, et ils jugent même parfois le cinéaste à l’aune du comportement des personnages mis en scène… Si ceux-ci font évidemment partie du sens du film, il convient néanmoins de s’interroger sur l’écart qu’il existe nécessairement entre les faits représentés et l’auteur qui a choisi de les représenter de telle ou telle manière : sans adopter une attitude de soupçon systématique, il est souvent intéressant d’insister sur cette distance entre auteur et personnages, qui peut prendre de multiples formes. Quelques exemples éclaireront ce point.
On connaît le succès populaire extraordinaire des premiers westerns de Sergio Leone (comme Et pour quelques dollars de plus ou Le bon, la brute et le truand), dû certainement — entre autres choses — à leur personnage principal (incarné par Clint Eastwood), pistolero taciturne et ironique, bravant sans crainte apparente la mort qu’il semait à son tour sans autres états d’âme. Paradoxalement, cet irréalisme s’accompagnait de marques de « réalisme » au niveau des décors (la poussière…), des habits (la saleté), du corps et des visages (le teint mat, la sueur, la fameuse barbe mal rasée). Ces différents procédés ont sans doute entraîné, notamment chez les jeunes spectateurs, un fort processus d’identification qui a masqué à son tour la dimension ludique, ironique, presque parodique de ces westerns (également qualifiés d’opératiques) comme cela apparaîtrait plus clairement dans les réalisations ultérieures de Leone, Il était une fois dans l’Ouest (Once Upon a Time in the West, 1969) et Il était une fois la révolution (Giu la Testa, 1972), dont le succès fut d’ailleurs plus mitigé [42]. Bien que l’on ne puisse sans doute pas prétendre que l’identification aux personnages constituât une erreur (elle était au contraire essentielle à la participation émotionnelle des spectateurs), l’on perçoit néanmoins que le point de vue de l’auteur sur ses personnages est nettement décalé et s’apparente à ce qu’on pourrait appeler un exercice formel sinon maniériste.
Dans d’autres cas cependant, le point de vue des personnages et celui de l’auteur peuvent se révéler non seulement différents mais réellement contradictoires. French Connection par exemple de William Friedkin (1971) met en scène un policier, Jimmy Doyle, surnommé Popeye et incarné par Gene Hackman, qui est accusé au début du film par un collègue d’être responsable de la mort d’un coéquipier suite à une de ses « intuitions » ; mais tout le début du film nous porte à croire précisément que, face au scepticisme de ses supérieurs, Popeye a précisément les « bonnes intuitions » alors qu’on nous montre en parallèle la mise sur pied d’un important trafic de drogue (la « French Connection »). Pourtant, à la fin du film, alors qu’il est à la poursuite du chef de ce trafic, il abat un de ses collègues par erreur. Rien ne nous sera montré pratiquement des conséquences de ce geste sauf le générique qui nous apprendra que Doyle et son coéquipier ont été ensuite mutés, mais rétrospectivement, l’on peut penser que le collègue obtus du début du film avait sans doute (au moins partiellement)raison et que, par son comportement, Popeye prenait en effet des risques inconsidérés et mettait en particulier les autres enquêteurs en danger. Autrement dit, on peut penser que le cinéaste, loin de vouloir provoquer une forte identification au personnage, entendait plutôt susciter un questionnement à son propos ainsi que sur les limites ambiguës entre le bien et le mal. Si cette interprétation est juste (car elle peut également prêter à discussion), on voit que l’identification aux personnages peut masquer le véritable propos.

Entre les murs de Laurent Cantet
Le film de Laurent Cantet, Entre les murs, Palme d’or au Festival de Cannes en 2008, illustre sans doute une confusion similaire. Le scénario de ce film, qui raconte le quotidien de la vie d’un collège de la région parisienne, s’inspire d’un ouvrage que François Bégaudeau a tiré de sa propre expérience ; en outre, Bégaudeau joue un des rôles principaux — celui de l’enseignant — de ce film qui reste néanmoins une fiction mise en scène en tant que telle par Laurent Cantet. Or, dans les polémiques qui ont accompagné le succès du film, beaucoup se sont focalisés sur la personnalité de cet enseignant pris comme un modèle — ou un « contre-modèle » — de pédagogie ou de « pédagogisme » selon les options idéologiques des uns ou des autres. Pourtant, plusieurs indices, et notamment la construction du scénario, laissent à penser, si l’on prend un peu de distance, que le propos du cinéaste mais aussi de son scénariste, François Bégaudeau revenant a posteriori sur sa propre expérience, est précisément de relever les « erreurs » que ce dernier a pu commettre comme jeune enseignant (en particulier traiter des adolescentes de « pétasses »), et de saisir les mécanismes institutionnels à l’intérieur de la classe et de l’école qui vont conduire en particulier à l’exclusion d’un élève « difficile » : ainsi, loin d’être un « modèle », l’enseignant est plutôt pris ici comme un objet d’analyse et de réflexion sur le fonctionnement général d’une institution comme l’école.
Ces trois exemples, qui illustrent en particulier la différence entre le point de vue des personnages et celui de l’auteur, suffisent à montrer la diversité des intentions possibles chez l’auteur d’un film, qui peuvent relever aussi bien de l’esthétique (chez Leone) que de la morale (chez Friedkin) ou de la réflexion sur une réalité problématique (chez Laurent Cantet). Cette diversité existe bien sûr entre les réalisateurs qui poursuivent des objectifs très différents, mais également chez un même réalisateur dont le projet ne se résume pas nécessairement à une intention claire et univoque et dont le propos se présente plutôt de façon multiforme (sans être nécessairement contradictoire) : même si un lieu commun de la critique postule qu’il doit y avoir une adéquation ou une cohérence entre le « fond » et la « forme » dans les grandes œuvres d’art, les choses ne sont pas toujours aussi simples ni aussi évidentes, et il y a généralement plusieurs approches possibles d’un même film, différentes manières de l’analyser et de le juger : on peut par exemple admirer le travail de mise en scène audacieux de Laurent Cantet dans Entre les murs (avec en particulier son utilisation d’acteurs non professionnels interprétant des rôles proches de ceux qui sont les leurs dans la vie courante, mais néanmoins différents) sans nécessairement partager son interprétation du fonctionnement institutionnel de l’école. Même si ces deux dimensions ne sont pas totalement indépendantes l’une de l’autre, les deux « projets » ne sont pas non plus réductibles l’un à l’autre et relèvent sans doute d’une analyse différente [43]. À cette diversité d’intentions s’ajoute enfin, comme on l’a vu, une diversité des voies d’interprétation possibles : les intentions d’un auteur ne sont jamais directement lisibles ou visibles dans son film et peuvent donner lieu à des interprétations différentes sinon parfois opposées.
Ce sera sans doute un des rôles importants de l’animateur d’attirer l’attention des spectateurs sur cette complexité de l’interprétation de ce que l’on a appelé le niveau de l’auteur du film : l’expérience montre en effet que beaucoup de spectateurs procèdent à ce niveau à des interprétations que l’on peut qualifier de sommaires, sur base d’un nombre limité d’éléments filmiques en procédant à des inférences (comme des généralisations) rapides et parfois douteuses et en confondant facilement le point de vue de l’auteur avec celui des personnages mis en scène. Au cours de la discussion, il faudra donc permettre l’expression de la diversité des opinions au sein même du public, mais également suggérer des interprétations peut-être moins évidentes, plus nuancées ou plus complexes : la presse, spécialisée ou non, des interviews éventuelles du réalisateur, une vision répétée du film en cause, permettront sans doute à l’animateur de faire de telles suggestions en rappelant (et en se rappelant [44]) le caractère nécessairement hypothétique de toute interprétation.
Les films n’existent pas seuls, et ils sont accompagnés au moment de leur sortie (et même avant) de tout un appareil de promotion (affiches, bandes-annonces, photos…) mais également d’une série de critiques dans la presse spécialisée ou générale ainsi que dans divers médias comme la télévision ou Internet. Il n’est d’ailleurs pas toujours facile de distinguer la pure publicité de ce qui relèverait de l’exercice critique désintéressé : dans le même journal, on peut trouver par exemple un article d’évaluation critique (parfois négative) d’un film accompagné sur la même page ou quelques pages plus loin de l’interview d’un acteur célèbre dont les propos ne servent guère qu’à promotionner ce film où il apparaît. De manière circulaire, la promotion sert le film mais également le journal lui-même qui mettra en avant cette interview plus ou moins exclusive d’un acteur célèbre…
Néanmoins, même si la frontière n’est pas étanche, l’exercice critique, qui comprend pour une part une prescription d’opinion, se distingue de la simple publicité en ce qu’il constitue une réaction, un après-coup à la vision du film ou encore ce que d’aucuns appellent un « partage social des émotions » [45] suscitées par la projection. Alors que la promotion vise évidemment à susciter la curiosité et la consommation, la critique relève de ce processus d’échange entre spectateurs, qu’on a déjà évoqué et qui suit la projection, souvent dans un délai rapproché (même si le « dialogue » avec le critique est indirect, que ce soit par la médiation de la lecture ou par l’audition d’une émission radio ou télévisuelle).
Lors d’un débat autour d’un film, il est donc normal qu’un intervenant évoque positivement ou négativement l’une ou l’autre critique lue ou entendue. Et l’animateur, qui souhaite utiliser un film comme instrument de dialogue, sera lui aussi généralement amené à consulter au préalable la littérature critique. Mais quelle légitimité, quel statut, quelle pertinence, quelle valeur peut-on ou doit-on accorder à la critique cinématographique ?
Le rôle de la critique est souvent analysé de façon théorique ou principielle (« ce que doit être une bonne critique »), mais il est sans doute préférable d’en donner d’abord une (brève) description historique en se limitant en outre au cas de la France (et accessoirement de la Belgique et d’autres pays francophones) : il est en effet pratiquement impossible de comprendre la critique, dont le rôle consiste en particulier à établir des hiérarchies de valeur, sans tenir compte des personnes mêmes qui émettent ces jugements, et de leur place dans un champ intellectuel traversé par des intérêts divers et des conflits multiples.
Ainsi, alors que le cinéma est d’abord apparu comme un loisir essentiellement populaire, le champ de la critique, qui s’est peu à peu affirmée à partir du début du 20e siècle, a défendu rapidement l’idée que le cinéma devait être considéré comme un art nouveau, foncièrement différent de tous les autres arts reconnus à l’époque (on attribue l’invention de l’expression « Septième Art » à l’écrivain italien Ricciotto Canudo qui, dans le Manifeste des sept arts publié en 1923, oppose déjà les « artistes » aux « industriels »). Autrement dit, le pôle critique s’est d’abord construit autour de l’opposition entre l’art et l’industrie (selon la célèbre formule d’André Malraux), mais aussi entre les goûts spontanés du large public et un cinéma aux exigences ou aux ambitions plus hautes dont il s’agissait de soutenir l’essor ou le développement (qu’il s’agisse de l’avant-garde « impressionniste » des années 20, du surréalisme des années 30 ou de la Nouvelle Vague à la fin des années 50).
Cette tension va prendre de multiples formes qu’il n’est pas possible de détailler ici, et il importe seulement de comprendre que le champ de la critique est aujourd’hui dominé par un pôle intellectuel et/ou savant dont les principes s’éloignent de façon plus ou moins marquée des goûts majoritaires [46] du public des cinémas (public dont il faut cependant aussi reconnaître la diversité). En France, ce champ s’organise autour de quelques revues prestigieuses (Les Cahiers du Cinéma, Positif) dont les avis sont relayés ou partagés par des journaux cultivés ou des revues généralistes (Le Monde, Libération, Rolling Stone…) ainsi que par les nombreuses sections d’études cinématographiques dans les universités et les écoles d’enseignement supérieur [47]. Il s’agit de vastes réseaux parfois organisés autour d’institutions renommées (comme les cinémathèques) mais surtout fondés sur la familiarité et le partage de valeurs communes.
On peut douter de l’importance de la critique cinématographique et en particulier de la « domination symbolique » (pour utiliser une expression du sociologue Pierre Bourdieu) qu’elle exercerait sur le large public, mais, même si elle est difficilement mesurable, cette domination est suffisamment prégnante pour s’exercer en certains lieux aussi renommés et célébrés (notamment par les médias) que le Festival de Cannes : ainsi, chaque année, la Palme d’or récompense un film qui est généralement applaudi par la critique (même s’il y a des exceptions) mais qui aurait certainement touché un beaucoup moins large public sans une telle récompense (la comparaison avec la cérémonie des Oscars aux États-Unis est sur ce point éclairante, puisque ces prestigieuses statuettes consacrent en fait des réalisations déjà plébiscitées par le public ; à l’inverse, la critique picturale n’a pas quant à elle besoin de s’affirmer contre les goûts du grand public qui ne s’intéresse pas dans sa large majorité à la peinture contemporaine).
Le champ de la critique cinématographique présente certainement un éventail de positions depuis les plus pointues ou d’avant-garde (qui se retrouvent dans des lieux réservés comme les musées, les colloques universitaires ou les festivals spécialisés) jusqu’aux plus éclectiques ou les moins radicales (qu’on peut lire par exemple dans la presse quotidienne et populaire), mais il reste fondamentalement dominé par le pôle qui s’affirme par son opposition au cinéma de loisir ou de divertissement immédiat. Ainsi, dans un débat, la référence (que ce soit le fait de l’animateur ou d’un participant) à l’un ou l’autre jugement critique entraînera presque immanquablement le soupçon de « snobisme » ou de « prétention » ou encore de « collusion bien-pensante » ; et les critiques, quels qu’ils soient d’ailleurs, seront facilement accusés d’être coupés du « vrai » cinéma, d’applaudir à des œuvres « ennuyeuses », d’aimer « le laid, le vulgaire et le misérabilisme » ou encore de se complaire dans un « anti-conformisme de principe » (pour relever quelques expressions répandues sur les forums consacrés au cinéma). À l’inverse d’ailleurs, le succès d’un film suscitera des réactions critiques souvent excessives qui dénonceront les « mauvaises raisons » de ce succès auprès du public et soupçonneront le film en question de véhiculer plus ou moins sournoisement les pires valeurs du conformisme et de la médiocrité (ainsi, on se souvient qu’un critique a pu qualifier le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de « clip fasciste » tandis qu’un autre traitait les Choristes de « sombre merde », ces deux réactions intervenant non pas à la sortie des films mais lorsqu’ils ont connu un succès relativement imprévu).
Pour l’animateur, il ne s’agira évidemment pas de prendre parti pour les uns ou pour les autres mais de favoriser autant que faire se peut le dialogue entre les participants en évitant notamment les caricatures et les simplifications abusives. Cependant, un tel dialogue n’est possible que si l’on connaît les raisons qui motivent les choix et plus particulièrement les grandes tendances de la critique dont l’histoire est évidemment étroitement liée à celle du cinéma. On essayera ici d’en dresser un bref panorama (malheureusement simplificateur…) en essayant de dégager les principes généraux qui guident ces différentes tendances critiques.
Comme on l’a vu précédemment, une des premières tâches de la critique a été de définir la spécificité du cinéma par rapport aux autres arts qui l’ont précédé, et en particulier de déterminer quel est le véritable auteur d’un film qui reste par ailleurs une œuvre collective. Cette première tendance critique a donc valorisé le rôle du metteur en scène (ou du « réalisateur ») — en opposition notamment aux scénaristes — et a mis l’accent sur les traits filmiques où se manifestait (ou se « lisait ») le plus clairement son intervention comme le cadrage et le travail sur l’espace, la lumière et la « photographie » (par exemple dans l’expressionnisme allemand et le film noir américain), les mouvements de caméra (comme la célèbre ouverture de la Soif du Mal d’Orson Welles), l’utilisation de la couleur (dans les Damnés de Visconti ou le Désert rouge d’Antonioni aux couleurs… grisâtres), le montage (chez Eisenstein ou Dziga Vertov), la bande-son et ses différentes composantes (comme la musique de valse viennoise mise par Kubrick sur les images d’un vaisseau spatial dans 2001, l’odyssée de l’espace)…
C’est ainsi qu’on a commencé à parler d’une « grammaire du cinéma » ou d’un « langage cinématographique » dont la maîtrise apparaissait désormais comme essentielle à l’art de la réalisation filmique [48]. Un des premiers objectifs de la critique (notamment à travers le circuit des ciné-clubs) a alors été d’initier le public à ce travail spécifique du cinéaste dans la mesure où les éléments de ce « langage cinématographique » ne sont pas nécessairement perçus par la plupart des spectateurs ou lui semblent secondaires par rapport à d’autres dimensions du film (comme l’histoire racontée ou la présence d’acteurs à qui s’identifier). Cela implique cependant une compréhension du processus de réalisation et du rôle de chaque intervenant (cinéaste, acteurs, scénariste, techniciens…) dans ce processus : il faut en effet connaître un minimum les difficultés de tournage d’un plan séquence comme celui de l’ouverture de la Soif du mal pour en apprécier la virtuosité comme pour mesurer la nouveauté que constituait l’utilisation de la steadicam dans Shining de Stanley Kubrick ; à l’inverse, les extraordinaires trucages numériques qui sont à l’œuvre aujourd’hui dans la plupart des films hollywoodiens ne sont généralement pas reconnus comme de véritables créations artistiques parce qu’ils sont seulement le fait de techniciens et non pas du réalisateur lui-même, même si ce dernier en garde la maîtrise finale en les mettant au service de son projet global. Semblablement, dans cette perspective critique, le rôle des acteurs ou des scénaristes est considéré comme secondaire (ou même dévalorisé) au profit de celui des cinéastes et de ce qui est désormais considéré comme « spécifiquement » cinématographique ou relevant proprement du « langage cinématographique » [49].

Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene
Une telle explication est cependant plus facile à mettre en œuvre avec certains films qu’avec d’autres, et, par exemple, l’importance de la lumière et des éclairages sera plus visible dans un film expressionniste allemand que dans un western hollywoodien des années 1950. Semblablement, l’abondance des gros plans dans la Passion de Jeanne d’Arc de Carl Dreyer (1928) sera sans doute aperçue par de nombreux spectateurs (surtout s’ils sont un peu avertis) alors que les cadrages chez John Ford ou Howard Hawks apparaîtront à beaucoup comme beaucoup plus « classiques » sinon peu remarquables. Ainsi encore, l’habileté des mouvements de caméra chez Max Ophuls (La Ronde, 1950, ou Madame de…, 1953) ou bien chez Gus Van Sant (Elephant, 2003) sera facilement reconnue bien que l’on ne puisse pas considérer qu’un film tourné en plans fixes (comme 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Cristian Mungiu, 2007) soit pour cela une réalisation « sans qualités »…
Cet accent mis sur les moyens d’expression propres au cinéma tend ainsi à valoriser des œuvres « formalistes », sans doute très élaborées mais où la « forme », travaillée parfois jusqu’à l’excès, importe beaucoup plus que le « contenu » : c’est le cas dès 1920 avec un film comme le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene dont les décors peints et artificiels, les perspectives déformées, l’étrangeté des personnages mis en scène, la colorisation arbitraire de certaines séquences concourent à en faire une œuvre « expressionniste » dépourvue de tout souci de réalisme. Le film, qui a fait forte impression et qui est depuis lors considéré comme une date importante de l’histoire du cinéma, apparaît également à beaucoup comme une impasse pour le cinéma.
Contre cette tendance « formaliste » (qu’il s’agisse de cinéastes à proprement parler ou de critiques), d’autres vont privilégier — très tôt d’ailleurs — les thématiques filmiques et leur analyse. Si, par exemple, les courts métrages de Charlot (The Tramp en 1915, The Vagabond en 1916, The Immigrant en 1917) font rapidement le succès public de Charles Chaplin, l’on sait bien aussi que la véritable reconnaissance critique viendra avec des œuvres plus ambitieuses notamment en termes de contenu, qu’il s’agisse du Kid (1921), de l’Opinion publique (1923), des Temps modernes (1936) ou encore du Dictateur (1940). De façon similaire, les films d’Ingmar Bergman, révélé en Europe et dans le monde à partir de 1956 avec Sourires d’une nuit d’été mais surtout le Septième Sceau et les Fraises sauvages, impressionnent le public cinéphile d’abord par la gravité des sujets abordés et par le pessimisme qui s’en dégage. Même si tous les critiques affirment l’importance de la mise en scène qui seule donne « corps » aux thèmes traités, les grands cinéastes — comme d’ailleurs les grands romanciers — se reconnaissent semble-t-il aussi au fait qu’ils ne se limitent pas à distraire le public mais qu’ils proposent une « vision du monde », qu’ils « questionnent la société » où ils vivent, ou bien qu’ils traitent de « problématiques » humainement importantes : qu’il s’agisse de John Ford, d’Orson Welles, d’Antonioni, de Stanley Kubrick, de Ken Loach, des frères Dardenne, de Fassbinder ou de bien d’autres, il paraît impossible d’analyser les films d’un point de vue uniquement formel sans tenir compte des sujets dont ils traitent.

Ça commence aujourd'hui de Bertrand Tavernier (1999)
C’est ainsi que les rédacteurs d’une revue comme Positif se caractériseront par une sensibilité politique de gauche qui leur fera préférer des cinéastes dont les convictions sont proches des leurs comme Francesco Rosi, Bertrand Tavernier ou Robert Altman (même si cette revue défendra une grande diversité d’auteurs qui ne se définissent pas uniquement par leur sensibilité « politique »). Cette approche thématique reste en fait dominante dans le champ de la critique et se retrouve d’ailleurs parmi le large public des ciné-clubs puis des cinémas d’Art et Essai (au sens français du terme [50]) où les débats et discussions tournent généralement autour du « contenu » des films et de leur manière de représenter la réalité, mais beaucoup plus rarement sur les techniques proprement cinématographiques. Pour beaucoup de ces spectateurs qui demandent au cinéma autre chose qu’une simple distraction, la qualité du film se juge d’abord par l’importance des thèmes traités, par la validité du point de vue défendu par le réalisateur ou encore par la justesse (supposée) de la représentation des personnages et du monde où ils vivent.
On remarquera que la critique (qu’elle soit le fait de professionnels ou de simples spectateurs) joue alors un rôle essentiel dans l’interprétation des films : juger des thèmes d’un film implique en effet que l’on dépasse le niveau de l’intrigue comme le point de vue des personnages mis en scène pour se situer dans un contexte plus large constitué à la fois par le projet créatif ou le propos supposé du cinéaste — que veut-il nous dire ? quelles sont ses intentions ? —, par le monde ou la société où il s’inscrit — qu’est-ce que le film nous dit ou nous montre de la réalité ? que partageons-nous humainement avec les personnages mis en scène ? — mais également par l’ensemble des références culturelles, artistiques, cinématographiques, politiques que peut évoquer le film — comment celui-ci se positionne-t-il par rapport à d’autres films sur le même sujet, à d’autres médias, à d’autres discours sur les mêmes questions ? —. Ce double niveau est particulièrement évident dans les films de fiction qui nous racontent des histoires (en principe) originales et mettent en scène des personnages singuliers, mais dont nous devinons facilement que le propos est beaucoup plus large : nous comprenons immédiatement qu’un film comme Welcome de Philippe Lioret (2009), qui raconte l’odyssée d’un jeune Kurde décidé à traverser clandestinement la Manche à la nage pour rejoindre sa fiancée en Grande-Bretagne, nous « parle » (au sens le plus large du terme) du sort de milliers d’immigrés clandestins, même si quelques-uns d’entre eux seulement ont sans doute tenté une traversée similaire.
Le procédé le plus fréquemment utilisé pour interpréter ainsi les thèmes d’un film est celui de la généralisation, le destin singulier mis en scène dans la fiction valant pour tous les individus ou un grand nombre d’individus partageant la même situation ou les mêmes caractéristiques. C’est le cas d’un film comme celui de Philippe Lioret cité à l’instant mais également de beaucoup d’autres comme par exemple Ça commence aujourd’hui de Bertrand Tavernier (1999) qui évoque la paupérisation de la population d’une petite ville du nord de la France à travers l’évocation de la vie d’un instituteur confronté chaque jour à ce phénomène dramatique.
Mais l’interprétation doit souvent être plus complexe ou plus nuancée notamment lorsque la fiction met en scène des situations extrêmes ou exceptionnelles dont on devine qu’elles sont révélatrices d’une situation plus large sans qu’on puisse cependant les considérer comme représentatives d’un état de fait général. Ainsi, quand le même Bertrand Tavernier raconte, dans l’Appât (1994), la dérive meurtrière de deux jeunes gens qui usent des charmes de la petite amie de l’un d’eux pour séduire des hommes fortunés, puis les voler et les assassiner, ce fait divers sordide est évidemment exceptionnel même si l’on comprend aussi que les personnages poussent à l’extrême certaines tendances (jugées négativement par le cinéaste) comme l’individualisme et le consumérisme.

Looking for Eric de Ken Loach
Dans d’autres cas encore, la relation entre la fiction et l’interprétation qu’on peut en donner peut être encore plus distendue et relever de la métaphore ou de l’analogie. Ainsi, quand Ken Loach met en scène un postier dépressif dans Looking for Eric (2009), le sujet peut sembler éloigné de ceux que traite habituellement le cinéaste britannique attaché à la défense des ouvriers et des exploités, mais l’on peut aussi y voir une « image » du découragement ou de la lassitude qui affecte l’ensemble de la classe ouvrière face aux offensives néo-libérales. En même temps, l’identification du personnage qui trouve dans la figure d’Eric Cantona les ressources nécessaires pour sortir de sa dépression sonne comme un appel à une nouvelle solidarité dont ce footballeur serait le chantre puisqu’il entendait privilégier le jeu d’équipe sur son statut d’attaquant vedette.
L’interprétation ne porte d’ailleurs pas nécessairement sur la relation entre la fiction (personnages, récit…) et la réalité à laquelle elle se réfère plus ou moins directement : en effet, la critique va également le plus souvent interpréter les intentions de l’auteur du film ou en tout cas expliciter un propos qui n’est pas énoncé en tant que tel dans le film. Il n’est pas difficile par exemple de comprendre que Welcome de Philippe Lioret n’est pas seulement une évocation de la situation des migrants clandestins en Europe occidentale mais également une dénonciation des conditions de survie auxquelles ils sont réduits. Dans d’autres cas cependant, l’interprétation est moins évidente, et il peut par exemple y avoir discussion sur le sens d’un film aussi célèbre qu’Orange Mécanique de Stanley Kubrick (A Clockwork Orange, 1971) : même s’il serait abusif d’y voir une apologie de la violence (comme certains l’ont fait cependant), il n’est pas facile de trouver un sens univoque à cette histoire où un jeune délinquant particulièrement brutal est soumis à un conditionnement psychologique censé le débarrasser de ses pulsions agressives, traitement qui aboutit cependant à un échec. Doit-on y voir une leçon pessimiste sur la nature humaine ? ou bien une dénonciation de la folie d’une science qui se croit toute-puissante ? ou encore une fable sur le cynisme des hommes politiques prêts à toutes les manipulations pour exercer le pouvoir ? ou bien tout cela à la fois ?
Si certaines œuvres plus ou moins énigmatiques (comme celles de Kubrick) prêtent ainsi à discussion et donnent dès lors lieu à des interprétations plus ou moins élaborées, des critiques vont également s’attacher à trouver un signification non évidente à des œuvres en apparence faciles à comprendre et à en proposer des analyses originales, rompant de façon plus ou moins nette avec le « sens commun » : ainsi, la « politique des auteurs » défendue par les Cahiers du Cinéma a d’abord consisté à retrouver chez un certain nombre de cinéastes hollywoodiens (comme Howard Hawks ou Alfred Hitchcock), considérés jusque-là comme de simples artisans, des thématiques suffisamment prégnantes pour s’imprimer dans des réalisations en apparence très différentes. Ainsi, Howard Hawks, qui a fait des films dans pratiquement tous les grands genres cinématographiques de son époque — qu’il s’agisse du western, du film de guerre, de la comédie, du cinéma d’aviation, de la comédie musicale et même de la science-fiction — met toujours en scène (si l’on suit les analyses aujourd’hui couramment admises) des personnages profondément engagés dans leur activité professionnelle (au sens le plus large du terme) ; mais il privilégie également des « couples » de personnages physiquement contrastés (jeune/vieux, homme/femme, fort/faible…) mais spirituellement semblables en particulier dans leur volonté d’accomplir leur « mission ». Ce contraste crée bien sûr une dynamique narrative basée notamment sur l’opposition entre la réalité et l’apparence : les deux personnages, malgré leurs différences, vont se révéler unis au moment décisif de l’action. En même temps, l’on remarque que Hawks privilégie des individus qui refusent d’exprimer facilement leurs pensées et leurs sentiments, leurs gestes (parfois minuscules comme le fait d’allumer une cigarette qui prend par exemple une connotation sexuelle dans le couple formé par Humphrey Bogart et Lauren Bacall) parlant en définitive pour eux.
Cette approche, on le voit, suppose un travail d’interprétation important, impliquant notamment une comparaison entre les différents films d’un même auteur afin de dégager de telles constantes thématiques. Elle s’éloigne ainsi des conceptions courantes dans la mesure où, d’une part, elle met en évidence des éléments qui peuvent être facilement négligés par de nombreux spectateurs, et où, d’autre part, elle s’intéresse moins aux films eux-mêmes qu’à la personnalité de l’auteur qui est censée s’exprimer à travers ses différentes réalisations. En analysant les films de cinéastes pris dans le système de production hollywoodien, la « politique des auteurs » (telle qu’elle est défendue notamment par François Truffaut ou Claude Chabrol) cherche à montrer précisément que la personnalité de ces auteurs (tous les réalisateurs ne sont pas bien sûr considérés comme tels) est plus forte que les contraintes du système où ils travaillent, et qu’elle fonde en définitive l’originalité de leur œuvre. Elle s’appuie ainsi sur une conception artistique d’origine romantique qui valorise en particulier l’expression personnelle à travers la création artistique.
En argumentant ainsi, la critique tend cependant à considérer le cinéma à l’égal des autres arts (à cette époque, la comparaison avec la littérature est d’ailleurs permanente dans les Cahiers du Cinéma) et court le risque d’en nier la spécificité et la nouveauté. Parallèlement à la défense de la « politique des auteurs », on voit ainsi se développer, à l’intérieur même des Cahiers du Cinéma, une troisième approche critique qui mettra l’accent sur la différence « ontologique » (pour reprendre un terme utilisé par André Bazin) entre le cinéma et les autres arts ou moyens d’expression comme la littérature. Très tôt en effet, André Bazin a souligné le réalisme foncier du cinéma (comme de la photographie) qui est d’abord un enregistrement de la réalité par la caméra alors que les autres modes de représentation (comme la peinture figurative) recréent nécessairement la réalité et donc la manipulent, la transforment et lui impriment la personnalité de leurs auteurs. « Tous les arts, écrit André Bazin, sont fondés sur la présence de l’homme ; dans la seule photographie nous jouissons de son absence » [51]. Bazin va alors valoriser les cinéastes qui vont d’une certaine manière respecter ce « contrat de réalisme », dans la mesure où il est bien conscient que le réalisme absolu — celui qui n’impliquerait aucune intervention humaine — est évidemment un leurre ou un mythe idéal (le cinéaste choisit ce qu’il va filmer, comment il va filmer, et il va influencer, ne serait-ce que par sa seule présence, la réalité filmée). Il opposera ainsi le cinéaste soviétique Eisenstein qui, par le découpage, le montage ou l’utilisation des gros plans expressifs, manipule fortement les images pour servir son propos idéologique, à Orson Welles qui filme (ou filmerait [52]) la réalité dans sa complexité et son ambiguïté en laissant une plus grande liberté d’interprétation au spectateur, grâce entre autres au plan-séquence (qui consiste à filmer en continu une scène) et à une grande profondeur de champ permettant au regard du spectateur de parcourir les différents éléments de l’image à sa guise.

Paisa de Roberto Rossellini
Cette troisième approche (synthétisée ici de façon sommaire) s’appuiera notamment sur l’exemple du cinéma néo-réaliste italien révélé dans l’immédiat après-guerre (avec en particulier Rome ville ouverte, 1945, et Païsa, 1946, de Roberto Rossellini) et qui a donné l’impression d’une prise directe sur l’histoire en train de se faire : bien que marqués par ce contexte tragique, ces films, qui furent réalisés avec peu de moyens, mettaient en scène des gens ordinaires et refusaient toute forme d’héroïsation au profit des gestes simples du quotidien. Ils semblaient ainsi répondre à une volonté de montrer la réalité telle qu’elle était, plutôt que de raconter une histoire plus ou moins dramatique et bien scénarisée (comme le cinéma hollywoodien ou français) ou de défendre un propos politique explicite (comme le cinéma soviétique). Mais ce sont les réalisations ultérieures de Roberto Rossellini, notamment Voyage en Italie (1953), qui permettront à la critique de définir de façon explicite cette nouvelle manière « moderne » de faire et de considérer le cinéma, telle que l’expliquera Jacques Rivette dans une célèbre « Lettre à Rossellini », publiée dans les Cahiers du Cinéma en 1955. Parmi les qualités de ce film, qui mettait simplement en scène un couple en train de se séparer au cours d’un voyage dans la péninsule, Rivette relève la volonté de Rossellini de montrer sans expliquer et de susciter chez le spectateur une attente sans but, comme dans la vie elle-même. Le propos du film semble effectivement très ténu, et le cinéaste s’attarde sur des moments qui paraissent insignifiants ou sans grand intérêt : la caméra suit ainsi de façon privilégiée le personnage de Katherine (incarnée par Ingrid Bergman) visitant les environs de Naples, se rapprochant et s’éloignant par instants de son mari sans que rien de décisif ne semble se passer entre eux. L’ensemble du film privilégie ainsi l’attente, mais une attente sans suspens, sans but, sans qu’on puisse deviner quelle pourrait être l’issue de ce voyage : « on pressent l'événement mais sans le voir progresser : tout y est accident, aussitôt inévitable ». Et, si finalement cet événement surgit bien à l’issue du film, ce n’est pas du tout comme la solution d’une intrigue bien ficelée ou comme la réponse à une énigme posée comme telle, mais bien plutôt comme une « révélation » obligeant le spectateur à considérer d’un regard neuf tous les faits montrés jusque-là.
De manière générale, cette tendance critique se caractérisera par quelques traits essentiels. Le cinéma est d’abord conçu comme un art du réel, mais ce réel se distingue de la signification qu’on pourrait lui donner parce qu’il est complexe, ambigu, opaque aux consciences qui l’habitent ou qui l’observent. C’est cet écart entre le réel et son interprétation qui fait (ou ferait) précisément la spécificité du cinéma par rapport notamment à la littérature ou à la philosophie qui se situent d’emblée dans l’univers du sens. Concrètement, les critiques vont valoriser des films mettant en scène des personnages qui s’expriment peu sur leurs motivations, leurs pensées ou leurs sentiments, et dont les faits et gestes peuvent paraître banals, dérisoires, ambivalents ou au contraire incompréhensibles et absurdes (au moins dans un premier temps). Ainsi, quand on parle de « l’incommunicabilité » qui régnerait entre les personnages de la grande trilogie d’Antonioni (L’Avventura,1960, La Notte, 1961, et L’Eclisse,1962), ce terme masque en fait l’énigme que constituent pour le spectateur les personnages mis en scène : loin d’être « transparents », ceux-ci sont, comme dans la vie, relativement opaques, et nous ne comprenons que partiellement le malaise qui les habite même si nous en percevons certains symptômes. De tels films se caractériseront plus largement par une attitude relativement contemplative face à une réalité prise comme un ensemble et dont les personnages ne constituent qu’une part presque inessentielle : ainsi, dans un autre film célèbre d’Antonioni, le Désert rouge, les décors industriels du nord de l’Italie pris dans la brume semblent aussi importants pour comprendre le malaise de l’héroïne que ses propos laconiques.
Dans cette perspective, l’écart entre la fiction et le documentaire pourra sembler secondaire, et l’on pourra prétendre par exemple qu’un film de fiction constitue au moins un documentaire sur son propre tournage. Même chez des auteurs classiques comme John Ford, on admirera plus les paysages où évoluent les personnages que leurs faits et gestes soudain rendus dérisoires (malgré leur héroïsme apparent) par la grandeur aride de la Monument Valley. La réalité filmée importe plus que l’interprétation que l’on peut en donner, et le cinéma doit d’abord montrer cette réalité avant de vouloir « démontrer » quoi que ce soit à son propos. Et un film comme Elephant de Gus Van Sant (2003), qui reconstitue sans aucun commentaire ni explication un massacre sur un campus universitaire américain, sera considéré comme du « véritable » cinéma, alors que le documentaire [53] de Michael Moore, Bowling for Columbine (2002), qui aborde les mêmes faits, sera plutôt vu comme un « documenteur » à cause notamment de ses nombreux commentaires et des éléments d’analyse explicite qu’il donne de cette tuerie.

Ten d'Abbas Kiarostami
Au niveau du scénario, les films ainsi valorisés (généralement réputés « modernes ») se caractériseront par une faible dramatisation, une relative indifférenciation entre moments « forts » et moments « creux », une « ouverture » générale du récit qui n’obéit pas à une logique évidente (comme une énigme policière) et qui ne se conclut pas de manière décisive. Même si la formule est sans doute réductrice, de tels films se présentent comme un ou plusieurs « blocs » découpés dans le « réel » plutôt que comme une intrigue bien ficelée. Exemplaire d’une telle démarche, Ten du cinéaste Abbas Kiarostami (2002) est ainsi composé de dix séquences filmées dans une voiture avec deux caméras vidéos dirigées l’une vers la conductrice et l’autre vers son passager ou sa passagère : les dialogues semblent pris sur le vif, avec un montage minimal, comme des fragments détachés de l’existence quotidienne des différents protagonistes. En même temps, à travers ces « tableaux », se dessinent progressivement des portraits de femmes (notamment de la conductrice), prises dans leurs contradictions et leurs conflits, tandis que se révèle de façon indirecte tout le contexte social — pourtant absent en tant que tel — où elles sont enfermées.
Cet exemple permet par ailleurs de comprendre une autre caractéristique importante pour cette tendance critique, à savoir l’attention portée au « dispositif » cinématographique. Comment en effet « montrer le réel » sans lui imposer une interprétation préalable ? comment éviter que les idées, l’idéologie, les commentaires, les « mots » ne masquent en définitive la réalité ? De telles questions se posent en particulier dans le cinéma de fiction qui implique nécessairement une mise en scène, une reconstitution et une direction d’acteurs (même si l’on prétend par ailleurs qu’il n’y a pas de différence essentielle entre fiction et documentaire). Par opposition à la conception courante de l’artiste comme créateur ou « démiurge » (responsable donc consciemment ou inconsciemment de la totalité de son œuvre), le cinéaste devra à présent « laisser vivre » ses personnages, montrer le monde tel qu’il est et attendre que l’événement survienne plutôt que de le provoquer. On pourrait croire qu’il suffirait au réalisateur de laisser ses acteurs improviser, mais cela reviendrait en fait à leur laisser la place du « créateur » abandonnée par le cinéaste, et c’est eux qui dirigeraient le « réel » au lieu de le laisser « advenir » avec sa part d’imprévu et d’indécision.
Le recours à un « dispositif » permet en revanche de concilier ces deux exigences contradictoires, d’une part le fait que le cinéaste reste en définitive l’auteur ou le « responsable » du film, et d’autre part l’idée que les événements saisis par la caméra doivent être indéterminés, imprévisibles, non dirigés, comme la réalité elle-même. Après avoir mis en place un tel dispositif, le cinéaste expérimente alors les effets de ce dispositif sur une « réalité » qui reste ainsi (partiellement) livrée au hasard, aux aléas et à la liberté des choses. Bien entendu, les « dispositifs » effectivement adoptés vont grandement varier selon les réalisateurs, selon parfois aussi les circonstances, et l’on ne pourra décrire ici que quelques traits fréquemment rencontrés dans ce type de cinéma [54].


À nos amours de Maurice Pialat :
le retour du père
On peut citer d’abord le refus de scénariser certaines parties du film (sinon sa totalité) en laissant une place importante aux aléas du tournage. Un exemple célèbre d’une telle stratégie s’est présenté lors de la réalisation d’À nos amours (1983) de Maurice Pialat : celui-ci était le réalisateur du film mais il interprétait également un rôle, celui du père de la jeune héroïne qui quitte abruptement le domicile conjugal ; plus tard (dans le film comme dans le tournage), prend place un repas de famille au cours duquel réapparaît de manière inattendue le personnage du père, fait que Pialat n’avait annoncé qu’à son opérateur ; et le père — ou Pialat lui-même — s’en prend alors violemment à l’un des protagonistes, c’est-à-dire à un acteur qui peut à ce moment difficilement distinguer entre son personnage et sa propre personne [55]. On remarquera que le réalisateur s’est lui-même « mis en danger », car, si les autres acteurs ne s’attendaient pas à ce retour, il ne pouvait pas non plus prévoir comment ils réagiraient à cette irruption violente (certains auraient pu par exemple quitter brutalement le champ).
Dans une perspective similaire, les cinéastes à la recherche d’une telle forme de réalisme éviteront toute forme d’artifice ou de trucage, et pourront mettre les acteurs dans des situations relativement difficiles dont ils devront sortir par leurs propres moyens. Dans Rosetta (1999), il est assez visible que les frères Dardenne ont réellement plongé leur jeune actrice Emilie Dequenne dans une mare glacée dont elle se tire avec difficulté. De façon aussi évidente dans Gerry de Gus Van Sant (2002), qui raconte l’errance mortelle de deux amis partis faire une balade dans le désert, bientôt perdus dans l’immensité aride alors qu’ils ne sont qu’à quelques centaines de mètres de la route qui pourrait les sauver, les deux acteurs, Casey Affleck et Matt Damon, sont réellement mis à l’épreuve (même si évidemment leur vie ne fut jamais en danger), marchant de longs moments dans la rocaille et la poussière, fatigués et contraints à l’effort pesant que nécessite la progression dans cet univers aride, manifestant également à certains moments des pointes d’humour dont il n’est pas possible de deviner s’ils sont joués ou simplement vécus.
Un tel « dispositif » rend par ailleurs la position de la caméra beaucoup plus problématique puisqu’il n’y a plus d’événement, d’action, de « moment décisif » à filmer. Certains comme Cristian Mungiu dans 4 mois, 3 semaines et 2 jours, vont alors privilégier un cadrage fixe et des plans-séquences [56] en montrant les personnages avec toutes leurs hésitations, leurs propos à peine esquissés ou décousus, leurs gestes maladroits ou incomplets, leurs silences et leur inaction aussi. D’autres opteront pour une caméra « flottante » comme Gus Van Sant dans Gerry cité à l’instant où la caméra semble parfois dépassée par les personnages ou les précède apparemment sans raison. Cela n’empêche pas d’ailleurs ce réalisateur de recourir à des mouvements très élaborés et parfois d’une incroyable habileté comme dans Elephant (2003) où il suit à la trace avec une steadicam [57] ses personnages mais s’en détache également pour en découvrir d’autres à un autre endroit avant de revenir aux premiers qui se sont entre-temps déplacés vers un troisième lieu… Même si ces mouvements sont parfaitement réglés, ils donnent également l’impression d’une caméra « flottante » qui ne cherche pas à se fixer sur l’un ou sur l’autre et qui « traîne » un peu à sa guise comme le font les personnages eux-mêmes. En revanche, la caméra des frères Dardenne, dans Rosetta comme dans le Fils (2002), va se coller au personnage principal, dans son dos, comme si elle avait peur d’être dépassée, « larguée » par les brusques mouvements de ce personnage dont on ne devine pas bien les motivations.
De tels dispositifs qui visent à laisser « advenir » la réalité (sans la provoquer ou la manipuler) installent en général le spectateur (si du moins il se prête au jeu) dans une attitude beaucoup plus contemplative : le rapport au temps est modifié dans ce genre de réalisations, où le fil de l’intrigue est distendu et aléatoire, où le moment présent vaut en lui-même ou pour lui-même sans se réduire à n’être qu’une étape entre le passé et le futur comme dans le cinéma classique entièrement orienté vers la résolution de l’action en cours [58]. L’opposition traditionnelle entre les temps forts et les moments creux s’estompe également au profit d’une temporalité plus étale où chaque instant semble marqué par l’indécision.
Enfin, la critique relève souvent que ces films se caractérisent par un refus de toute « explication psychologique », mais il vaudrait sans doute mieux parler d’un refus plus général de l’explicitation, les personnages se signalant par un mutisme plus ou moins accentué (comme Rosetta) ou par des propos relativement ambigus ou hermétiques (par exemple, Giuliana dans le Désert rouge, dont les paroles n’éclairent que faiblement le malaise dont elle souffre) mais également par des comportements insolites (en ouverture du Désert rouge, l’on voit par exemple Giuliana aux airs bourgeois acheter à un ouvrier (?) son sandwich déjà entamé qu’elle va ensuite manger dans un buisson). Là où les mots manquent, les gestes, même les plus banals, même les plus prosaïques, prennent alors une dimension d’étrangeté : ainsi, toujours dans Rosetta, les spectateurs seront sans doute frappés par la répétition insistante de la même scène apparemment insignifiante où l’on voit la jeune fille retirer ses chaussures et enfiler une paire de bottes en caoutchouc pour pénétrer dans le camping misérable où elle vit avec sa mère. Nombre de critiques insistent de fait sur la présence nouvelle du « corps » dans le cinéma moderne où les gestes paraissent moins évidents et où s’impose à nous la présence physique des acteurs : les postures, les visages, les attitudes, les expressions sont saisis dans leur fugacité mais également leur énigmatique opacité. Dans Voyage en Italie de Rossellini, la caméra s’attarde sur la visite que Katherine fait seule au Musée de Naples et qui à première vue pourrait être celle de n’importe quel touriste ; mais l’insistance de la caméra nous fait prendre conscience que nous regardons quelqu’un qui regarde des statues qui elles-mêmes semblent regarder Katherine à moins que leur regard ne plonge dans le vide… ou dans le nôtre. La surface des choses — en particulier le corps même de l’actrice — est seule livrée à notre regard et résiste à l’interprétation immédiate en suscitant l’indécision : le personnage est-il troublé ou fasciné par ces statues ? est-ce le désir, la mort, la souffrance qu’elle aperçoit à travers elles ? est-ce le passé du monde ou son propre passé qui ressurgit alors ? est-ce enfin le personnage qui est troublé ou l’actrice elle-même mise par le cinéaste (qui était également alors son mari) dans cette situation inconfortable où il n’y avait apparemment « rien » à jouer ?
Cette attitude critique, qui entend privilégier le « réel » saisi par le cinéma, connaît sans doute des variantes et des nuances, mais elle est prise, on le comprend assez facilement, dans certaines contradictions fondamentales.
Ainsi, pour le spectateur qui n’a pas ou peu de connaissance du processus de réalisation, l’existence d’un dispositif censé garantir l’enregistrement de la réalité « brute » ne peut pas être perçue en tant que telle, ou du moins peut difficilement être distinguée du travail traditionnel de mise en scène et de scénarisation : dans la séquence précédemment évoquée d’À nos amours de Maurice Pialat, la révélation de la méthode de tournage permet sans doute de mieux apprécier le travail des acteurs, du cinéaste et de son équipe, mais la plupart des spectateurs, qui n’en savent rien, s’appuient en fait sur d’autres critères — ceux d’une vraisemblance générale, de type humain et psychologique — pour juger du réalisme de cette scène. Le « dispositif » censé laisser advenir le « réel » n’est en rien un indice ou une preuve de réalisme, et les admirateurs de ce type de films tiennent en fait compte d’autres éléments filmiques (visibles ou audibles) pour juger de leur dimension réaliste. Mais, comme les spectateurs ont des critères différents de ce que peut être la « réalité », le « vrai » ou la « vraisemblance » (notamment en matière de psychologie), ce jugement ne sera pas nécessairement partagé par tous, et la prise en compte d’un éventuel « dispositif » ne suffira pas à convaincre ceux qui resteront insensibles à l’un ou l’autre de ces films [59]. Ainsi, là où certains partageront le sentiment d’incommunicabilité qui semble accabler les personnages d’Antonioni, d’autres pourront parler de personnages vides, inutilement pessimistes ou encore (d’un point de vue plus sociologique) de grands bourgeois amorphes et névrosés. Et, d’un point de vue plus formel, il est pratiquement impossible pour qui n’a pas connaissance des processus effectifs de réalisation de décider si les dispositifs imaginés par Rossellini, Antonioni ou Kiarostami permettent à chacun de ces cinéastes « de devenir l’observateur curieux de son propre film en train de se faire, d’en être l’auteur présent-absent sans l’obligation fastidieuse d’en être le maître gestionnaire » [60] ou si au contraire de telles stratégies ne sont que le masque d’une mise en scène cachée et d’une direction sans doute moins visible (mais peut-être plus perverse) des acteurs comme des spectateurs. Ainsi, la trame narrative de ce genre de films (comme Gerry, Voyage en Italie, Ten, Le Désert rouge ou d’autres) peut sembler hésitante ou distendue, mais l’organisation générale du récit (même s’il n’a pas été préalablement scénarisé ou seulement en partie) reste bien aux mains du cinéaste (à travers en particulier le montage), et il n’est pas possible de considérer qu’elle est le fruit du hasard ou le simple enregistrement d’une réalité simplement advenue devant la caméra…
Une autre antinomie à laquelle aboutit cette attitude critique résulte de l’opposition conceptuelle entre le réel « brut » et la signification qu’on peut lui donner : si ce type de cinéma entend effectivement privilégier le « réel », il ne peut cependant pas faire abstraction du sens que lui donnent les spectateurs (mais aussi les auteurs) ou qu’ils y recherchent spontanément. Aucun cinéaste (« moderne » ou non) ne se contente de filmer la réalité comme le ferait une caméra de surveillance [61], et tous mettent en scène des situations humainement significatives, des faits et gestes qui — on le suppose du moins — présentent un intérêt, une pertinence, une valeur aux yeux de celui qui les a filmés et retenus. Or, si un certain nombre de spectateurs trouvent ce type de films « ennuyeux », « vides », « sans rien à y comprendre », c’est précisément parce qu’ils perçoivent la réalité (mise en scène) de façon « brute », comme dépourvue de toute signification ; à l’inverse, on peut supposer que ceux qui apprécient ces films sont précisément capables de leur donner un sens à partir d’indices effectivement ténus, ambigus ou fragmentaires. La « réalité » en elle-même ne retiendra pas plus notre attention au cinéma que dans la vie quotidienne, et c’est parce que nous y percevons des éléments saillants de signification que nous y portons intérêt. Parler par exemple de « pure poésie », du « bonheur de la contemplation », de « film hypnotique » ou encore de « méditation » est déjà une manière de donner une pertinence (d’un point de vue humain) à ce qui est seulement montré. Mais de façon plus large, c’est la capacité de certains spectateurs à découvrir un sens « caché », non évident, symbolique, à tisser des liens entre différents éléments filmiques (éloignés les uns des autres ou de nature différente) mais également à convoquer des savoirs ou des systèmes d’interprétation complexes, qui leur permet en fait d’apprécier ce genre de films.

Rosetta de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Ainsi, le geste de Rosetta qui enlève ses chaussures pour enfiler des bottes en caoutchouc, répété trois fois dans le film des frères Dardenne, risque bien d’énerver certains spectateurs s’ils n’y voient qu’un geste prosaïque sans dimension symbolique alors que le film insiste par ce genre de détails visuels sur l’importance des frontières qui sont spatiales mais également sociales et psychologiques. Ainsi encore, dans Ten de Kiarostami, la première séquence (mais cela vaut aussi pour les autres), où l’on assiste à la dispute entre une mère récemment divorcée et son jeune fils, ne retiendra notre attention que si l’on perçoit dans cette querelle familiale, en soi banale, et au-delà des paroles échangées, l’ensemble des relations entre les personnages présents ou absents (le père, de façon consciente ou inconsciente, utilise le fils dans le conflit qui l’oppose à son ex-épouse) mais également l’ambivalence de ces relations (la femme supporte les attaques répétées de ce gamin exaspérant dans l’espoir sans doute de le reconquérir progressivement) et aussi l’ensemble du contexte socioculturel qui définit notamment le rôle légitime des uns et des autres (et qui stigmatise notamment les femmes divorcées). Même une caractéristique formelle comme le fait que la caméra ne quitte pas le visage de l’enfant pendant toute cette séquence et laisse la mère hors-champ risque d’apparaître au spectateur comme un « dispositif » arbitraire et inutilement contraignant s’il ne lui trouve pas un sens dans le contexte du film et de cette séquence en particulier, comme par exemple de nous rendre sensibles à « l’effet de levier » que ce petit enfant exerce sur sa mère. Bien entendu, comme on l’a déjà signalé, une telle interprétation ne peut s’appuyer sur aucune règle, mais seulement sur une certaine vraisemblance générale, et dépend donc des compétences très variables des spectateurs.
Les meilleurs analystes d’une telle conception « moderne » du cinéma sont sans doute conscients de cette antinomie et savent que le cinéma ne consiste pas simplement « à filmer le réel tel qu’il est » et qu’il y a nécessairement point de vue, intervention, effets de sens et interprétation… De manière générale cependant, ils ont tendance à masquer les procédures d’interprétation auxquelles eux-mêmes recourent et à imposer leur propre interprétation comme « émanant » directement du film et de la « réalité » filmée. La diversité possible des interprétations (et des réactions des spectateurs) sera facilement passée sous silence derrière des affirmations sans doute argumentées mais dont le caractère fondamentalement hypothétique est complètement gommé (un tel déclarera par exemple que « Rossellini n’est pas un cinéaste chrétien, contrairement à ce que, unanimement, s’entend à démontrer la critique depuis toujours » sans s’interroger plus avant sur cette « erreur » unanime…). La conception même du « réel », que se font ces analystes, comme non-clôture du sens, comme vérité révélée par le seul cinéma, ou encore comme opacité, hétérogénéité, hiatus, attente ou bascule du sens (pour reprendre quelques expressions fréquemment employées), implique d’ailleurs une interprétation préalable qui n’a rien d’évident et qui consiste à privilégier l’événement, l’accident ou l’imprévu par rapport au régulier, à l’attendu ou au sens commun (défini alors comme illusoire ou naïf).
Cette dénégation d’une nécessaire recherche de sens est particulièrement flagrante en ce qui concerne la dimension psychologique des gestes, attitudes ou comportements représentés. Parler en effet d’un refus de toute psychologie au cinéma obligerait le spectateur à ne considérer que la surface objective des choses en lui interdisant toute interprétation en termes de pensées, d’intentions, de motivations, d’émotions (des personnages), ce qui serait à proprement parler absurde, car, si nous nous intéressons aux individus mis en scène, c’est évidemment parce que nous reconnaissons en eux une subjectivité essentiellement semblable à la nôtre, même si elle garde également une part d’opacité ou de singularité irréductible. La différence essentielle entre le cinéma « moderne » et un cinéma plus classique réside sans doute moins dans le refus de toute dimension psychologique que dans le recours en ce domaine à des procédures d’interprétation plus élaborées, plus raffinées et moins évidentes [62]. Les films « modernes » se signalent précisément par la représentation de gestes et d’attitudes problématiques, soit parce que ces comportements sont mis en évidence malgré leur insignifiance apparente, soit parce qu’ils n’obéissent pas à une logique d’action claire (une intention en vue d’un but) et apparaissent de ce fait comme incongrus, inattendus, étranges, déplacés, parfois même scandaleux : cela oblige alors le spectateur (si, du moins, il en a la compétence) à recourir à des savoirs psychologiques plus complexes, qui sont actuellement le plus souvent d’origine freudienne et qui supposent notamment que le personnage comme sujet n’est que partiellement conscient des motivations, désirs, pulsions ou émotions qui le traversent. Grâce à de tels savoirs, ce spectateur « compétent » va pouvoir donner un sens à des comportements (gestes, paroles, attitudes) effectivement énigmatiques dont le personnage serait sans doute lui-même incapable d’éclairer les motivations. Ces interprétations restent peut-être largement intuitives dans le chef des spectateurs (même si des discussions d’après projection peuvent être l’occasion d’une explicitation effective), mais ceux qui ne parviennent pas à élaborer de telles interprétations ou qui restent insensibles [63] aux motivations des personnages devront se rabattre sur des « explications » sommaires, très généralement dépréciatives (par la folie supposée des personnages, leur hypothétique névrose, leur « connerie » ou celle de l’auteur du film qui sera par ailleurs facilement accusé de « snobisme »…), pour rendre compte — de façon minimale… — d’une expérience filmique perçue alors comme foncièrement déceptive. Bien entendu, les compétences des spectateurs sont diverses, et leurs interprétations ne seront pas nécessairement de nature étroitement psychologique (ou psychanalytique) et pourront recourir à d’autres savoirs comme la sociologie ou la philosophie ou même à d’autres dispositions comme la contemplation de nature plus ou moins esthétique. Et les interprétations basées sur de tels savoirs seront elles aussi diverses, plus ou moins élaborées et, dans certains cas, contradictoires et polémiques.
Enfin, en privilégiant la « réalité » que devrait saisir le cinéma au détriment de son sens, cette conception aboutit à une troisième antinomie qui résulte de la liberté même censée être laissée au spectateur : si le réel est opaque, ambigu, mystérieux, il impose un effort interprétatif particulièrement intense à un spectateur qui devient alors le seul responsable du sens qu’il donne aux choses et à qui aucun auteur, ni autorité, ni code, ni guide, ni principe ne peut dicter sa conduite. Aucune « lecture » critique en particulier ne peut se prétendre meilleure ou plus juste qu’une autre, et, si, par exemple, l’un affirmera qu’Elephant de Gus Van Sant est une tragédie sous un ciel vide ou le regard d’un Dieu absent, un autre pourra tout aussi bien parler de la banalité du mal dans un monde moderne, aliéné et sans repères. Mais de telles analyses pourront également être rejetées comme des « projections » des différents critiques, et, plus ces analyses seront complexes et raffinées, plus elles risqueront d’ailleurs de susciter un tel rejet. Symétriquement, plus la réalité représentée apparaîtra comme opaque, complexe et mystérieuse, plus elle pourra apparaître comme insignifiante et sans intérêt parce qu’incompréhensible… On remarquera en outre que, face à ce genre de film, la critique recourt abondamment à des formules négatives — le film ne voudrait ni expliquer, ni dénoncer, ni comprendre, ni dramatiser…— sans parvenir à définir de façon positive son propos, son sens ou son projet, comme si le seul objectif d’une telle réalisation était de « rompre » avec la manière habituelle de faire et de regarder le cinéma [64]. Mais, pour le spectateur qui est resté insensible ou indifférent, ces remarques critiques seront tout à fait insatisfaisantes et ne répondront en rien au reproche éventuel d’insignifiance.
Si les trois grandes tendances critiques exposées ici se caractérisent chacune par des choix positifs (de façon extrêmement sommaire : la forme, les thèmes, le réel), y a-t-il à l’inverse des critères négatifs permettant de disqualifier certaines réalisations ? Il faut sans doute à ce propos faire une distinction entre les films qui suscitent simplement de la part des critiques (ou de certains d’entre eux) l’indifférence ou le mépris (parce qu’ils sont jugés ratés ou sans intérêt) de ceux, plus rares, qui provoquent un rejet violent et haineux créant ainsi la polémique.
Si les raisons de telles polémiques (en fait assez rares [65]) sont très diverses, elles visent en général des films dont le succès (effectif ou prévisible) est perçu comme illégitime ou immérité. Dans ce cas, la relation au « public » (réel ou fantasmé) est essentielle, soit que la critique estime que le film en cause flatte ses instincts les plus vils, soit qu’il le dupe ou le manipule, soit encore qu’il cherche à lui plaire (notamment par sa dimension spectaculaire) au détriment du projet artistique (au sens le plus large) qui devrait être le sien. En d’autres termes, les films mis en cause sont dénigrés à cause de leur bêtise supposée ou pire de leur démagogie (prenant les spectateurs pour des imbéciles), de leur bassesse morale, de leur manque de vérité ou de leur mensonge essentiel, de leur sentimentalisme ou de la priorité donnée au spectacle et à l’émotion.

Hôtel Rwanda de Terry Georges
De façon générale, ces critiques qui se font au nom de la distance réflexive ou de la hauteur morale (beaucoup plus rarement de la beauté esthétique) restent cependant peu précises, notamment dans la définition des critères utilisés. Ainsi, le recours à l’émotion qui serait censé disqualifier certains films, se retrouve dans un très grand nombre de réalisations (et de spectacles) qui n’encourent cependant pas le même anathème. De façon similaire, la condamnation morale de films prétendant mettre en scène sur le mode fictionnel l’univers concentrationnaire nazi ne semble pas concerner des réalisations évoquant de la même manière d’autres génocides (comme celui des Tutsis représenté dans Hôtel Rwanda de Terry Georges en 2005) ou d’autres massacres à grande échelle (comme ceux perpétrés par les Khmers rouges au Cambodge et montrés dans Killing Fields de Roland Joffé en 1984).
En outre, en dénonçant certains films comme une imposture morale, intellectuelle ou (plus rarement) esthétique, de telles attaques inversent le sens même que le réalisateur donne à son film ou, plus exactement, que la plupart des spectateurs supposent être celui donné par le cinéaste [66] : ainsi, le film qui entend dénoncer la barbarie nazie se retrouve accusé d’abjection, et celui célébrant la joie de vivre est traité de vision réactionnaire et passéiste de la France. Prenant le public à contre-pied, battant en brèche le « sens commun », ces critiques suscitent généralement l’incompréhension et créent la polémique.
Dans un débat ou une animation autour d’un film, il est difficile d’ignorer ce genre de polémiques auxquelles certains participants feront sans doute allusion. Mais il serait également maladroit pour un animateur de prendre position par rapport à des thèses qui, on le voit, restent marquées par une part importante d’arbitraire et de subjectivité, et qui prennent notamment comme cible « les certitudes communes ».
Que les critiques soient positives ou négatives, elles ne peuvent cependant que rendre compte partiellement du film qu’elles analysent ni ne peuvent réellement justifier les jugements qu’elles posent. En effet, la critique suppose que les qualités ou les défauts filmiques sont objectifs, et elle ne considère jamais que ces caractéristiques dépendent également des dispositions des différents spectateurs. Or, si les jugements émis ont effectivement une base objective — ils visent des traits ou des éléments filmiques existants —, leur évaluation positive ou négative a une dimension irréductiblement subjective : un jugement est toujours une relation entre une œuvre et un individu dont les dispositions ont été formées au cours d’une histoire culturelle, sociale et personnelle, et ne peuvent donc pas être considérées a priori comme universelles. C’est ce qui explique bien sûr que les critiques des uns et des autres ne soient pas partagées par tous et suscitent même souvent l’incompréhension ou le rejet d’un grand nombre de personnes. Ainsi, le « réalisme » des uns sera perçu par d’autres comme simple « prosaïsme »; ou bien la « révélation finale » ne sera que « coup de théâtre artificiel », la « richesse » humaine de simples stéréotypes » et « l’originalité esthétique » un « formalisme creux »…
En outre, on peut faire l’hypothèse que la critique constitue — pour une part — un exercice de « rationalisation » (au sens freudien ou sociologique du terme) consistant à justifier a posteriori des goûts ou des dégoûts dont les véritables motivations restent inaperçues du critique comme sans doute de ses lecteurs. Il ne s’agit pas ici de faire un procès d’intention et d’accuser les critiques de « mauvaise foi », mais simplement de reconnaître que, comme tous les individus, ils ne maîtrisent pas complètement les raisons de leurs choix ni de leurs préférences. En se basant sur sa propre expérience de spectateur, on aperçoit facilement que nos réactions d’adhésion ou au contraire de répulsion face à un film sont d’abord ressenties subjectivement de façon très intuitive et sont souvent provoquées par des éléments qui peuvent être très localisés et de faible importance (un geste, un plan, une musique, une intonation, une attitude…) : ce n’est généralement que dans un second temps — par exemple lors d’une discussion avec d’autres spectateurs — que nous expliquons, détaillons, développons ces premières impressions souvent confuses. Mais, à ce moment, parfois pris d’ailleurs dans le feu d’un débat, nous sommes facilement amenés à « rationaliser » nos premières réactions en systématisant notre propos, en cherchant d’autres éléments du film qui corroborent notre jugement, en donnant une cohérence à des émotions très fugaces et en réduisant alors l’ensemble du film à quelques éléments « saillants » [67]. C’est ainsi par exemple que la sympathie ou l’antipathie que l’on peut éprouver à l’égard d’un acteur déteint facilement sur tout un film dont les éléments importants (scènes ou séquences mémorables) nous sembleront marqués par la performance, remarquable ou détestable, de cet acteur.
Ainsi encore, on devine souvent à la lecture des critiques qu’elles ne rendent que très partiellement compte du film analysé et qu’elles sont bien incapables de justifier le point de vue qu’elles adoptent et notamment le choix de privilégier certains aspects du film au détriment d’autres peut-être aussi importants: quand on parle d’un « superbe méchant », de « l’intelligence » d’un réalisateur, d’actrices « surdouées », de la « magie » d’une séquence, ou au contraire de la « fadeur » d’un acteur, de « comédie fainéante » ou de « film trop lisse » (pour reprendre quelques expressions glanées dans la presse), ces caractérisations vagues ne sont que faiblement explicatives des raisons profondes et sans doute multiples qui ont pu réellement motiver le jugement de valeur en cause. On pressent alors que le jugement critique est motivé par des considérations, des affects, des motifs qui ne sont en réalité que faiblement explicités.

Si une telle analyse de la critique est difficile à mettre en œuvre de façon rigoureuse (car cela suppose la maîtrise d’instruments inspirés de sciences humaines comme la sociologie, la psychanalyse ou l’histoire), on peut cependant dégager une motivation implicite qui découle de la position même des auteurs dans le champ intellectuel : on comprend en effet facilement que les critiques cherchent dans leurs propos à se distinguer aussi bien de l’opinion des simples spectateurs que de celle de leurs collègues. Comme tout intellectuel soumis à la concurrence de ses pairs, le critique doit montrer, par toute une série d’indices, que son avis est autorisé, pertinent, original, et qu’il est capable notamment de « voir » dans le film analysé des caractéristiques, des traits ou des éléments que les spectateurs « non avertis » n’aperçoivent pas spontanément [68]. Un exemple célèbre de cette démarche est celui d’Eric Rohmer et Claude Chabrol (alors critiques aux Cahiers du Cinéma) dans leur analyse de l’œuvre d’Alfred Hitchcock : alors qu’à cette époque (dans les années 1950), le réalisateur britannique était généralement considéré comme un réalisateur « commercial », un « faiseur » de films à suspense, Rohmer et Chabrol vont le décrire comme un grand moraliste chrétien, hanté par la culpabilité et le mal [69]. Si cette lecture n’est pas nécessairement fausse (bien qu’elle ait laissé longtemps sceptique un critique aussi avisé qu’André Bazin), on voit bien que l’accent mis sur cet aspect secondaire de l’œuvre de Hitchcock est une manière de légitimer de façon très intellectuelle une passion motivée en réalité par des aspects beaucoup plus évidents et partagés par la plupart des spectateurs aimant Hitchcock comme son art du suspense : si celui-ci avait en effet réalisé des films policiers insipides, ennuyeux et mal ficelés, cette thématique de la culpabilité n’aurait certainement pas suffi à retenir l’intérêt de ces jeunes critiques…
Le même mécanisme est sans doute à l’œuvre quand la critique (surtout la plus légitime comme celle des Cahiers du Cinéma) valorise par exemple une réalisation spectaculaire hollywoodienne dont elle estime qu’elle porte la marque d’un véritable auteur de cinéma (comme Tim Burton avec des films comme Batman ou Alice au pays des merveilles, Brian DePalma et son remake de Scarface, Quentin Tarantino et Inglorious Bastards ou encore Michael Mann et Heat ou Public Enemies) : les raisons avancées sont alors volontairement originales et très éloignées de celles que pourraient évoquer la majorité des spectateurs de ces films. Encore une fois, il ne s’agit pas d’accuser la critique de mauvaise foi ni de « snobisme » (comme certains peuvent être tentés de le faire) mais de comprendre comment s’élaborent de tels jugements critiques, ainsi que les raisons qui peuvent les motiver.
La critique n’est certainement pas une science, et son pouvoir de conviction est sans doute assez faible face notamment à des spectateurs dont le niveau scolaire et culturel augmente régulièrement (si l’on se situe du moins dans le moyen terme d’une cinquantaine d’années [70]). Si elle suscite ainsi souvent des réactions contrastées, sinon épidermiques, la critique apporte des points de vue originaux qui ne peuvent pas être négligés dans le cadre de l’éducation permanente. Elle permet en effet de considérer des éléments ou des aspects filmiques facilement négligés par les spectateurs. En outre, elle présente souvent le contexte historique et cinématographique où s’inscrivent les films considérés : les critiques (au moins les meilleurs d’entre eux) ont une grande culture cinématographique grâce à laquelle ils peuvent notamment offrir d’utiles points de comparaison aux autres spectateurs. Enfin, reportages et entretiens avec les cinéastes, acteurs et autres intervenants permettent de mieux apercevoir et de comprendre le processus de réalisation filmique.
De façon plus essentielle, la critique ou du moins certaines tendances critiques influent plus ou moins directement sur la création cinématographique : l’exemple le plus célèbre d’une telle influence fut celui de la Nouvelle Vague en France dont un grand nombre d’auteurs — Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer… — ont commencé par écrire dans les Cahiers du Cinéma avant de passer à la fin des années 1950 à la réalisation. Si le rapport entre leurs écrits critiques et les films effectivement réalisés par ces cinéastes n’est pas direct ni simple à comprendre, il est difficile de considérer les uns indépendamment des autres, bien que chaque film conserve sa singularité et mérite d’être analysé en lui-même.
Aujourd’hui, les trois grandes tendances critiques que l’on a distinguées peuvent également être considérées comme des « manières » différentes de faire des films ou comme de grandes options « esthétiques » auxquelles sont confrontés les cinéastes. Si les films effectivement réalisés ne sont jamais la simple illustration de telles options, celles-ci permettent néanmoins aux spectateurs de donner un sens à un certain nombre de choix fondamentaux de mise en scène comme on l’a montré précédemment. De tels choix ne sont pas nécessairement partagés par tous, et certains préféreront un cinéma spectaculaire ou formellement inventif, tandis que d’autres apprécieront des films d’abord soucieux de réalisme et d’authenticité.
Dans le cadre d’un débat ou de l’éducation permanente au cinéma, une connaissance de la critique est donc indispensable car elle permet notamment de « mettre des mots » sur des processus et des réalités esthétiques (au sens le plus large du terme) qui sont appréhendés au cours de la projection de façon silencieuse et implicite. Bien entendu, ces interprétations critiques ne peuvent rendre compte que partiellement (et parfois même faussement) de l’appréciation filmique d’une œuvre qui ne se résume jamais à quelques mots…
Spontanément, les qualités ou les défauts que nous attribuons à un film (ou à une œuvre d’art) nous paraissent justifiés par des caractéristiques objectives de cette réalisation : nous estimons que les scènes sont « bien filmées », que tel interprète est « génial », que le récit est captivant et mené de main de maître, ou bien au contraire qu’un acteur joue « mal », que les thèmes abordés sont inintéressants, que les couleurs, les images ou les lumières sont « laides ». Ce n’est que par la confrontation avec l’opinion d’autres spectateurs que nous pouvons être amenés à relativiser cette première opinion en constatant des divergences d’appréciation irréductibles. Chacun, selon sa personnalité, essaiera d’imposer plus ou moins fortement et de façon plus ou moins argumentée sa propre opinion, mais l’expérience montre assez rapidement que la discussion ne suffit pas à modifier de façon systématique les appréciations divergentes et que le choix d’un point de vue ou d’un critère de jugement n’est jamais absolu ni partagé par tous. Ainsi, d’aucuns en concluent que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas… L’affirmation relève d’un certain sens commun mais se retrouve également théorisée de façon plus argumentée par différents courants de la philosophie esthétique [71]. À l’inverse, d’autres théoriciens [72] maintiennent l’affirmation d’une certaine objectivité des jugements de valeur (notamment esthétiques) et s’opposent de façon plus ou moins nette au relativisme qui prétendrait que toute hiérarchie en ce domaine est nécessairement arbitraire. Entre ces deux thèses apparemment antinomiques, on trouve toutes sortes de positions intermédiaires [73] qui essaient d’échapper aux conséquences extrêmes de ces thèses comme aux paradoxes qu’entraîne leur improbable conciliation.
On ne prétendra évidemment pas ici résoudre cette antinomie de façon théorique, et l’on se placera plutôt du point de vue de l’animateur confronté de façon pratique à des opinions contradictoires (notamment à propos d’un film) qui prétendent toutes à la même validité. S’il n’est pas possible de départager les contradicteurs, peut-on en revanche expliquer ou au moins décrire comment se forment les divergences d’appréciations ? Autrement dit, est-il possible avec les spectateurs d’éclairer les différents processus qui les ont conduits à porter des jugements opposés ?
On remarquera d’abord que l’appréciation esthétique constitue une relation entre une œuvre et un individu (ou si l’on veut entre un objet et un sujet). Elle comporte donc nécessairement une dimension objective qui repose sur différents aspects ou éléments de l’œuvre en question : dans un film, je peux décrire les moments qui m’ont fait rire, les scènes qui m’ont spécialement ému ou les images qui m’ont paru particulièrement belles et remarquables. Dans la même perspective, si j’apprécie tel cinéaste ou tel acteur, cela ne m’empêchera pas de distinguer entre des films plus réussis que d’autres, entre des interprétations plus admirables que d’autres. Les différences de jugements portés par un même spectateur dépendent donc, pour une part au moins, de différences objectives entre les œuvres considérées, même si elles ne sont pas nécessairement faciles à décrire ou à saisir.
Mais l’appréciation esthétique implique également certaines dispositions chez le spectateur. Certaines de ces dispositions paraissent d’ailleurs indispensables : ainsi, de même qu’il paraît impossible qu’une personne sourde apprécie la musique, un aveugle ne pourra certainement pas juger d’une peinture ou d’un film (même s’il arrive que des non-voyants participent de diverses manières à une projection). En prolongeant cette réflexion, on s’aperçoit également qu’un spectateur daltonien peut difficilement apprécier le travail sur les couleurs (mais bien sur la lumière) et qu’un borgne ne pourra pas découvrir les nouveaux effets du cinéma en relief (comme dans Avatar de James Cameron ou Alice au pays des merveilles de Tim Burton, tous deux présentés sur les écrans en 2010), même si ces personnes peuvent observer et juger bien d’autres aspects des films en cause.
Tout cela est évident mais révèle très clairement le rôle incontournable des dispositions subjectives[74] dans l’appréciation esthétique. Certaines sont naturelles comme la vision ou l’audition mais d’autres sont acquises par l’éducation et la culture et varient donc grandement selon les individus. On peut donc faire l’hypothèse que les différences d’appréciation résultent également pour une part des différences de dispositions chez les spectateurs : celles-ci vont dépendre en effet de la formation personnelle, sociale, scolaire et culturelle qui varie évidemment grandement selon les individus.

Aux limites du "mauvais goût" dans
Osmosis Jones de Peter et Bob Farrelly (2001)
Cependant, l’on constate aussi que, même à l’intérieur d’un public homogène (par exemple celui d’un ciné-club ou d’un cinéma d’art et essai), les différences d’appréciation à l’égard d’un même film sont relativement importantes. L’unanimité est rare, sinon inexistante, et le rapport entre les dispositions des spectateurs et les films appréciés (positivement ou négativement) n’a rien de simple ni de mécanique : ainsi, il est pratiquement impossible de prévoir quelles seront les réactions des différents spectateurs à la vision d’un film, même si a priori ils ont des goûts et des préférences relativement similaires (s’il s’agit par exemple d’amis ou de collègues de travail).
Pour expliquer cette indétermination dans les appréciations critiques, il faut prendre en compte (au moins) deux phénomènes. Le premier est ce qu’on peut appeler la complexité de l’objet filmique, non pas au sens où les films seraient difficiles à comprendre (même si certains le sont), mais où cet objet est composé de multiples dimensions et qu’il peut donc être considéré sous différents aspects et de différents points de vue : ainsi, l’on peut être sensible à l’histoire racontée, aux émotions suscitées, aux thèmes évoqués mais également aux personnages, au talent des acteurs, éventuellement aux décors ou à l’ambiance qui s’en dégage, ou encore au travail de mise en scène du cinéaste, travail qui lui-même comporte plusieurs dimensions (cadrages, direction d’acteur, montage, etc.). En outre, comme le cinéma est un art de la représentation, les relations entre cette représentation et la réalité évoquée de façon médiate (que ce soit à cause du caractère fictionnel du film en cause ou simplement parce que tout film, même un documentaire, ne peut représenter qu’une partie de la réalité) peuvent être interprétées de multiples façons souvent contradictoires : comme on l’a souligné précédemment, l’interprétation est une (re)construction qui est nécessairement hypothétique, et, là où certains par exemple verront réalisme et authenticité, d’autres percevront idéologie ou simplification outrancière, ou bien encore ce qui pourra être vu par d’aucuns comme pure fiction (film fantastique, conte merveilleux, heroic fantasy…) sera interprété par d’autres comme message profond, « leçon de vie », pensée mise en images [75]…
Même si la complexité est une notion relative (tout objet réel est plus ou moins complexe), on comprend facilement que, face à un même film, les spectateurs peuvent considérer des éléments différents, se focaliser sur des aspects particuliers, localisés mais négligés par d’autres, donner une importance plus ou moins grande aux multiples dimensions du film considéré, procéder à des interprétations très différentes les unes des autres (ce qui n’est évidemment pas le cas si l’on veut seulement décider de la couleur d’une cuisine…). Plusieurs stratégies peuvent d’ailleurs être utilisées en animation pour faire apparaître cette diversité d’appréciation : ainsi, après la projection, l’on peut demander aux spectateurs de citer les scènes qui leur ont paru les plus marquantes ; un questionnaire (préparé à l’avance) permettra également d’aborder les multiples dimensions du film, les participants étant invités à préciser (par exemple sur des échelles d’évaluation) l’importance plus ou moins grande qu’ils donnent personnellement à ces éléments ; enfin, la simple confrontation des opinions, que l’animateur essaiera de synthétiser sur un tableau, fera certainement apparaître quelques pôles (personnages, histoire, mise en scène, « idées » du film…) autour desquels se concentrent les différences d’appréciation… Quelle que soit la méthode employée, l’animation devrait déterminer les multiples manières dont est perçu le film, les éléments qui focalisent l’attention et l’appréciation de certains spectateurs mais paraissent secondaires à d’autres, ou les aspects qui sont valorisés par les uns mais négligés par d’autres, ainsi que les grandes différences d’interprétation qui se dégagent éventuellement du film…
Par ailleurs, les dispositions « spectatorielles », c’est-à-dire les différentes compétences mais également hiérarchies que met en œuvre chaque spectateur, ne constituent pas un ensemble homogène et unique, même si l’on ne considère que celles présentes chez un seul individu : le jugement que je peux porter sur un film mais aussi l’interprétation que je peux en donner peuvent ainsi être de nature esthétique mais également politique, morale, humaine, affective, philosophique… Mais chacune de ces approches peut également déboucher sur de multiples points de vue : ainsi, une approche esthétique du cinéma pourra porter des appréciations, parfois contradictoires, sur le jeu des acteurs, sur la mise en scène, sur les images, sur la narration, sur le réalisme ou au contraire l’imagination foisonnante de l’auteur… Et si je me fie essentiellement à mes émotions, vais-je privilégier le rire, les larmes, la sympathie que m’inspirent les personnages, le choc d’images spectaculaires ou encore l’identification des individus perçus comme complexes, authentiques, ambivalents ou ambigus ?
Ainsi de manière générale, face à un film, on peut difficilement prédire si un spectateur sera surtout sensible à l’aspect esthétique, ou politique, ou social, humain, affectif de ce film… et quel poids il donnera subjectivement à ces différentes dimensions. Si l’on considère que les jugements de valeur individuels reposent sur des critères ou des échelles d’évaluation qu’il est possible d’expliciter (par exemple lors d’un débat ou d’une discussion), on ne peut cependant établir a priori de hiérarchies entre ces différents critères ou échelles d’évaluation : ainsi, je peux admirer un film d’un point de vue esthétique ou cinématographique, même si je n’adhère pas aux opinions politiques ou religieuses exprimées ou traduites par son auteur ; à l’inverse, je peux détester un film que j’estime raté même si je partage les opinions du cinéaste. La discussion entre spectateurs montre facilement comment chacun établit une balance nécessairement variable entre les différentes composantes du film mais également entre différents critères d’appréciation dont il dispose.
En outre, de façon plus concrète, l’on aperçoit aussi que les dispositions subjectives des spectateurs, qui fonctionnent pour une part comme des critères d’évaluation (et pour une autre part comme des systèmes d’interprétation), ne constituent pas des principes pleinement rationnels, qui seraient dotés d’une grande cohérence formelle et devraient nécessairement aboutir en toutes circonstances aux mêmes jugements : on a déjà relevé combien des critères comme l’originalité, la profondeur du propos, l’importance des thèmes, la beauté, la cohérence, le talent, « l’efficacité », la « richesse humaine », le réalisme et bien d’autres sont flous et imprécis et peuvent être utilisés aussi bien pour louanger que pour dénigrer le même film… Autrement dit, une disposition générale [76] — par exemple une préférence pour le cinéma d’auteur, ou un goût particulier pour les films fantastiques ou tout autre genre de films — est trop vague pour produire des jugements de manière constante ou « mécanique » face à la diversité des œuvres considérées (même à l’intérieur de la filmographie d’un seul cinéaste ou d’un genre comme ceux cités à l’instant).
Enfin, on remarquera que le jugement que nous portons sur les films (ou les romans, ou les œuvres d’art) n’est pas purement individuel : notre jugement sur un film s’élabore ou se modifie également en fonction de l’opinion d’autrui, qu’il s’agisse de celle d’amis ou de connaissances ou bien encore de critiques lues dans la presse. Même si nous tenons plus ou moins fortement à nos opinions personnelles, nous sommes aussi sensibles aux appréciations que peuvent formuler des personnes que nous admirons ou que nous estimons. À l’inverse, il peut arriver qu’un éloge fait par un individu ou un média que nous méprisons ou mésestimons en vienne à discréditer l’œuvre ou le film en cause. Au-delà de ces exemples un peu extrêmes, les conversations d’après projection sont souvent le moment où s’élaborent les opinions, où se construisent de façon plus ou moins équilibrée les appréciations ou se nuancent éventuellement les premiers jugements : si certains films entraînent effectivement une forte adhésion ou au contraire un rejet univoque, la plupart suscitent généralement des réactions plus mitigées qui vont se confronter les unes aux autres avant de se préciser de façon plus définitive.
Bien entendu, la complexité de l’objet filmique comme celle des dispositions spectatorielles ne signifie pas que les opinions en matière de cinéma soient complètement indéterminées et entièrement laissées au hasard : comme la sociologie des pratiques culturelles l’a largement montré [77], on observe des corrélations significatives entre d’une part le capital scolaire et culturel des individus (mesuré notamment en nombre d’années d’études) et d’autre part leurs goûts en matière de consommation culturelle et notamment cinématographique. Ainsi, un film d’art et d’essai aura d’autant plus de chances d’être apprécié (sinon même vu) par un spectateur que le niveau de diplômes de ce dernier sera élevé, tandis qu’une comédie « populaire » (comme son nom l’indique d’ailleurs) sera plutôt goûtée par un public moins éduqué, plus jeune et plus masculin. Mais ce qui vaut de manière générale ou statistique n’empêche pas une grande variabilité individuelle qui va notamment se manifester en situation d’animation.
Comme le savent tous ceux qui ont la pratique de tels débats et animations, il serait donc naïf de croire parvenir à résoudre les conflits en matière de préférences culturelles ou cinématographiques, même en ne s’adressant qu’à un public relativement homogène. En outre, on ne peut pas considérer a priori qu’un point de vue soit supérieur à un autre.
Discussion et réflexion ne sont cependant pas sans objet et peuvent porter sur deux dimensions essentielles. L’interprétation filmique n’est pas close ni limitée et comprend nécessairement, comme on l’a dit, une part plus ou moins importante d’hypothèse. La discussion peut donc faire apparaître d’autres manières de « voir » le film en cause en mettant l’accent sur des aspects qui auraient pu être négligés par d’autres, en dégageant également des significations que d’aucuns n’auraient pas aperçues, en relevant éventuellement certaines erreurs d’interprétation même s’il y a rarement en ce domaine de certitude absolue.
D’autre part, si l’appréciation met nécessairement en jeu des critères d’évaluation propres à chaque individu (au moins dans le poids différent qu’il donne à chacun d’eux), il est certainement intéressant d’amener les spectateurs à expliciter ces critères, c’est-à-dire les raisons nécessairement subjectives pour lesquelles ils ont été sensibles (ou rétifs…) à certains aspects que d’autres ont pu au contraire négliger ou juger accessoires. Ces différences de « sensibilité » ne dépendent pas d’un « goût » ineffable et relèvent de valeurs, jugements et hiérarchies qui restent habituellement implicites mais qui peuvent certainement être l’objet d’une réflexion et donc d’un dialogue avec d’autres spectateurs.
En cela le cinéma, loin de n’être qu’un objet de distraction, est aussi un moyen d’éducation et de communication — au sens le plus fort du terme — entre individus, cinéaste et spectateurs, mais également entre spectateurs, tous égaux dans leur regard sur le film et tous appelés à dialoguer à travers le film.
[1] Les phénomènes abordés ici dépassent sans doute le cadre de la pragmatique qui est une branche de la sémantique s’intéressant notamment aux énoncés « performatifs » où l’énonciation se combine avec une action (comme quand un maire marie un homme et une femme en les déclarant « mari et femme »). Cette approche de type linguistique, même si elle prend en compte le contexte du discours (dans ce cas le film), nous semble peu capable de rendre compte de la diversité réelle des réactions des spectateurs. On remarquera à ce propos que, si le cinéma de fiction s’apparente à première vue à un texte déclaratif (il raconte quelque chose), les réactions qu’il peut susciter semblent indiquer qu’il est souvent perçu comme un texte à valeur performative, c’est-à-dire cherchant à agir sur le spectateur (suscitant ainsi une réaction qui peut être positive ou au contraire négative). De façon imagée, on pourrait dire que le film, loin de se clore sur son propre message, est une adresse aux spectateurs appelés à se manifester à leur tour.
[2] C’est un lieu commun de la pensée critique d’affirmer qu’il n’y aurait pas de différence essentielle entre documentaire et fiction ou qu’à tout le moins, les frontières entre les deux seraient poreuses, sous prétexte que les deux résulteraient d’un travail de mise en scène et comporteraient une part de subjectivité. Mais le critère de différenciation est mal choisi, car la différence entre ces deux genres est constituée par la convention qui lie implicitement le spectateur et l’auteur du film de fiction : quand je vois un Alien dans le film de Ridley Scott, je ne me pose pas la question de savoir si de tels êtres existent ou non, car il s’agit clairement d’un univers de fiction ; en revanche, face à un documentaire, je peux poser la question de la sincérité du cinéaste (n’a-t-il pas payé les personnes qu’il a filmées ?), de la vérité des faits montrés (les images n’ont-elles pas été trafiquées ?) et de leur éventuelle manipulation notamment au montage. On sait aujourd’hui que plusieurs plans de Citizen Kane ont en fait été obtenus par trucage (alors que le célèbre critique André Bazin les avait salués comme des exemples de réalisme), mais ces découvertes ne signifient absolument pas que Welles était un « menteur » ou un « falsificateur ». En revanche, découvrir de tels trucages dans un documentaire décrédibiliserait totalement leur auteur. Enfin, le fait que la frontière entre fiction et documentaire soit poreuse avec l’apparition de réalisations comme les « docu-fictions » (où des faits censément historiques sont mis en scène et interprétés par des acteurs) ne signifie pas que la distinction n’a pas de sens : dans le champ des sciences humaines, il n’y a pas (ou très peu ?) de distinctions absolues, essentielles, formelles, et les réalités doivent plutôt être décrites comme formant un continuum ; mais cela ne signifie pas qu’une distinction ne soit pas pertinente. Personne ne peut tracer précisément la frontière entre la plaine et la montagne, mais cela n’implique pas qu’il n’y a pas de différence entre la plaine et la montagne !
[3] Erwin Panofsky, dans un texte aujourd’hui célèbre (La perspective comme forme symbolique, Paris, Minuit, 1976, éd. or. allemande : 1927) a mis en cause le caractère soi-disant « naturel » de la perspective renaissante dont le principe de projection (celui de la camera obscura) est toujours à l’œuvre dans les appareils photographiques ou les caméras. Pour lui, cette perspective est une forme symbolique, conventionnelle, aussi arbitraire que d’autres modes de représentation. Sans vouloir discuter cette thèse, on remarquera que Panofsky considère essentiellement la procédure d’élaboration de cette perspective (notamment avec Alberti) et beaucoup moins le point de vue des spectateurs. Or, face à une peinture en perspective ou à une photo ou encore à un film, le spectateur n’a pas besoin, pour interpréter cette image en trois dimensions, de recourir à d’autres schèmes sensori-moteurs (pour employer l’expression du psychologue Jean Piaget) que ceux qu’il met en œuvre spontanément dans sa vision quotidienne des choses : cela vaut pour l’image « réaliste » (en prises de vue « réelle » avec des acteurs par exemple) comme pour le dessin animé qui respecte globalement les règles de la perspective. En revanche, face à une peinture égyptienne où un personnage est beaucoup plus grand qu’un autre, seules des informations extérieures nous permettent de comprendre qu’il s’agit par exemple du pharaon devant ses sujets. Cela ne signifie pas que la perspective renaissante soit plus « naturelle » qu’une autre, mais que nous pouvons utiliser, pour « comprendre » ce type de représentations, nos schèmes sensori-moteurs habituels avec des adaptations mineures : c’est ainsi que nous pouvons facilement « voir » une photographie en noir et blanc alors que le monde est en couleurs (sauf pour les daltoniens), mais qu’il nous est beaucoup plus difficile de « lire » la même image en négatif. Celle-ci exige en effet une accommodation (selon la terminologie de Piaget) beaucoup plus importante, même si elle respecte les « règles » de la perspective. En fait, devant n’importe quelle image figurative, qu’elle respecte ou non les conventions de la perspective renaissante, nous mettons en œuvre nos schèmes habituels de perception des objets « réels » : cela nous permet de reconnaître par exemple une figure humaine (ou animale) dans une peinture égyptienne ou chinoise… Mais, l’absence ou le non-respect des conventions de la perspective renaissante nous oblige à recourir à d’autres procédures pour interpréter correctement la disposition ou la taille des figures représentées (bien entendu, dans certains cas, une telle interprétation n’a même pas de sens : les icônes byzantines à plusieurs personnages — comme la présentation de Jésus au Temple ou des scènes de la Passion du Christ— ne visent évidemment pas à nous renseigner sur la taille supposée des personnages même si nous reconnaissons immédiatement qu’il s’agit là de figures « humaines »).
[4] On signalera que les règles du montage, parfois présentées comme l’équivalent des règles de grammaire, ont été élaborées précisément pour tenir compte des procédures spontanées d’interprétation des spectateurs. Ainsi, la règle des 180° exige que, dans un face-à-face entre deux personnages par exemple, la caméra reste toujours du même côté de la ligne imaginaire (celle dite des 180°…) qui unit les deux personnages, afin qu’à la projection, les spectateurs n’aient pas l’impression d’une incohérence due au fait que le personnage qui regardait d’abord vers la gauche (ou l’inverse) ne regarde quelques plans plus loin vers la droite (ou l’inverse) comme s’il avait changé brutalement de position. Mais cette règle de montage vise précisément à respecter l’interprétation spontanée des spectateurs qui déterminent la position des personnages mis en scène non pas de façon absolue (en tenant compte par exemple du décor où ils se trouvent) mais en fonction des bords du cadre, ce qui est sans doute une « faute logique » mais s’explique par une « paresse » naturelle (l’effort mental est évidemment moindre). Il s’agit donc bien là de règles de réalisation qui ne doivent absolument pas être maîtrisées par les spectateurs et dont l’objectif est précisément de faciliter leur compréhension spontanée.
[5] Ce point a été développé ailleurs : voir « DVD et analyse de séquences ».
[6] Cette analyse épistémologique est notamment celle d’Umberto Eco dans Les Limites de l’interprétation (Paris, Grasset, 1992) qui s’inspirait sur ce point de la théorie développée par Karl Popper dans La Logique de la découverte scientifique (Paris, Payot, 1973, éd. or. allemande : 1932).
[7] Un tel détail n’aurait sans doute pas la même valeur dans un documentaire ou un reportage sur les archives de la STASI : dans ce cas, il pourrait s’agir effectivement d’un détail insignifiant, filmé par hasard.
[8] Comme dans l’exemple évoqué précédemment, les spectateurs reconnaissent en général dans un tel cas s’être trompés. Lorsque la discussion persiste, cela signifie que l’interprétation, dans un sens ou dans un autre, comprend une part essentielle d’hypothèse (ce qui ne signifie pas que certaines personnes ne soient pas de mauvaise foi ou emportées par la passion ou le « fanatisme »…).
[9] En pratique, on observe évidemment un recouvrement des points de vue. Néanmoins, les débats révèlent en général des différences d’approches relativement importantes, certaines approches étant centrées soit sur les thèmes du film (politiques, sociaux, humains…), soit sur les personnages (leurs réactions, leur comportement, leurs attitudes…), ou bien sur les intentions supposées de l’auteur du film (ses prises de position sous-jacentes, ses opinions, ses valeurs…), ou encore sur l’esthétique générale du film (réaliste, stéréotypée, originale, spectaculaire…). On remarque également souvent une grande différence d’approches entre ceux qui adoptent un point de vue moral, éthique, politique ou idéologique sur les films (avec alors une grande importance accordée au caractère réaliste ou non du film en cause) et ceux qui préfèrent un regard esthétique (ou artistique) sur les œuvres.
[10] Le philosophe Hilary Putnam (Fait/Valeur : la fin d'un dogme et autres essais, Paris, Éditions de l’Éclat, 2004, éd. or. 2002) parle à ce propos de« concepts éthiques épais » (thick ethical concepts), c’est-à-dire de concepts qui ont une composante à la fois descriptive et prescriptive : ainsi, traiter quelqu’un de « cruel » induit une description mais également une condamnation morale de son comportement. Putnam remarque cependant qu’il est presque impossible de distinguer ces deux composantes : ainsi, la description « faire souffrir » ne peut pas être considérée indépendamment de l’évaluation, car il y a des circonstances où « faire souffrir » n’est pas de la cruauté (par exemple pour un chirurgien opérant avant le règne de l’anesthésie). Dans le domaine artistique, qualifier un film de « réaliste » est à la fois une caractérisation et une évaluation (généralement) positive, sans qu’on puisse non plus dissocier facilement ces deux dimensions : on ne considérera pas par exemple qu’un enregistrement d’une caméra de surveillance est « réaliste ». Si les analyses de Putnam sont encore discutées aujourd’hui, elles soulignent cependant le passage facile et presque instantané que nous opérons dans les conversations courantes entre la description et l’évaluation : dans une situation d’animation, il convient donc d’être attentif à de tels passages en demandant notamment aux participants de clarifier, dans la mesure du possible, la portée de leurs propos et en particulier ce sur quoi se fondent leurs jugements de valeur (implicites ou explicites).
[11] On signalera à ce propos qu’aux yeux de la loi protégeant le droit des auteurs, toute création doit se caractériser par une forme originale pour jouir de cette protection : autrement dit, dans les faits, toutes les productions cinématographiques présentes sur le marché qui bénéficient de ce droit sont considérées comme « originales », ce qui témoigne encore une fois de la grande flexibilité de ce concept.
[12] Marc Jimenez, La querelle de l’art contemporain. Paris, Gallimard, 2005, p . 257.
[13] Il n’est d’ailleurs pas sûr que musiciens ou musicologues soient eux-mêmes capables d’expliquer le plaisir que provoque une œuvre musicale, et pourquoi par exemple la célèbre Toccata et Fugue en ré mineur (BWV 565) de Jean-Sébastien Bach est bien plus largement appréciée que la Toccata, Adagio et Fugue (BWV 564) du même Bach.
[14] On ne parle évidemment pas ici de films dont le propos idéologique est très clair et nous révolte ouvertement comme le ferait par exemple un film ouvertement antisémite comme le Juif Süss réalisé par Veit Harlan sous la direction de Goebbels pendant la Seconde Guerre mondiale (Allemagne, 1940).
[15] Évoquant la « souffrance à distance » (par exemple montrée à la télévision), Luc Boltanski distingue trois grandes topiques possibles : celle de la dénonciation (qui s’en prend au responsable supposé de cette souffrance), celle du sentiment (qui s’apitoie sur la victime) et enfin une topique « esthétique » qui refuse aussi bien l’indignation que l’attendrissement et qui « dévoile l’horreur et l’identifie au mal — à un mal irréductible à toute compréhension, qu’elle soit scientifique ou religieuse et que peut seule appréhender une saisie esthétique du monde » (Luc Boltanski, La Souffrance à distance, Paris, Gallimard (Folio), 2007, p. 236). Cette topique serait celle par exemple d’un Baudelaire qui, dans le Spleen de Paris, peut décrire des pauvres de façon presque sentimentale avant de couper court à tout attendrissement par une saillie brutale et cruelle. Une telle topique peut se retrouver au cinéma mais est rarement « pure » et se mêle en général avec d’autres considérations. En outre, plusieurs films évoqués ici ne relèvent pas de cette topique « esthétique », et leur « dispositif » — qui privilégie le « questionnement », la « monstration » brute des faits, « l’ambiguïté » nécessaire de toute réalité — semble avoir été négligée par Boltanski. Cette « posture » est par ailleurs reliée à une idéologie qui entend respecter la « liberté d’interprétation » du spectateur face à la réalité, dont on trouve une première expression largement développée chez André Bazin (Qu’est-ce que le cinéma ? Paris, Cerf, 1985, 1ère éd. 1958).
[16] On peut penser à un film comme Point Break réalisé par Kathryn Bigelow (USA, 1991, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze), un film policier mettant en scène des personnages « virils » de surfeurs et braqueurs de banques… Le monde du cinéma reste soumis à une division sexuée du travail, et, si les scripts-girls, comme leur nom l’indique, sont souvent des femmes, les cinéastes sont majoritairement des hommes (ce qui pourrait éventuellement changer à l’avenir).
[17] On sait que les interviews de Jean-Luc Godard sont souvent aussi absconses que ses films…
[18] Sur la rapidité de cette prise de conscience, on se reportera à l’anthologie de textes choisis et présentés par Daniel Banda et José Moure, Le Cinéma : naissance d’un art. 1895-1920, Paris, Flammarion (Champs), 2008.
[19] Le premier ouvrage en France sur la question date de 1884 (Louis Becq de Fouquières, L'art de la mise en scène, Paris, Charpentier, 1884)
[20] On rappellera que la « politique des auteurs » défendue par les Cahiers du Cinéma a consisté à montrer précisément dans le cas du cinéma américain que les meilleurs des cinéastes — considérés dès lors comme des « auteurs » — étaient capables de résister aux pressions de la production (orientées dans un sens commercial visant à plaire au large public) et à marquer de leur empreinte personnelle (au niveau thématique et/ou formel) leurs différentes réalisations. Il n’est pas sûr cependant que cette manière de concevoir le cinéma américain — avec des cinéastes artistes masqués cherchant à s’opposer à des producteurs avides uniquement d’argent — corresponde à la réalité du travail sur le terrain.
[21] Ce fut le cas notamment avec des films comme Batman de Tim Burton (1989) ou plus récemment de Vengeance de Johnnie To (2009 avec Johnny Hallyday) qui furent notamment applaudis par les critiques des Cahiers du Cinéma alors que beaucoup de spectateurs n’y voyaient que les clichés du genre.
[22] On peut citer par exemple le film Juno de Jason Reitman (2008) dont le scénario a été écrit par une jeune femme, Diablo Cody : le film raconte l’histoire d’une jeune fille de seize ans qui se retrouve enceinte et qui, après avoir décidé d’avorter, y renonce et préfère faire adopter son futur enfant par un couple stérile. Certains spectateurs, aux États-Unis mais aussi en Europe, ont pu voir dans cette histoire une condamnation implicite de l’avortement, à tel point que la scénariste a dû s’exprimer à ce propos et préciser qu’elle était bien en faveur de la liberté de choix de la mère. L’on comprend cependant que, dans le contexte américain, une comédie relativement légère comme Juno puisse difficilement traduire une opinion tranchée sur la question et que ses auteurs préfèrent laisser planer un certain doute ou une certaine ambivalence dans leur film.
[23] Le cinéaste iranien Abbas Kiarostami fait entièrement se dérouler son film Ten (2002) dans l’habitacle d’une voiture où il filme (à l’aide de deux caméras vidéo) la conductrice et son passager ou sa passagère en champ-contrechamp (en dix séquences successives). Il a pu expliquer dans des interviews qu’il avait choisi cette manière de faire parce qu’il ne pouvait pas filmer une femme non-voilée (comme elle le serait à la maison) et que c’était la seule situation où une femme pouvait à la fois être voilée mais en situation de s’exprimer sans contrainte (puisque dans l’habitacle d’une auto).
[24] Ainsi, dans son film Do the Right Thing (USA, 1988), le cinéaste afro-américain Spike Lee fait deux citations relativement opposées, l’une de Martin Luther King (qui affirme que la violence n’est jamais justifiée), et l’autre de Malcolm X (qui légitime la violence comme autodéfense) : l’histoire mise en scène ne donne sans doute raison ni à l’une ni à l’autre, privilégiant une certaine ambiguïté ou une certaine ambivalence de la réalité. Dans certaines interviews en revanche, Spike Lee a pu dire que la position de Malcolm X lui semblait dans les faits plus juste. Dans ce cas, l’on peut penser que l’interview favorise une interprétation unilatérale d’un film qui peut être vu de façon plus ambiguë. Un autre exemple est celui de Renoir déclarant que La Règle du jeu (réalisé en 1939) « est un film de guerre, et pourtant pas une allusion à la guerre n'y est faite. Sous son apparence bénigne, cette histoire s'attaquait à la structure même de la société. » Beaucoup de critiques se sont appuyés sur cette déclaration pour affirmer que le film était prémonitoire de la Seconde Guerre mondiale et que l’histoire mise en scène était « le meilleur moyen de parler de l’état d’esprit de la société de l’époque, qui refusait de voir la gravité de la situation et s’estimait soulagée par les accords de Munich » (Pierre Guislin et alii, La Règle du jeu, Hatier (Profil d’une œuvre), 1998, p. 107). Cette déclaration de Renoir est cependant postérieure à la guerre, alors que son film montre bien plus le rétablissement hypocrite de l’ordre social qu’il n’évoque une quelconque catastrophe à venir : on a donc des raisons de penser que la déclaration de Renoir est une réinterprétation de son film et ne correspond pas réellement aux intentions qui étaient les siennes au moment de la réalisation. (On remarquera d’ailleurs le glissement sémantique qu’opère Renoir qui passe d’un conflit social à la « guerre » qui est quelque chose de très différent : car, si le film parle explicitement de la « lutte des classes », il ne parle pas du tout de la guerre, en particulier de la guerre mondiale qui aura bientôt lieu. Seul ce glissement sémantique permet à Renoir de prêter à son film un propos qu’il n’avait sans doute pas au moment de sa réalisation.)
[25] Un exemple permettra d’éclairer ce point. Le Juif Süss, réalisé par Veit Harlan en 1940 (Jud Süß, Allemagne), est un film incontestablement antisémite qui décrit les Juifs de façon particulièrement dénigrante et haineuse. Le cinéaste devra d’ailleurs affronter après la guerre deux procès aux termes desquels il sera néanmoins acquitté. Il expliquera alors pour se justifier qu’il aurait été contraint, au moment de la réalisation, par Joseph Goebbels (jouant le rôle de producteur) de procéder à des modifications importantes dans un sens antisémite. On voit évidemment tout ce que ces propos avaient d’intéressé dans le contexte d’après-guerre, mais seule une recherche historique pourrait effectivement déterminer la part exacte de Goebbels et de Veit Harlan dans cette réalisation, sans d’ailleurs innocenter le cinéaste de sa complicité plus ou moins active. Enfin, même si l’on imagine que le cinéaste n’ait pas été personnellement antisémite (ce qui est peu vraisemblable), on voit aussi que cela ne l’empêcherait pas d’avoir réalisé un film clairement antisémite, un film dont l’intention et le responsable moral, quel(s) qu’il(s) soi(en)t, doivent être reconnus comme pleinement antisémites. S’il s’agit là d’un cas extrême, il montre cependant bien qu’on ne doit pas immédiatement confondre la personne réelle du cinéaste et l’auteur comme figure filmique, responsable (dans tous les sens du terme) du propos du film. (Contrairement cependant à une tendance critique radicale qui prétend qu’il ne faut jamais confondre ces deux instances — illustrée par le célèbre Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust—, on doit néanmoins penser qu’il y a nécessairement un recouvrement entre les deux, même s’il est difficile à déterminer et ne peut l’être que par une recherche historique : il ne saurait en effet être question de dédouaner quelqu’un comme Veit Harlan de toute responsabilité dans la réalisation d’un tel film.)
[26] On apprend d’ailleurs aux enfants, qui peuvent parfois être extrêmement affectés par certains films, à prendre une telle distance en soulignant par exemple qu’« il ne s’agit que d’un film » ou « d’une histoire ».
[27] On peut se reporter notamment à Christian Metz, L’énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, Klincksieck (Méridiens), 1991.
[28] Un cadrage oblique consiste à basculer légèrement la caméra sur le côté, ce qui fait que les lignes verticales et horizontales du paysage filmé ne sont plus parallèles au bord de l’écran mais obliques. Les cadrages obliques sont plus rares et ressentis comme plus inhabituels que les plongées ou contre-plongées qui, elles, semblent généralement imiter le mouvement naturel de la tête qui se penche vers l’avant ou vers l’arrière.
[29] Un
plan-séquence consiste à filmer une séquence (généralement de plusieurs
minutes) en continu sans aucune coupe. Cette manière de faire est aujourd’hui
inhabituelle au cinéma où l’on préfère un montage dynamique avec un grand
nombre de coupes et un grand nombre de plans sous des angles différents :
on filmera par exemple les deux interlocuteurs d’un dialogue, l’un après
l’autre, de différents points de vue, alors qu’un plan-séquence suivra les deux
interlocuteurs sans interruption avec éventuellement des mouvements de caméra
plus ou moins souples. Un plan-séquence demande une grande habileté technique
notamment lorsqu’il s’accompagne de mouvements de caméra pour suivre les
déplacements des personnages, mais également une maîtrise artistique des
acteurs qui doivent être capables de jouer sans interruption leur rôle pendant
un long moment. Il faut savoir par ailleurs que le plan-séquence est très
valorisé sur le plan esthétique, en particulier en France, depuis qu'André Bazin a vu, dans « ce refus de morceler
l’événement, d’analyser dans le temps l’aire dramatique », « une
opération positive dont l’effet est supérieur à celui qu’aurait pu produire le
découpage classique » notamment parce qu’il respecte la continuité
temporelle et l’homogénéité de l’espace, contribuant ainsi à l’impression de
réalisme produite par le film (Qu’est-ce que le cinéma ? Paris, Cerf, 1985, p. 63-80).
L’un des exemples les plus célèbres de plan-séquence est celui d’ouverture de La
Soif du mal d’Orson Welles (Touch of Evil,
USA, 1959) qui se déroule à la frontière américano-mexicaine : la caméra
montre d’abord un homme mettant une bombe à retardement dans le coffre d’une
voiture dans laquelle prend place un couple quelques secondes après ; s’élevant
dans les airs, la caméra va pourtant suivre cette auto que croise bientôt un
autre couple à pied et se dirigeant lui aussi vers le poste frontière ;
revenue à hauteur d’homme mais toujours en mouvement, la caméra s’attache alors
à ce couple qui s’adresse au douanier alors que l’auto avec la bombe passe
derrière eux et les dépasse ; le couple arrivé aux États-Unis va
s’embrasser quand on entend l’explosion de la bombe qui a lieu hors cadre.
L’ensemble du plan dure plus de trois minutes.
[30] L’expression « cadrage oblique » est couramment utilisée dans le domaine cinématographique, mais son contraire (qu’on a appelé ici cadrage « droit ») n’a pas de nom parce qu’il est considéré comme « normal », « neutre », habituel et à la limite insignifiant. Comme on l’expliquera un peu plus loin, il n’y a pas cependant de point de vue réellement « neutre ».
[31] Le son off peut être défini comme un son dont la source n’apparaît pas à l’écran et qui appartient à un autre temps et à un autre lieu que les événements mis en scène (par opposition par exemple aux bruits de la rue entendus à l’intérieur de l’appartement où se déroule l’action du film). Une voix off sera par exemple celle d’un narrateur extérieur ou d’un personnage qui se souvient d’événements vécus précédemment et montrés à l’image (par exemple Platoon d’Oliver Stone, USA, où le personnage revenu du Viêt-nam se souvient de ce qu’il a vécu comme fantassin). La voix intérieure d’un personnage qu’on voit à l’écran mais qui ne prononce aucune parole peut également être considérée comme une voix off dans la mesure où l’intériorité n’appartient pas au même « espace-temps » que l’extériorité objective. Sur l’analyse du son au cinéma, on se reportera aux nombreux ouvrages de Michel Chion (par exemple L’audio-vision, Paris, Nathan (Université), 1990).
[32] On trouvera dans l’ouvrage cité de Christian Metz beaucoup d’autres exemples de ces différentes sortes de « marques de l’énonciation ».
[33] La steadicam est une espèce de harnais porté par le cameraman et équipé d’un système de ressorts et de contrepoids qui permettent d’atténuer sensiblement les mouvements de la caméra lorsque son porteur est en mouvement. Le spectateur a ainsi l’impression d’une caméra effectivement portée à hauteur d’homme mais avec des mouvements plus stables et beaucoup moins heurtés qu’avec une caméra portée à la main ou à l’épaule. Ce système développé dans les années 1970 est depuis lors largement employé au cinéma et a permis notamment de réaliser des plans-séquences en mouvement très spectaculaires (The Shining de Stanley Kubrick, USA, 1980, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, USA, 1994, Carlito’s Way de Brian DePalma, USA, 1993, etc.).
[34] De manière un peu critique, on remarquera que les analystes et critiques du cinéma qui ont étudié ces « marques de l’énonciation » leur confèrent une grande importance pour des raisons qui ne sont pas purement théoriques et qui tiennent à l’histoire du cinéma, précédemment évoquée : comme on l’a vu, la figure du cinéaste s’est progressivement imposée comme le véritable auteur du film (au détriment notamment de l’éventuel scénariste), et il était donc important pour ces analystes de mettre en évidence des « marques de l’énonciation » qui traduisent bien l’intervention du cinéaste et non pas du scénariste (même si leurs rôles respectifs ne peuvent pas être déterminés de façon purement formelle en ne tenant compte que du film lui-même). Ainsi, bien qu’elle soit particulièrement révélatrice du point de vue de l’auteur du récit, l’axiologie des personnages, qui oppose dans un très grand nombre de films les « bons » et les « méchants » ou les individus « sympathiques » et « antipathiques », est complètement négligée par ces analystes parce qu’elle est souvent le fait du scénariste et non pas du cinéaste (même si l’on peut supposer qu’il la reprend souvent à son compte).
[35] Michel Chion a en particulier bien étudié l’aspect sonore des films de Tati (Jacques Tati. Paris, Cahiers du Cinéma, 2008).
[36] La situation est très différente lorsqu’on voit par exemple un film d’action comme un James Bond en s’identifiant au personnage : dans ce cas, nous tirons un plaisir de l’histoire elle-même sans chercher à généraliser le propos à d’autres situations. En revanche, si l’on réfléchit au point de vue de l’auteur d’un tel film, par exemple en soulignant la dimension manichéenne de ce genre de films marqués par le climat de la Guerre froide, on se distancie évidemment du personnage en prenant appui sur un contexte politique général qui permet notamment de définir les choix idéologiques qui ont vraisemblablement orienté cet auteur.
[37] Comme expliqué précédemment, il n’existe pas de règles qui permettraient de définir l’interprétation juste ou correcte, mais l’on peut néanmoins déterminer par la confrontation des opinions si une interprétation est plus ou moins convaincante et vraisemblable. Ainsi, certains spectateurs du film Juno, précédemment évoqué, ont conclu du fait que la jeune héroïne renonçait à avorter pour finalement faire adopter son futur enfant, que l’auteur du film et de son scénario faisait un plaidoyer contre l’avortement : cette interprétation est néanmoins rejetée comme unilatérale par la plupart des spectateurs (on ne peut pas généraliser le comportement de l’héroïne comme devant s’appliquer à toutes les jeunes filles dans la même situation) et a par ailleurs été contredite par le cinéaste et sa scénariste dans diverses déclarations.
[38] Les forums sur Internet consacrés au cinéma permettent de mesurer les divergences d’appréciation entre spectateurs, parfois masquées par une certaine unanimité critique (alors facilement dénoncée comme une imposture).
[39] Spontanément, nous trouvons un sens aux choses auxquelles nous sommes déjà habitués : l’amateur d’opéra ou de comédies musicales ne s’étonne pas que les personnages sur scène s’expriment par le chant ou la chanson plutôt que par des paroles. Il s’agit d’une convention partagée par tous les amateurs qui seraient sans doute bien en peine de la justifier ou de l’expliquer. Semblablement, la « lenteur » qui caractérise un très grand nombre de films d’auteur (comme Elephant) est en fait admise comme une convention, une caractéristique stylistique qui n’a pas besoin d’être réellement commentée par les spectateurs qui apprécient ces films : s’ils sont néanmoins sommés de le faire (par exemple au cours d’un débat), ils le feront le plus souvent en opposant deux types de cinéma, l’un visant essentiellement la distraction, et l’autre dont l’originalité est précisément de refuser un tel effet au profit de la perception du temps réel. L’habituation joue en fait un rôle essentiel dans le champ artistique ou esthétique, et plus on voit ce genre de films et moins on a de raisons de justifier ou d’expliquer leur éventuelle « lenteur » qui est perçue comme « naturelle » (la « sensibilité commune » résulte donc d’une intériorisation progressive d’une norme implicite).
[40] C’est déjà la conception du réalisme que défendait André Bazin et qui est toujours largement présente dans le champ cinématographique, notamment en France. Cette conception permet notamment d’opposer deux types de cinémas, l’un qui préférerait la monstration de la réalité à l’interprétation qu’on peut en donner, et l’autre, implicitement dévalorisé, pour lequel le « message », la « signification », « l’idéologie » primeraient sur la réalité elle-même qui serait en définitive « gommée » ou évacuée. L’opposition ainsi constituée méconnaît cependant le fait que la réalité n’est jamais totalement « brute » et qu’elle est immédiatement prise dans des processus d’interprétation (affirmer que la réalité est « complexe » par exemple, c’est évidemment lui donner une certaine signification) : un documentariste ne filme pas n’importe quelle « réalité », il choisit de montrer une réalité qui a une certaine pertinence à ses yeux, un intérêt, un sens, même si son choix reste pour une part implicite (la plupart des documentaristes s’intéressent par exemple à des réalités, parfois prosaïques, souvent douloureuses ou cruelles, qui sont pourtant ignorées par les autres médias audiovisuels et en particulier par la télévision).
[41] Un jugement négatif comme accuser un cinéaste de faire un film au propos obscur pour plaire à des critiques snobs est également une manière de donner du sens à un film en le reliant à un contexte socioculturel plus large (le snobisme supposé de certains intellectuels). Bien entendu, un tel jugement est largement hypothétique, et d’aucuns auront sans doute d’autres interprétations à faire valoir.
[42] Il était une fois dans l’Ouest fut un échec commercial aux États-Unis (où il fut présenté dans une version raccourcie) mais connut un énorme succès en Europe.
[43] On voit par exemple que des films qui ont un propos relativement similaire sur une problématique comme l’immigration clandestine —Welcome de Philippe Lioret et Eden à l’Ouest de Costa-Gavras, sortis tous les deux en France en 2009 — ont des esthétiques tout à fait différentes, l’un se présentant plutôt comme une fiction dramatisée avec une approche documentaire, tandis que l’autre apparaît plutôt comme une fable humaniste qui oscille entre le drame et la comédie, mais aussi entre le rêve et l’imaginaire.
[44] L’animateur peut être lui-même victime, comme n’importe quel spectateur, de la séduction qu’une interprétation originale exerce sur son auteur : lorsqu’on parvient à élaborer une telle interprétation, il est difficile de ne pas croire qu’elle est « vraie » et qu’elle devrait être partagée par tous, en oubliant ainsi la part d’hypothèse qu’elle contient.
[45] Cf. Bernard Rimé, Le Partage social des émotions. Paris, PUF, 2005.
[46] Dans son ouvrage de synthèse sur la Critique de cinéma, Réné Prédal accuse ainsi le magazine Première de « [réduire] la fonction critique à celle de miroir du succès commercial et la revue exprime exactement ce que ressentent les lecteurs » (Paris, Armand Colin, 2004, p. 110). Pour Prédal, le véritable rôle de la critique est donc bien de s’opposer au goût dominant, même si cette attitude s’accompagne également du sentiment (souvent teinté de paranoïa) d’une « normalisation » croissante exercée aussi bien par la production cinématographique que par un public inculte (Prédal parle notamment de « l’inculture de l’adolescent ») et des journalistes démagogues.
[47] L’importance symbolique des universités peut ainsi sembler négligeable, mais, outre qu’elles forment de nombreux professionnels du cinéma (auxquels elles transmettent des manières de faire et de juger les films), elles jouent aujourd’hui un rôle non négligeable dans la constitution d’une histoire du cinéma qu’elles enseignent en sélectionnant des titres jugés par elles remarquables et auxquels elles donnent également accès en favorisant leur réédition (grâce aux cinémathèques qui seules disposent aujourd’hui des copies des films anciens).
[48] Parmi les nombreux ouvrages d’initiation au « langage cinématographique », citons celui classique mais toujours actuel de Marcel Martin, Le Langage cinématographique (Paris, Cerf, 1955, souvent réédité).
[49] Il n’est pas possible en fait de définir de façon formelle ce qui serait « spécifiquement » cinématographique, et c’est notre connaissance « externe » du processus de réalisation (même si cette connaissance est sommaire) qui nous amènera à décréter que tel élément relève de l’art ou du langage cinématographique, et tel autre non (comme les trucages qui sont généralement considérés comme des questions techniques). C’est ainsi que le scénario sera plus facilement analysé chez des cinéastes dont on sait qu’ils sont leurs propres scénaristes (comme les frères Dardenne) que chez un auteur qui se contente d’adapter en certains cas un texte préalable (comme Jean Renoir réalisant Une partie de campagne d’après Maupassant).
[50] L’histoire des ciné-clubs est étroitement liée à celle de la critique cinématographique : le premier ciné-club — c’est-à-dire une projection suivie d’un débat et d’une rencontre avec le public — est organisé par Louis Delluc, critique et cinéaste, en 1921 (au Colisée à Paris). Il s’agit déjà pour lui de défendre le cinéma comme art contre les « puissances de l’argent ». Cette première initiative sera suivie de la création en 1924 du Ciné-Club de France qui a pour objectifs « l’étude, le développement et la défense de l’Art cinématographique ». Ce mouvement va essaimer, avec des hauts et des bas, dans toute la France au cours des années 30 et connaître des équivalents dans d’autres pays européens. Parallèlement à la défense du Septième Art, beaucoup de ciné-clubs vont par ailleurs prendre une coloration politique à une époque où le cinéma soviétique, notamment le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein, est interdit par la censure. Si la guerre met un terme (partiel) à ce développement, les ciné-clubs renaissent aussitôt après et connaissent un nouvel essor remarquable qui débouchera notamment sur la création en 1947 d’une Fédération Internationale des Ciné-Clubs couvrant une quarantaine de pays. Cela n’empêche pas de profondes divisions au sein même des ciné-clubs selon les opinions politiques des uns et des autres (entre communistes et catholiques en particulier, qui essaient les uns comme les autres de maintenir leur emprise idéologique sur le public). C’est autour de ces ciné-clubs que va se constituer, en France en particulier, une nouvelle génération de critiques et de futurs cinéastes qui formeront la Nouvelle Vague à la fin des années 50 (voir, sur cette filiation complexe, l’article de Fabrice Montebello, « Les intellectuels, le peuple et le cinéma » dans Pierre-Jean Benghozi et Christian Delage (sous la direction de), Une histoire économique du cinéma français (1895-1995), Paris, L’Harmattan, 1997, p. 152-180). Cet âge d’or des ciné-clubs se prolongera jusqu’à l’aube des années 80 à un moment où ils seront concurrencés par un nouveau réseau de salles dites d’Art et Essai. Offrant une programmation plus régulière et plus diversifiée ainsi que souvent de meilleures conditions de confort, ces cinémas sont reconnus en France par un label officiel octroyé par le Centre National de la Cinématographie. Il s’agit en général de salles indépendantes (ou de petits complexes) qui se sont affirmées face au développement des complexes commerciaux (apparus au cours des années 70) puis des multiplexes qui s’installent en périphérie des grandes villes à partir des années 90. Les salles d’Art et Essai ont en principe pour vocation de montrer des films présentant un caractère de recherche et de nouveauté, des films appartenant à des cinématographies minoritaires ou mal diffusées (par exemple d’autres pays européens ou d’Asie et d’Afrique), ainsi que tout film de qualité méritant une meilleure diffusion que celle assurée par les salles commerciales.
[51] André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ? Paris, Cerf, 1985, p. 13.
[52] Les analyses de Bazin ne sont plus acceptables en tant que telles aujourd’hui quand on sait que Welles a notamment recouru à de nombreux trucages pour créer une profondeur de champ dans de nombreux plans de son célèbre film Citizen Kane.
[53] Dans cette perspective critique, Bowling for Columbine ne sera d’ailleurs pas qualifié de documentaire (mais de simple reportage) précisément parce qu’il est trop « bavard » et qu’il interprète plus la réalité qu’il ne la montre.
[54] Lorsqu’on examine cette attitude critique, il n’est pas possible pratiquement de l’isoler des films qu’elle analyse et qui eux-mêmes sont (pour une part) réalisés selon les principes qu’elle énonce. Généralement, de tels films peuvent être difficilement appréciés si l’on ne maîtrise pas les principes d’évaluation de ce genre de critique.
[55] Une analyse complète de cette séquence peut être lue dans l’ouvrage d’Alain Philippon, À nos amours de Maurice Pialat, Crisnée, Yellow Now, 1989, p. 25-28.
[56] Pour rappel, il s’agit d’un plan filmé en continu pendant un long moment correspondant en principe à l’unité d’une séquence. Dans le film cité de Cristian Mungiu, on devrait plutôt parler de plans longs, car plusieurs coupes (avec donc des changements de plans) sont faites à des moments décisifs.
[57] La steadicam est un ensemble formé d’une caméra fixée sur un harnais porté par un opérateur avec un système de poids et de contrepoids qui permet d’atténuer les mouvements de la caméra tout en lui donnant une grande mobilité.
[58] Gilles Deleuze a donné une interprétation philosophique de cette opposition entre le cinéma classique et le cinéma moderne sous la forme d’une opposition entre ce qu’il appelle l’image-mouvement, où les gestes visent toujours à une résolution de l’action, et l’image-temps où le temps se libère de la logique de l’action et apparaît en tant que tel (Gilles Deleuze, L’Image-mouvement & L’Image-temps. Paris, Minuit (Critique),1983 &1985).
[59] Alain Bergala, grand admirateur de Roberto Rossellini et de son Voyage en Italie, doit finalement reconnaître au terme de son analyse que l’explication de ce dispositif ne peut convaincre que ceux qu’il appelle les « rossellino-sensibles » : « certains ne le seront jamais, c’est une non-disposition irrémédiable : il est impossible “d’apprendre” à aimer Rossellini » (op. cit. p. 63). L’explication par un fait de nature est peut-être un peu courte, et l’on peut penser que cette « sensibilité » dépend aussi de critères, de valeurs, de convictions, peut-être également d’histoires personnelles, variables selon les individus, sans doute implicites mais qui ne sont pas totalement mystérieuses. Ainsi, la dimension religieuse du Voyage en Italie suffit à expliquer l’insensibilité d’un certain nombre de spectateurs à ce film, alors que Bergala doit recourir à un langage du même style pour expliquer sa propre émotion (la « Transcendance », le « sacré », la « grâce », « les plus purs », « une haute exigence », « une vérité que seul le cinéma pouvait révéler », « purger son orgueil », « la femme, entre couple et coulpe », « mystère », « jaillir à la fois un et multiple, lumineux et insaisissable »…).
[60] Alain Bergala, op. cit., p. 25.
[61] Andy Warhol a néanmoins filmé la nuit l’Empire State Building illuminé pendant huit heures en plan fixe et en continu. Outre la dimension de provocation, on comprend néanmoins l’aspect symbolique du bâtiment ainsi choisi pour cette expérience. Quant à Blow Job du même Andy Warhol qui filme pendant trente-cinq minutes le visage d’un jeune homme muet mais très expressif, le titre suffit à expliquer « l’intérêt » de cette scène.
[62] D’un point de vue sociologique, les tenants de la Nouvelle Vague en France se signalent par un capital scolaire plus important (de niveau supérieur même si certains ont connu des échecs relatifs) que leurs prédécesseurs du « cinéma de qualité française », moins bien dotés et porteurs d’habitus petits-bourgeois avec des conceptions plus proches de l’artisanat que celles des artistes des champs les plus légitimes (littérature, peinture…). Ils ont alors importé dans le champ cinématographique un savoir inspiré plus ou moins directement de la psychanalyse à travers différentes médiations (comme l’existentialisme sartrien dominant le champ intellectuel dans les années 1950). La maîtrise d’un tel savoir (sur un mode implicite ou explicite) a, d’une part, entraîné une représentation plus nuancée ou plus complexe de la subjectivité individuelle (avec par exemple une thématique comme celle de l’incommunicabilité chez Antonioni), et, d’autre part, permis de donner un sens à des comportements ou des attitudes devenus effectivement plus énigmatiques. On remarquera encore que, si, depuis le discrédit du « roman psychologique » de Paul Bourget, la psychologie (à l’exception de la psychanalyse) fait l’objet dans le champ artistique d’un déni massif, la philosophie (ou du moins certains secteurs) a également permis de donner (ou de trouver) un sens à ce cinéma « moderne » avec notamment des notions comme « l’absurde » (Sartre, Camus), « l’aliénation » (Marx et ses épigones), la « différence » (Derrida, Deleuze), etc.
[63] L’empathie, c’est-à-dire la capacité à adopter le point de vue d’autrui et à partager imaginairement ses sentiments et ses émotions, est sans doute une disposition subjective variable selon les individus (on estimera par exemple que certaines personnes qualifiées de « narcissiques » ou d’« égocentriques » sont moins sensibles que d’autres à la détresse d’autrui), mais elle comporte également une importante composante cognitive dans la mesure où elle implique une représentation (hypothétique d’ailleurs) de l’état mental d’autrui sur base notamment de la situation vécue par cet autrui et de la perspective (nécessairement singulière) qu’il a sur cette situation. Une telle capacité cognitive à se représenter le point de vue d’autrui dépend notamment de l’histoire individuelle et des expériences vécues par chacun et transformées dès lors en « expérience » (c’est-à-dire en une forme de savoir). C’est ce qui explique notamment que la même personne, enfant, adolescent ou adulte, ait une capacité d’empathie très différente face aux mêmes situations (vécues par autrui), selon qu’il a personnellement déjà fait ou non des expériences similaires. On remarquera que l’empathie sur base cognitive joue un rôle essentiel au cinéma où l’identification aux personnages (fictifs) se fait nécessairement à travers les informations délivrées par le film mais dépend également des dispositions des spectateurs : le même film revu à plusieurs années de distance pourra donc produire des effets très différents en fonction de l’expérience accumulée par l’individu.
[64] Une telle rupture perd évidemment de son sens et de sa saveur quand le nombre de films qui prétendent opérer de cette manière se multiplient et finissent par constituer un véritable genre cinématographique… La « rupture » en soi n’aurait guère de sens si elle ne s’accompagnait pas par ailleurs d’un intérêt plus « positif »…
[65] Parmi les exemples de telles polémiques, citons entre autres l’article de François Truffaut contre « Une certaine tendance du cinéma français » (Les Cahiers du Cinéma, n° 31, janvier 1954), celui de Jacques Rivette, intitulé « De l’abjection » (Les Cahiers du Cinéma, n° 120, juin 1961) et s’en prenant au film Kapo de Gillo Pontecorvo (1959), les différentes réactions suscitées surtout en France par La Liste de Schindler de Steven Spielberg (1994), par le Grand Bleu de Luc Besson au succès populaire inattendu après une réception très « froide » au Festival de Cannes (1988) ou, plus récemment, la « démolition » critique d’Odette Toutlemonde d’Eric-Emmanuel Schmitt (2006), qui se voulait d’ailleurs une « charge » contre la critique…
[66] Pour rappel, le sens d’un film est toujours une reconstruction des spectateurs, même si ceux-ci supposent plus ou moins implicitement que c’est le même que celui donné à son film par le cinéaste (entendu comme « l’auteur » du film). Mais le sens que le cinéaste a effectivement donné à son film ne peut faire que l’objet d’une reconstruction historique, largement hypothétique, basée sur des indices indirects (même les propos d’un cinéaste censé s’expliquer sur ses intentions peuvent être partiels, inexacts ou carrément faux) et ne correspond que partiellement (sinon très partiellement) aux multiples interprétations que peuvent en donner les différents spectateurs.
[67] Dans son ouvrage Qu’est-ce qu’un bon film ? (Paris, La Dispute, 2002), Laurent Jullier analyse ainsi différents critères couramment utilisés par les spectateurs pour justifier leurs préférences: il distingue deux critères « ordinaires », le succès du film et sa réussite technique, deux critères « communs », le caractère édifiant ou émouvant du film, et enfin deux critères « distingués », l’originalité et la cohérence. Si de tels critères sont effectivement utilisés pour justifier des opinions critiques, il n’est pas sûr cependant qu’ils expliquent ces opinions, c’est-à-dire qu’ils rendent compte des véritables raisons qui ont pu motiver ces opinions. Ainsi, le critère de cohérence apparaît bien plus comme une forme de rationalisation d’une appréciation préconstruite que comme une qualité objectivable: la « démonstration » d’une cohérence esthétique est pratiquement possible pour n’importe quel film, même celui que le critique jugerait le plus mauvais du monde (à l’inverse, on peut aussi penser qu’une certaine part de l’art moderne se construit sur une esthétique du « choc », de la « discordance », de la « dissonance », c’est-à-dire des formes d’incohérence). Dans la même perspective, le caractère « émouvant » d’un film est bien plus un effet dont la cause doit encore être expliquée, qu’un critère vérifiable et discutable avec d’autres spectateurs.
[68] Cf. David Bordwell, Making Meaning, Harvard University Press, 1989.
[69] Eric Rohmer et Claude Chabrol, Hitchcock, Paris, Ramsay, 2006 (éd. or. 1957)
[70] La question du niveau d’éducation scolaire est évidemment très polémique. L’affirmation ici ne porte que sur la durée moyenne des études qui a augmenté dans tous les pays du monde depuis plus d’un siècle, même si elle s’accompagne d’inégalités persistantes et dans certains cas de régressions. De 1991 à 2004 dans les pays du monde, le nombre d'étudiants dans l’enseignement supérieur est ainsi passé de 68 à 132 millions, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de 5,1 %. Pendant la même période, cette augmentation a cependant été moins forte (1,9 %) en Europe de l’Ouest et aux États-Unis où la croissance de l’enseignement supérieur a démarré plus tôt. Aujourd’hui dans les pays de l’OCDE, la proportion de jeunes s’inscrivant dans l’enseignement supérieur oscille selon les pays entre 30 % et 80 % de la classe d’âge (Paulo Santiago, Karine Tremblay, Ester Basri, Elena Arnal, Tertiary education for the knowledge society, OECD Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report, 2008 http://oecd-conference-teks.iscte.pt/downloads/OECD_vol1.pdf).
[71] Cette position relativiste a notamment été défendue par Gérard Genette dans ses deux volumes consacrés à L’Œuvre de l’art (1. Immanence et transcendance, Paris, Seuil (Poétique), 1994, et 2. La relation esthétique, Paris, Seuil (Poétique), 1997, ainsi que par Jean-Marie Schaeffer (Les Célibataires de l’art. Pour une esthétique sans mythes. Paris, Gallimard (Essais), 1996).
[72] C’est une position défendue notamment par Marc Jimenez dans La querelle de l’art contemporain. Paris, Gallimard, 2005. Dans un style très différent, Monroe C. Beardsley (dont l’ouvrage Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, 1958, n’est pas traduit) affirme qu’il existe une base objective à l’expérience esthétique reposant sur trois grandes caractéristiques que sont l’unité, l’intensité et la complexité (unity, intensity, and complexity).
[73] On peut citer notamment les derniers ouvrages de Rainer Rochlitz (comme Feu la critique, Paris, La Lettre volée, 2003) qui, s’inspirant de Habermas, a mis toujours un accent particulier sur la nécessité du dialogue et de l’argumentation dans l’appréciation esthétique.
[74] Personne ne contestera que certaines dispositions (au sens large) sont naturelles comme la vision ou l’audition évoquées à l’instant. En revanche, il y a discussion pour décider si certaines dispositions proprement subjectives (cognitives, émotionnelles, symboliques…) sont universelles en fait (ce seraient des constantes anthropologiques comme le fait que les humains préféreraient spontanément le sucré) ou en droit (comme la faculté de juger chez Kant). Bien entendu, un grand nombre de nos dispositions sont acquises au cours de notre formation personnelle, sociale et culturelle et ne peuvent donc pas prétendre à l’universalité.
[75] Cf. par exemple l’ouvrage de Jacques Aumont, À quoi pensent les films ? (Paris, Séguier, 1996).
[76] On peut également se référer à la notion d’habitus chez Pierre Bourdieu, qui désigne l’intériorisation (nécessairement différente selon l’appartenance sociale) des différentes expériences, valeurs, actions et appréciations vécues par les individus au cours de leur existence : ces expériences sont intériorisées sous forme de schèmes pratiques qui guident ensuite intuitivement l’action présente ou future ainsi que les choix par exemple en matière culturelle.
[77] Cf. entre autres l’ouvrage aujourd’hui classique de Pierre Bourdieu, La Distinction (Paris, Minuit, 1979) mais également celui déjà cité de Bernard Lahire sur la Culture des individus.
 La réalisation de cette étude a bénéficié du soutien du Ministère de la Communauté française
La réalisation de cette étude a bénéficié du soutien du Ministère de la Communauté française
et en particulier de la Direction générale de la Culture
et du service de l’Éducation permanente.